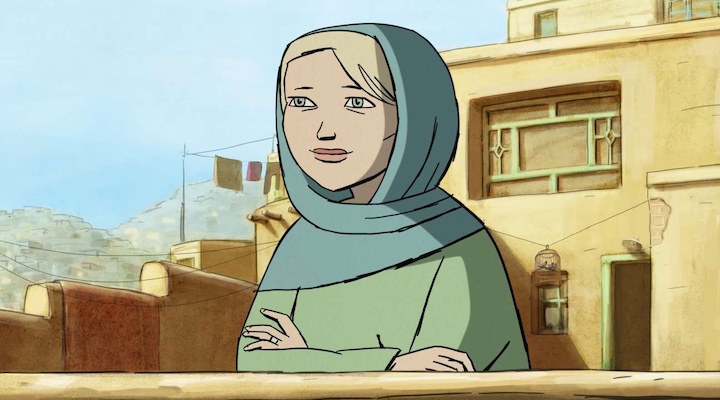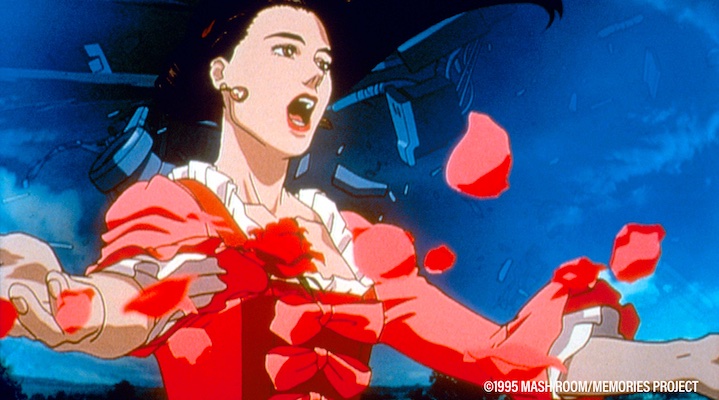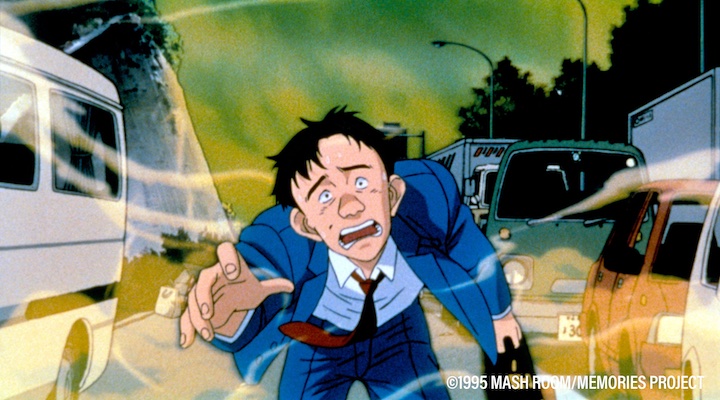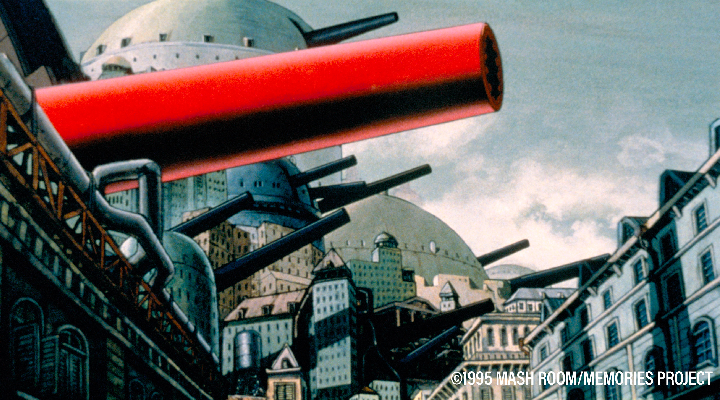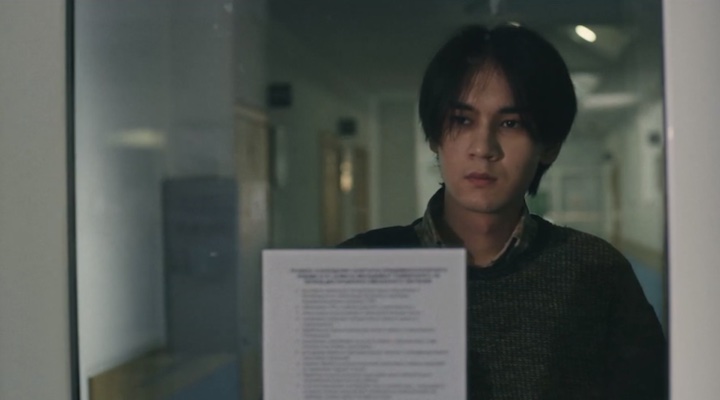Après des études de philosophie, Jérémy van der Haegen sort diplômé en 2004 de l’INSAS (Institut National Supérieur des Arts du spectacle et des Techniques de diffusions) en réalisation, à Bruxelles. Il signe en 2011 un premier moyen-métrage Le Garçon Lumière puis Les Hauts Pays en 2016, avant de réaliser en 2020 Nuits sans sommeil qui remporte le Grand Prix de la 3e édition du Festival Format Court. Également relayé sur la plateforme de diffusion d’Arte, ce dernier opus connait un beau parcours en festivals depuis sa sortie. Rencontre avec un réalisateur qui porte en lui une vision forte et singulière du cinéma.

Format Court : Peux-tu revenir sur la naissance de ton film ?
Jérémy van der Haegen : C’est une chronique familiale au centre de laquelle un petit garçon veut porter des robes. Il y a un loup qui rode dans la région. Le film débute quasiment comme un film social puis, petit à petit, il se dirige vers quelque chose à la limite du fantastique. Mon film parle du quotidien, en s’appuyant sur les actions répétitives de la vie ordinaire, tout en essayant de faire ressentir des choses sous-jacentes, les désirs et frustrations de chacun au sein de cette famille.
Est-ce que c’est une volonté de créer une dimension naturaliste autour de ce quotidien qui t’a poussé à ne pas mettre, entre autres, de musique ? C’est un film très silencieux.
JVDH : Je n’avais pas besoin de musique mais la bande-son est construite de façon musicale. Le film est silencieux et même extrêmement silencieux. Je dirais que le son ne participe pas au réalisme du film, au contraire. Le son du film le pousse vers l’abstraction et le fantastique qui se trouve ici dans l’étrangeté plutôt que le surnaturel ou l’irréel. Si l’on avait voulu construire une bande-son réaliste pour amener le film en ce sens, on aurait ajouté des ambiances de voitures, d’oiseaux et de nature. Or, on a retiré énormément de sons. On a vraiment cherché à faire un travail de dépouillement. Chaque son apparaît alors dans sa singularité presque irréelle et participe, isolé ainsi, à quelque chose de claustrophobique se passant à l’intérieur de cette maison.
Tu as pris le parti, avec ton DOP Thomas Schira, de tourner en pellicule, en format 4:3. Qu’est-ce qui a motivé ce choix ? Est-ce que le format 4:3 participait pour toi à créer justement un étau autour de tes personnages ?
JVDH : Le format 4:3 crée en effet, une forme d’étau qui enferme le personnage dans le cadre et dans le décor. C’est un format où l’on peut travailler la verticalité de façon intéressante : le hors champs vertical suggère cette dimension imaginaire qui transcende le réel. Dans les Vosges, là où l’on a filmé, il y a des collines avec des forêts de sapins et l’on a fait attention à présenter des horizons bouchés qui participent, même dans la vaste étendue naturelle, à la claustrophobie et au sentiment de ne pas pouvoir s’échapper. Un hors champ vertical sombre et bouché à l’image d’un imaginaire menaçant. Le format 16mm permet cette physicalité de l’image granuleuse : une texture, quelque chose qui grouille dans l’image. On utilise sa force picturale qui continue de faire récit et barrière au réel.
Faire barrière au réel, dans ton film, c’est un peu faire barrière au monde des adultes qui en sont peut-être les garants ? Entre les parents qui n’arrivent pas à verbaliser totalement la situation et la scène assez terrible avec la pédopsychiatre, on sent un hermétisme dur chez eux…
JVDH : Ils sont plus garants de la norme que garants du réel. Le petit garçon est tout aussi réel, ses désirs sont tout aussi réels. […] J’ai construit les parents comme garants d’une norme qui les fait souffrir eux-mêmes, ne les rend pas heureux et les empêche de vivre en harmonie. C’est une assignation, quelque chose qui les empêche. Dans mon film, l’enfant en est à l’étape où il se pose la question de la norme et où la question va plutôt se poser à lui. Pour les parents cela est déjà fait, c’est déjà un parcours de résignation, d’où cette frustration sous-jacente et cet hermétisme dont tu parles.
Tu as installé cette famille dans la campagne vosgienne. Est-ce que tu étais familier de ce lieu ? Est-ce qu’il a inspiré cette histoire ?
JVDH : Je n’étais pas nécessairement familier avec le lieu, par contre l’histoire du film est extrêmement familière, voire biographique, même si le film est transformé en fantasme par le cinéma, par le travail du récit, des acteurs. Au niveau des décors, j’avais envie d’aller vers un territoire de fiction. J’ai beaucoup voyagé en France à la recherche de ce qui allait appuyer l’imaginaire de ce film-là, cette espèce d’inquiétante étrangeté. Je voulais aussi, sans vouloir dire un gros cliché, mettre cet enfant dans une région, dans des régions, où il est sans doute un peu plus difficile d’être le différent, parce que ces régions sont moins habitées et qu’il y a peut-être moins de place pour la différence. Peut-être que la norme y est un peu plus forte, même si ça s’interroge bien sûr.
C’est aussi un territoire qui t’a permis de filer cette métaphore du loup, du loup qui sort du bois, tout au long du film. Tu montres même tout un bestiaire dans la chambre de l’enfant au cours d’une sorte de cauchemar.
JVDH : Pour le loup, je me suis dit que c’était le monstre de l’enfance et qui était, de plus, lié spécifiquement au domaine de l’imaginaire et des fables. Je me suis donc posé la question de cette monstruosité et de la façon assez moraliste dont il a été utilisé dans les histoires pour les enfants. C’est aussi un animal dont la psychanalyse s’est emparée pour parler de la sexualité, des désirs et des peurs. Et puis le loup réel sévissait vraiment dans la région. Ce loup arrive donc avec une multiplicité de casquettes, ce qui fait que l’on ne peut pas choisir un seul aspect de lui. C’est à la fois le loup réel qui est revenu dans la région, à la fois le loup du film fantastique, comme le loup-garou, le loup de la psychanalyse, la sexualité, et le loup dont il ne faut pas s’approcher dans les contes et fables. Pourtant, à la fin, lorsqu’il y a une sorte de rencontre un peu imaginaire entre le loup et l’enfant, le loup est assez tendre, comme s’il lui proposait une identification détournée. Le loup des Nuits sans sommeil est presque un alter égo de l’enfant. Le film détourne la figure du monstre pour parler de la différence.
Le bestiaire final, c’est pour être sûr que l’on échappe au loup psychanalytique : montrer qu’il y a tout un univers qui s’agite, fait de désirs multiples, de métamorphoses à l’infini. Je trouvais intéressant de ne pas filmer qu’une métaphore, mais de suggérer d’autres pistes (quelque chose de plus large, plus multiple), de ne pas rejouer le jeu de l’identité […]. Je voulais permettre à l’enfant de s’échapper dans une multiplicité de fascinations, de peurs et d’identifications possibles.

Comment as-tu rencontré ton jeune acteur Vidal Arzoni ? Comment as-tu réussi à le plonger dans l’atmosphère du film et dans son rôle ?
JVDH : C’est le premier enfant qui a répondu à une annonce que j’avais dû mettre sur un groupe Facebook dédié. La particularité et la singularité de son visage m’avaient sauté aux yeux de manière assez évidente. Je cherchais notamment un enfant qui avait des yeux très cernés. Un visage dans l’enfance et un visage fatigué voire étrange. Puis, il avait cette justesse naturelle à ne pas en faire trop et délivrer son texte de façon presque neutre, sans le jouer. Il a cette intelligence de ne pas surjouer les intentions, de ne pas penser les actions et les sentiments comme des choses à jouer, à montrer, mais comme des choses à laisser apparaître.
En quoi tes deux films précédents t’ont amené à Nuits sans sommeil ? Quel trait similaire retrouves-tu en eux ?
JVDH : Je dirais qu’ils sont similaires dans la façon de traiter un sujet et dans leurs atmosphères. Je m’empare de choses qui sont à la fois du domaine du réel, du domaine du social, qui agitent le monde aujourd’hui, pour après les traiter d’une façon détournée, comme si je les regardais un peu à côté, avec toujours ce flirt avec l’univers fantastique, une étrangeté qui fait douter du réel.
J’aimerais revenir sur ton travail de production. Pour ce film, il s’agit d’une co-production belge entre Neon Rouge et After Hours…
JVDH : Neon Rouge est le producteur du film et After Hours est ma société, est la coproductrice. Je suis, depuis mes trois films, toujours en coproduction avec ma structure. Je prends part à la production de mon film et mon producteur, Aurélien Bodinaux, m’a de plus en plus laissé le champ libre pour piloter la production moi-même. Il m’a appris à produire, à maîtriser de plus en plus tous les aspects de la production, jusqu’à ce que je devienne producteur. C’est la raison pour laquelle je suis crédité en tant que tel au générique du film.

En tant que spectateur, qu’est-ce qui a forgé ton cinéma ? Quels sont les cinéastes qui ont inspiré ton envie de cinéma et, au delà, ta pratique personnelle ?
JVDH : C’est difficile de choisir des noms. Par exemple là, je porte un t-shirt avec Fassbinder dessus [rire]; lui, bien sûr, il en fait partie. En tout cas, Bresson, Fassbinder, Pasolini, Tati… des gens qui ont une forme assez forte, un système particulier, qui n’apportent pas juste un contenu ou des récits mais aussi une vision assez singulière du monde parce que c’est la façon dont ils ont esthétiquement fait leurs films. Une vision qui est finalement leur regard sur la réalité et qui nous permet en tant que spectateurs de nous retrouver d’abord devant un objet un peu étrange, un film un peu étrange, et donc de nous laver le regard, de voir autre chose, ce que l’on avait pas forcément vu. […] C’est ça que je veux voir au cinéma. Mon effort de travail en tant que réalisateur va, je l’espère, dans ce sens.
Tu as l’impression que c’est quelque chose que l’on voit de moins en moins au cinéma, quelque chose qui tend à être éclipsé ?
JVDH : Oui ça c’est évident. On a [fréquemment aujourd’hui] le sentiment de voir le même regard, le même film, c’est-à-dire que les plans sont les mêmes, la façon de faire jouer les acteurs est la même et donc, quelque soit le propos où même si l’histoire diffère, moi je pense que c’est le même film et je trouve ça un peu fatiguant. […] J’aime bien que le sujet ne prenne pas le dessus et soit aussi exprimé dans son rapport à la forme du film. Ce n’est pas pour avoir un dialogue purement formaliste mais je pense que c’est là notre travail de réalisateur : comment trouver une forme pour exprimer quelque chose, une vision du monde. Mais souvent, c’est vrai, on sent que le sujet prend le dessus. Il y a une grande demande pour les films à sujet. D’ailleurs à propos de Nuits sans sommeil, je pense qu’un tel film a pu avoir du succès parce qu’il y a un sujet de société à sa base. La singularité et la longueur de Nuits sans sommeil, cette fois-ci, ne l’ont pas empêché d’avoir de nombreuses sélections en festivals et une reconnaissance, notamment parce que le sujet agite la société aujourd’hui. Et aussi peut-être, je l’espère, parce que justement il n’est pas traité de manière complètement univoque.
Propos recueillis par Gaspard Richard-Wright
Article associé : la critique du film
Consulter la fiche technique du film