Le Festival Musique et Cinéma de Marseille a accueilli ces derniers jours la comédienne et réalisatrice Emmanuelle Bercot et son compositeur Eric Neveux. Tous deux présentaient le très émouvant De son vivant (hors compétition, Cannes 2021) pour lequel Benoît Magimel a reçu dernièrement un César du meilleur acteur.
Emmanuelle Bercot a fait plusieurs courts alors qu’elle était étudiante à la Fémis. Son tout premier court, Les Vacances, a reçu le Prix du Jury à Cannes en 97 et son film de fin d’études La Puce a obtenu 2 ans plus tard le 2ème Prix de la Cinéfondation, la section cannoise réservée aux films d’écoles. Eric Neveux, de son côté, est également passé par le court et a collaboré notamment avec Édouard Deluc et Myriam Boyer. Entretien croisé autour de l’apprentissage, du dialogue, du vinyle et du temps de composition.

© Leïla Macaire
Format Court : Quand vous étiez à la Fémis, Emmanuelle, vous avez fait trois courts, il y en a même un qui a été pris à la Cinéfondation. Comment perceviez ce format-là à l’époque ?
Emmanuelle Bercot : C’était un peu particulier parce que j’étais obligée de faire des courts-métrages et que j’étais encadrée pour les faire. Je n’ai ni dû me battre ni convaincre des gens pour trouver de l’argent. Ça faisait partie de la scolarité. Après je vous avoue que je pensais que mes premiers courts-métrages n’allaient être vus que par mes profs et mes parents. Je ne venais pas du tout de ce monde-là. Je n’avais aucune notion qu’il y avait autant de festivals et je ne savais même pas qu’à l’intérieur de l’école, quelqu’un s’occupait de proposer les courts des étudiants en festival. Je me souviens très bien qu’on m’a appelée pour me dire que mon film était sélectionné à Cannes mais je n’ai même pas été contente, tellement je n’ai pas compris ce que ça voulait dire. C’est après, une fois qu’il a fallu tout mettre en branle pour être présent à Cannes et tout le reste, que je me suis dit qu’il y avait un truc qui pouvait se passer pour les courts-métrages qui était énorme. Le fait que mon court-métrage était à Cannes et qu’il ait eu un prix, ça a complètement tout changé pour moi. Dès le moment où vous avez un prix, les producteurs ne regardent même pas votre court-métrage, ils vous appellent directement ! Ça m’a ouvert absolument toutes les portes. En débarquant complètement dans ce métier, je l’ignorais et après, avec ce court métrage, j’ai fait à peu près tous les festivals qui existent et j’ai vu qu’il y avait un vrai monde du court-métrage. De loin, on peut penser que c’est un peu le parent pauvre, qu’il faut se démerder un peu tout seul mais il y a énormément de lieux qui mettent en valeur le court-métrage et qui te font découvrir des cinéastes. C’est ça pour moi le rapport au court-métrage.
Est-ce que vous aviez les moyens d’expérimenter ce que vous vouliez ?
E.B. : Bien sûr, c’est une école d’état. Il y a énormément de moyens dans cette école. Je ne sais plus le coût de la scolarité par étudiant mais on a des moyens de dingue. C’est très dur d’y rentrer aussi (rires), il y a une grosse sélection. Comme tous les concours, c’est injuste mais quand on y est, on a énormément de moyens.
En terme d’écriture, est-ce qu’il y avait un truc que vous vouliez particulièrement faire sur ce film vu que vous aviez des moyens à disposition ?
E.B. : Je n’ai pas raisonné comme ça. J’ai écrit un truc que j’avais envie de raconter, sans penser à expérimenter en fait. De toute façon, quand on fait un premier court-métrage, on expérimente ce que c’est que de faire un tournage car on ne sait pas ce que c’est en fait. Pour moi, c’était ça l’expérience. Je ne me suis pas dit : « Je vais faire un truc hyper radical parce que là je peux le faire et que je ne pourrai pas après ». Je n’ai pas du tout raisonné comme ça. C’est un court-métrage qui s’apparente au film social, c’est un type de film qui m’a toujours énormément plu, je suis partie directement dans une direction qui me correspondait, je n’ai pas eu le sentiment d’expérimenter autre chose que ce que c’est que de faire du cinéma.
Vous travaillez en famille, avec vos comédiens, votre équipe technique. Est-ce que c’est quelque chose qui a démarré quand vous étiez à l’école ?
E.B. : Tous les gens qui étaient sur Les Vacances, mon premier court-métrage, sont des gens avec qui je travaille encore aujourd’hui.
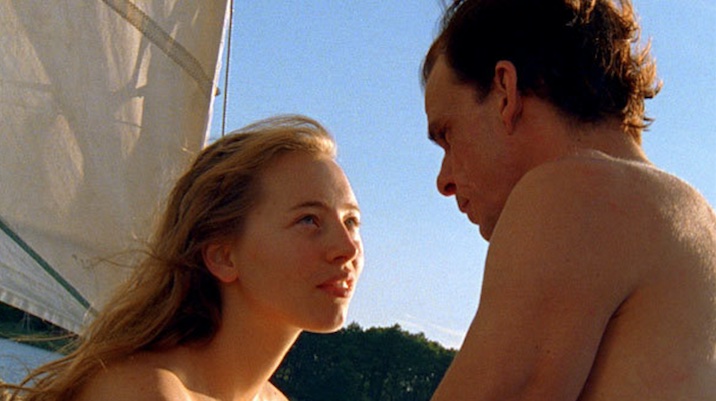
« Les Vacances »
Votre monteur, Julien Leloup commence le montage au début du tournage et vous envoie à vous, Eric Neveux, des séquences pour que vous puissiez commencer à composer. Est-ce que c’était une idée de vous, Emmanuelle ? Est-ce vous qui avez instauré cette façon de faire ?
E.B. : Pour moi, la façon de faire, c’est de commencer à monter pendant le tournage. Ce n’est pas obligatoire. Je le fais parce qu’on travaille ensemble depuis 25 ans avec Julien, il me connaît tellement que j’ai confiance dans ce qu’il va faire en mon absence. Je ne pense pas que je le ferais avec un autre monteur. Je fais ça de plus en plus car on gagne quand même deux mois de post-production. Comme je leur fais à tous les deux extrêmement confiance, ça me parait normal qu’ils avancent sans moi parce que pendant le tournage, je ne suis absolument pas disponible pour penser à autre chose. Je trouve ça chouette qu’ils puissent démarrer tous les deux sans moi.
Est-ce que votre monteur vous montre des séquences montées pendant le tournage ?
E.B. : Non, je ne regarde même pas les rushes. La seule chose, c’est que mon monteur me fait très régulièrement des retours par mail, des critiques, peu de compliments, pour essayer de redresser la barre avant qu’il ne soit trop tard.
Des critiques, à quel niveau par exemple ?
E.B. : Sur la mise en scène, les focales, le choix des plans, ceux qui manquent, beaucoup sur les acteurs, sur tout ce sur quoi on peut encore agir pendant le tournage.
Eric Neveux : Pour la musique, le fait de faire ça permet de gagner un temps précieux. Il y a plein de cas où on fait des films en 2-3 mois parce la collaboration n’est pas aussi organisée que ça, parce que tout à coup, le montage est fini et qu’il faut faire la musique. Ça arrive assez souvent et là sur De son vivant, l’idée, comme il y avait un enjeu un peu particulier sur la musique, c’était de trouver un ton spécifique sur ce film. Il y avait un réflexe de se dire qu’on allait commencer dès que possible. Julien, le monteur, m’a même demandé à partir de quand j’étais en mesure de recevoir le contenu. Je lui ai dit : « Dès que tu peux, dès que tu trouves un assemblage ». Je suis très partant pour recevoir des choses, pour commencer à travailler.
Vous dites que sur chaque projet, il y a un enjeu. Quelle était la particularité de celui-ci ?
E.N. : Je ne sais plus si on se l’est vraiment dit mais il fallait trouver un ton pour traiter ce principe de mélo, un principe qui soit le bon. Pour ça, on a besoin de temps. Quand on a du temps, on l’utilise pour chercher. Parfois, travailler dans l’urgence sur la fin, ça peut être très intéressant. Là c’était typiquement un film sur lequel j’étais content de ne pas recevoir des images et d’avoir juste deux semaines pour proposer mon travail. Pour De son vivant, c’était vraiment une bonne chose de prendre le temps, de ne pas être obligé de fournir ou de produire. C’est ce qui a caractérisé la façon de travailler sur le film, ce qui ne nous a pas empêchés d’avoir des rushes à la fin car si même tu as travaillé très tôt, à la fin, il va y avoir des choses que l’on met plus de temps à trouver et que l’on doit faire un peu plus dans l’urgence. Ce sont des dynamiques qui se suivent et qui sont d’ailleurs intéressantes toutes les deux.
(…) Le moment de tension, c’est quand on cherche le ton. Après, quand on a l’impression d’avoir trouvé une couleur et une sorte de grammaire musicale qui peut durer 30 minutes ou 1h10, ça représente du boulot, mais ce n’est plus la même pression. Avoir du temps pour chercher ce ton, c’est vraiment très précieux.
Eric, vous avez fait des courts à vos débuts, est-ce que vous avez encore envie de faire de la musique pour ce type de films ?
E.N.: J’ai fait des courts au début pour apprendre mon métier. C’était passionnant. En revanche, à quelques exceptions près, je trouve que c’est bien de ne plus en faire après parce que c’est utile de laisser les projets aux gens qui ont besoin de démarrer justement. Quand on m’appelle pour des courts, je dis en général non parce qu’il y a plein de gens qui sont comme moi il y a dix ans. Un court, c’est un film. Pour un musicien, c’est le même enjeu, les mêmes problématiques, donc j’ai plutôt tendance à ne pas accepter.
Est-ce que le court-métrage est une forme que vous, Emmanuelle, vous suivez encore un peu ?
E.B. : Je ne vais pas vous mentir, je n’aime pas ça. Parfois, des jeunes réalisateurs m’envoient leurs courts-métrages donc par gentillesse et politesse, je les regarde et je leur fais un retour, mais c’est vraiment le seul contexte dans lequel je vois des courts-métrages. Même quand j’en faisais, je n’aimais pas trop ça. Je trouve ça extrêmement difficile, cette durée. Il y a pourtant des courts fantastiques, ceux de Ozon par exemple, des films exceptionnels qui sont bien mieux que certains longs-métrages mais sur la masse de courts, c’est un format dans lequel je ne suis pas bien. Après, j’ai beaucoup de curiosité. Si tout le monde parle d’un court-métrage, je vais aller le regarder. Souvent quand on me propose des rôles d’actrice dans un premier long-métrage, je regarde les courts-métrages qu’on m’envoie. Là ça m’intéresse énormément parce que c’est la seule boussole que j’ai pour savoir un peu à qui j’ai à faire. Et je me détermine beaucoup sur les courts-métrages.

« La puce »
Par rapport à cette position d’actrice, est-ce vous avez envie de faire confiance aux jeunes réalisateurs ?
E.B. : On a hyper envie, c’est sûr, c’est génial. Mais sans avoir rien vu, c’est compliqué.
Quand vous travaillez, qu’est-ce qui détermine une belle écriture ?
E.B. : Les dialogues. Sur la construction, c’est normal, on a tous été médiocre. Au début, c’est tellement compliqué l’écriture de scénario. Les premiers scénarios sont plein d’erreurs. Et même aujourd’hui, au bout de 25 ans de métier, mes scénarios sont toujours plein d’erreurs de construction. En revanche les dialogues, ça, ça ne trompe pas. Si ça sent l’écriture, si ça sent le papier comme on dit… Le dialogue, pour moi, on a le sens ou on ne l’a pas. C’est vraiment le baromètre.
Donc à l’écriture, vous allez savoir selon le dialogue si ça peut être bon ou pas ?
E.B. : Le meilleur acteur du monde, s’il dit un mauvais dialogue, il est « à chier », il n’y a rien à faire. Souvent, quand il y a un truc qui ne marche pas, ce n’est pas l’acteur, c’est que le truc est mal écrit. Moi ça m’arrive de réécrire quelque chose parce que l’acteur n’arrive pas à le jouer. C’est pas de sa faute, c’est de la mienne. C’est comme quand vous voyez un premier court-métrage et que les acteurs ne sont pas bons. Ça ne donne pas très envie d’y aller.
Eric, vous avez lancé votre propre label. Pourquoi ?
E.N. : C’est plus une maison de production qu’un label. C’est ce qui me permet de sortir des choses comme le vinyle de la musique de De son vivant ou des albums en digital. Ce n’est pas un label à proprement parlé avec du développement d’artistes.
Les manières de consommer ont changé. Avant, on allait acheter le CD de la bande originale d’un film. Aujourd’hui, les gens ont plus recours au vinyle.
E.N. : Le retour du vinyle, c’est vraiment intéressant. Ce qui se passe en ce moment est énorme. À la Fnac par exemple, le rayon vinyle à explosé en taille, ça me ravit. Les vinyles sont des beaux objets et ça se vend. Les usines n’arrivent pas à en fournir depuis quelques mois. Ça s’explique par diverses raisons mais aussi parce qu’il y a des gros artistes qui sortent en vinyle et qui engorgent des usines entières. En ce moment, c’est complètement dingue. Je pense qu’il y a un rapport à l’objet par opposition avec le streaming où c’est pratique, où on fonctionne plus en playlist. Je suis très content parce que faire des vinyles, ce n’est pas très rentable mais c’est super, ça crée des occasions, on retrouve ce rapport à l’objet.
Comment percevez-vous du coup le fait que les films sortent en DVD ? Est-ce que ça reste un enjeu pour vous, Emmanuelle, de sortir vos films en DVD ?
E.B. : Je pense être assez représentative des personnes lambda. J’achetais énormément de DVD, je n’en ai pas acheté depuis à peu près dix ans, je ne sors plus un DVD de ma bibliothèque et je pense que je ne suis pas la seule. Je me demande pourquoi on continue à sortir des DVD. En plus, moi, je n’ajoute plus de bonus dessus. Je ne mets plus de making of parce que ça coûte de l’argent qu’on m’enlève sur le film donc je n’en veux pas, mais pour moi l’intérêt du DVD, c’est le fait que l’on avait des documents (bonus), j’adorais ça. Personne ne les regarde aujourd’hui alors je ne vais pas me fatiguer. Ça va peut-être revenir comme le vinyle… Je ne me renseigne jamais sur les ventes de DVD de mes films et puis personne ne m’en informe. J’ai l’impression que personne ne s’en soucie alors que sur les sorties des films, vous êtes bien au courant du nombre des entrées. Le reste, par contre…
Propos recueillis par Katia Bayer et Damien Carlet. Retranscription : Damien Carlet


