La Semaine de la Critique diffusait cette année une séance spéciale comprenant 3 films de réalisateurs repérés : Emmanuel Gras, Yann Gonzalez et Joseph Pierce. Ce dernier est animateur au Royaume-Uni. Depuis son film de fin d’étude de la NFTS, Stand Up, il a réalisé deux courts d’animation sélectionnés et acclamés en festivals : The Pub et A Family Portrait. Après une tentative de fiction (The Baby Shower) et en parallèle de son travail au journal The Guardian, il a terminé son nouveau projet, ambitieux à plusieurs niveaux (histoire, co-production, durée, couleurs, …) : Scale.
Cette adaptation de William Woodard Self (Will Self), également sélectionnée au prochain festival d’Annecy, sera diffusée sur Court-Circuit (Arte) le weekend prochain. En 2010, nous avions interviewé le réalisateur à l’occasion d’un focus que nous lui avions consacré. Plus de 10 ans plus tard, une mise au point s’imposait.

Format Court : Tu travailles pour le journal The Guardian. Qu’est-ce que vous faites exactement ?
Joseph Pierce : Je suis designer d’images animées, donc je travaille sur leur contenu Youtube et pour les réseaux sociaux. Mon travail est de créer des mouvements. On est loin de mon style cinématographique. J’ai comme deux vies professionnelles complètement séparées. Mais ce travail m’offre une stabilité financière et des horaires qui me permettent d’être beaucoup plus libre sur le plan créatif.
Juste après l’école (NFTS), tu as réalisé très rapidement plusieurs courts-métrages. Puis, on t’a perdu de vue. Qu’est-ce qui s’est passé ?
JP : J’ai fait mon film de fin d’études, Stand Up, qui a reçu beaucoup d’attention. 6 mois après mon diplôme, il s’est avéré que le British Film Institute a débloqué des financements pour l’animation. J’ai fait mon premier film professionnel, A Family Portrait, qui a pris à peu près trois mois à être animé et deux mois à être développé. Ça a été très vite. Je n’y ai pas trop réfléchi, je l’ai juste fait. J’ai financé mon film suivant, The Pub avec l’argent que j’avais touché en remportant certains prix. Je l’ai commencé puis je suis parti en résidence de deux mois au Japon pendant la période du tsunami. C’était tout une expérience. J’ai poursuivi mon film après, mais ça m’a pris 9 mois car j’ai utilisé une tablette graphique. Une tablette, c’est comme une grosse toile sur laquelle on travaille, ça prend du temps. En plus, j’ai travaillé complètement seul car c’était un film autofinancé.
Ensuite, j’ai beaucoup travaillé en freelance où je mélangeais expérimental et animation. C’était hyper intéressant. Dans l’intervalle, je développais des films. Après j’ai été embauché au Guardian.
Tu es revenu à l’animation avec une adaptation : Scale. Qu’est-ce qui t’a intéressé dans le projet de William Woodard Self ?
JP : Will est un peu un “personnage” au Royaume-Uni. Il n’est pas nécessairement mainstream mais il est connu. J’ai lu son histoire quand j’avais 17/18 ans et ça m’a marqué. Je me souviens que ça parlait d’un homme avec des veines très apparentes. Je trouvais que ça donnait une image très visuelle et frappante. Quand on est arrivé à la phase de la pré-production, je me suis dit que ça ne pouvait être fait qu’avec de l’animation et à travers mon style, fondé sur la réalité mais avec des éléments très surréalistes.
Tes histoires sont très personnelles. Et-tu intéressé par le documentaire animé ?
JP : Oui. Beaucoup de gens ont pensé que Stand Up était une sorte de documentaire et ce n’en est pas un. Les rires ont été enregistrés dans des contextes réels de stand up, et ça donne une vraie atmosphère, mais le reste n’est pas réel. Pourtant, je suis très ouvert à cela, j’ai toujours trouvé le documentaire intéressant.
Si on ignore que Scale est une adaptation, ne pourrait-on pas penser qu’il s’agit d’un documentaire animé ?
JP : Le récit en lui-même repose sur des faits réels. William s’est inspiré de son histoire d’addiction à l’héroïne, et de sa rupture avec sa femme. Moi, il a fallu que je trouve une porte d’entrée. J’ai trouvé des façons de m’y plonger en l’imaginant comme un auteur obsédé à l’idée d’achever son livre. Je pouvais totalement m’identifier à ce processus créatif.
Chacun de mes films m’obsède et finit par me consumer. Je pense qu’en ayant des enfants, on se rend compte qu’on peut perdre sa famille au profit de sa quête créative. Je me suis aussi inspiré de ces expériences. C’est ce qui le rend peut-être aussi un peu personnel.
Adapter l’histoire de quelqu’un d’autre soulève toujours cette difficulté : respecter l’œuvre de l’autre tout en la rendant personnelle.
JP : Exactement ! Il faut choisir les éléments qu’on veut garder, et peu à peu ça devient presque une nouvelle œuvre, elle prend un peu son indépendance. C’est un processus qui m’a beaucoup plu, j’ai énormément travaillé sur le scénario.
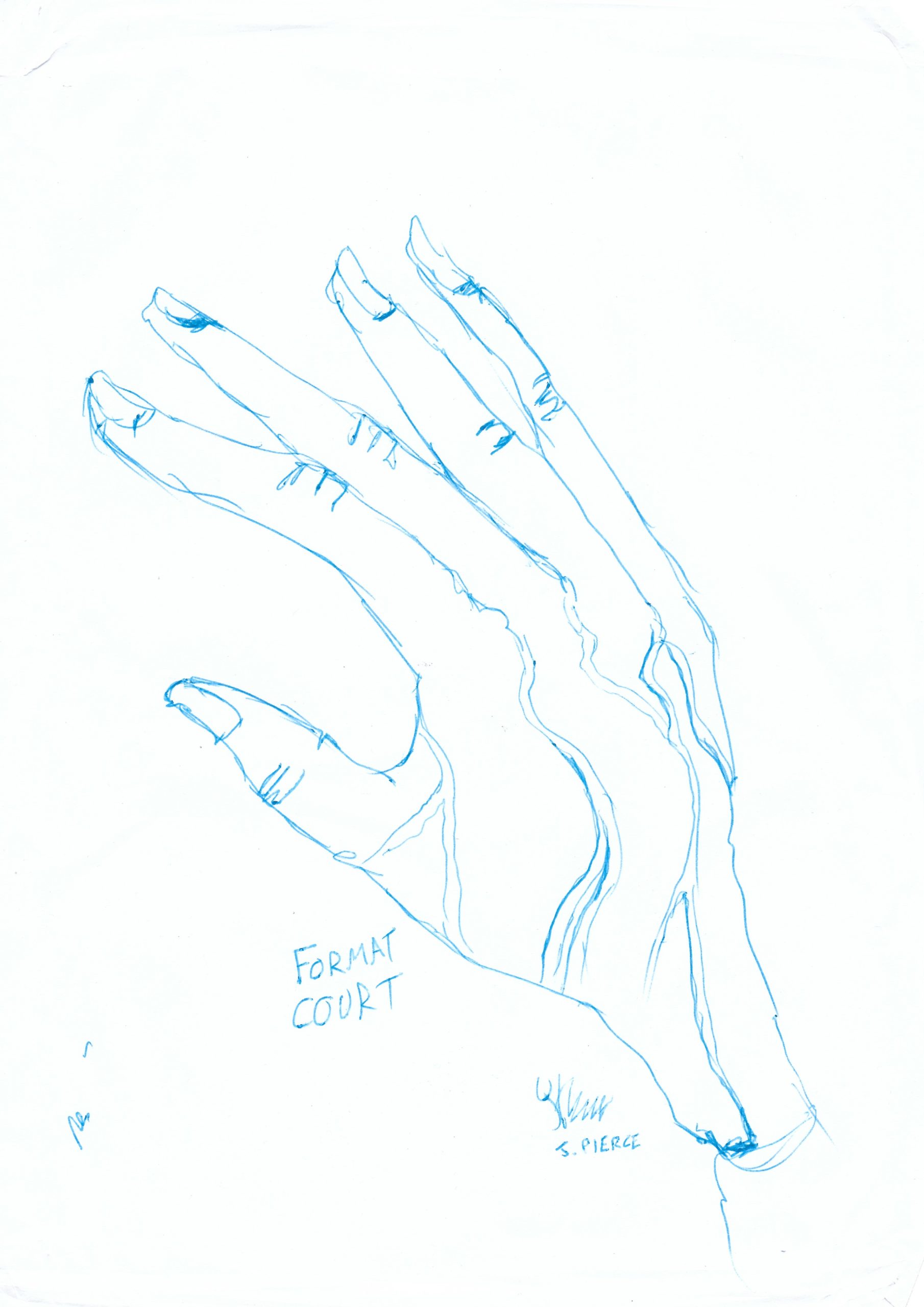
Peux-tu nous en dire un peu plus sur le travail de la couleur ?
JP : C’était l’idée d’Hélène Mitjavile (Melocoton Films). Au départ, je ne voulais pas que ça soit en couleur parce que je ne voulais pas tripler la durée de production. Et travailler avec d’autres personnes était aussi mon challenge numéro 1. J’ai vraiment une méthode bien à moi : je commence avec le premier plan et je travaille progressivement, je vois où l’animation m’amène.
Travailler avec quelqu’un, c’est mettre plus de cadre, organiser, prévoir des images-clefs… J’ai dû faire une centaine de dessins pour le film afin de déterminer le style et trouver des personnes qui pouvaient s’accorder avec. On a dû dire au revoir à certaines personnes, mais les gens qu’on a retenus sont certainement plus talentueux que moi. Leur savoir-faire est incroyable, ça a finalement été un vrai plaisir de travailler avec eux.
Tu travailles beaucoup autour de la déformation des visages et des corps, tu t’intéresses au mouvement, au fantastique. Comment cela est-il venu ?
JP : C’est venu assez naturellement. Pour moi, l’animation nécessite une dimension d’exagération. C’est un instrument narratif qui apporte une épaisseur supplémentaire à l’histoire. Il est important que les gens se sentent impliqués dans la narration, plutôt que de réaliser des œuvres animées qui soient visuellement belles.
Mais ça rend les choses difficiles à faire, parce qu’il n’y a pas de raccourci. La plupart des plans doivent être redessinés entièrement, et ça prend beaucoup de temps, mais c’est aussi ça qui rend le film unique. J’aime cette idée que les choses continuent à évoluer. J’adore les œuvres de Dali, d’Aubrey Beardsley, ou encore le travail de Jan Švankmajer, un réalisateur d’animation surréaliste qui m’a beaucoup influencé…
Du point de vue du style, j’aime aussi beaucoup les œuvres des artistes impressionnistes et le travail d’Aubrey Beardsley, un artiste britannique. On m’a déjà dit que mes films ressemblaient à ses œuvres, et ça me parlait beaucoup. Il est mort à 25 ans, il y a plus de cent ans. Il était influencé par l’art japonais et ses lignes sont très simples. Il expliquait justement que si on ne fait rien de grotesque, alors on ne fait rien d’intéressant. Je reprends beaucoup ce terme de “grotesque” pour décrire mon travail, et j’aime comment il a rendu ce mot très positif. C’est pour ça que j’aime travailler autour du corps, des distorsions et des corruptions.
Scale était-il une sorte de test pour toi avant le long ?
JP : Oui, tout à fait ! Pour moi, c’est vraiment un film achevé. Quand on le compare à The Pub, il y a une énorme différence. Scale a aussi permis de prouver que je suis capable de proposer un film plus long, à une échelle plus importante. Seul, ça me prendrait 10 ans de faire un long-métrage, mais avec une équipe, ça me semble plus faisable !
Tes films se trouvent en ligne. Est-ce important pour toi de partager ton travail ?
JP : Je respecte une certaine temporalité, notamment avec les sorties en festival bien entendu et je fais attention au respect des droits. Mais je trouve effectivement que le fait de donner accès aux films en ligne est très stimulant. Ça permet de s’ouvrir à un public beaucoup plus large. Et, ça ne m’a jamais empêché de vendre mes films pour autant. Les gens veulent des droits non exclusifs de toute façon.
Comment as-tu appréhendé cette première sélection à Cannes ?
JP : Cannes était notre objectif depuis le début. Nous avons pensé le planning de la production en ce sens. D’ailleurs c’était un risque car nous avons finalisé le film deux semaines avant le début du festival. Si nous n’avions pas été pris, il aurait fallu attendre plus tard dans l’année. Le film aurait été diffusé à la Mostra ou ailleurs. C’était vraiment important pour nous d’être présents à Cannes car c’est un film en partie français.
Quel regard portes-tu sur sa programmation hors compétition à la Semaine de la Critique ?
JP : C’est tellement plus intéressant pour moi de voir les choses du point de vue thématique et pas seulement du point de vue de la technique, accompagné seulement de films d’animation. C’était super de voir Scale faire partie d’une telle programmation avec deux autres films très forts de réalisateurs expérimentés.
En raison du caractère unique du film quant à son budget et à son ambition, je crois qu’il était bien que le film fasse partie de cette programmation, ça nous a enlevé une certaine pression. Le film est sorti la pour la première fois, ce qui nous a permis d’en profiter, et il connaîtra ensuite sa vie de festival ailleurs. C’est un bon équilibre.
Propos recueillis par Katia Bayer. Retranscription : Eliott Witterkerth. Remerciements : Anne-Sophie Bertrand


