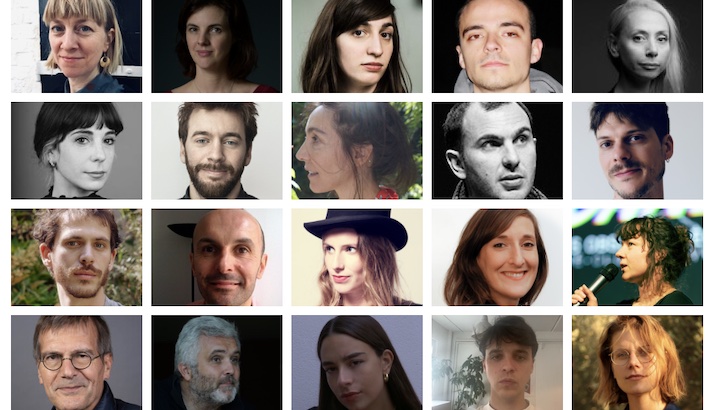Réalisateur, comédien et metteur en scène, Nans Laborde-Jourdàa nous livre dans Boléro un conte sensuel et galvanisant sur un danseur retournant dans sa ville natale et provoquant une transhumance érotique et organique, au rythme du Boléro de Ravel. Queer Palm et Prix Canal + (Semaine de la Critique 2023) et maintenant nommé aux César 2024 dans la catégorie court-métrage de fiction, Boléro est un film inédit. Après avoir également réalisé les courts-métrages Looking for Reiko en 2017, qui narre l’errance d’un homme à Tokyo à la recherche d’une chanteuse des années 1970, et Léo la nuit en 2021, qui explore les liens complexes entre un père et son fils, Nans Laborde-Jourdàa se confie à Format Court sur son travail pluriel et versatile.

Format Court : Ça fait quoi d’être nommé aux César ?
Nans Laborde-Jourdàa : J’étais nommé l’année dernière pour Léo la nuit, et ça avait été une énorme surprise ! Je ne savais même pas qu’il y avait des prénominations. Avec Léo la nuit, tout était surprenant pour moi, car je découvrais aussi le milieu du court-métrage. C’est un film que j’avais fait très vite. Pour Boléro, il y a eu forcément un peu plus d’attente, mais c’est toujours une grande surprise de savoir qu’on est nommé. Aux César, il y a un éventail très large de cinémas représentés. Et les événements proposés par l’Académie permettent de se rencontrer entre nous. Les César représente à la fois peu et beaucoup de choses. Je viens d’une petite ville des Pyrénées et j’allais peu au cinéma quand j’étais jeune. Le seul lien que j’avais avec ce milieu, c’était les César. J’ai regardé longtemps une cérémonie qui récompensait des films que je ne voyais pas. Les César me renvoient à l’enfant en moi qui voulait être réalisateur.
Tu allais très peu de fois au cinéma. Comment t’es venue cette passion ?
NLJ : Quand j’étais enfant, c’est le théâtre qui m’a vraiment attrapé. Le cinéma est arrivé un peu plus tard au collège, et ça a été de vrais chocs esthétiques et de découvertes de mondes. À l’école, on est allé voir Rue Cases-Nègres d’Euzhan Palcy. J’ai vu que d’autres mondes existaient en dehors de ma petite ville, et j’y ai découvert la grammaire du cinéma. Cela ne m’a jamais vraiment quitté. Des films comme On connaît la chanson, que j’ai vu avec ma famille, m’ont vraiment marqué. A l’époque, j’avais une amie qui venait chez moi l’été, et qui était en option cinéma. Elle me donnait des VHS, comme Les Glaneurs et la Glaneuse d’Agnès Varda, et j’ai eu des vrais chocs, j’ai été physiquement renversé. Avec Pierrot le Fou, j’ai presque eu des orgasmes visuels, cela m’a ouvert un monde que je ne soupçonnais pas. Il y a eu un avant et un après. Et puis ça a été un moyen de quitter ma ville et de faire un bac cinéma à 15 ans. Après une fac à Bordeaux où les études ne me convenaient pas, je suis parti à Paris faire une école de théâtre sur un coup de tête. Je suis devenu comédien, metteur en scène, et j’ai monté ma compagnie de théâtre. Mais je ne me sentais pas légitime à l’idée de faire du cinéma.
Tu diriges la compagnie Toro-Toro. Dans Boléro et ton premier court-métrage Looking for Reiko, la danse et le théâtre ont une place très importante. Que permettent de dire ces médium ?
NLJ : Avec le théâtre, je me suis rendu compte que j’aimais des choses intimes, qui n’étaient pas dans une forme réaliste. Ça m’intéresse de comprendre comment par la stylisation, on arrive à recréer du réel. J’ai travaillé avec des générations d’artistes sortant comme moi du Conservatoire du 5e. J’y ai découvert l’écriture au plateau. Tout part d’improvisations proposées et cadrées par le metteur en scènes et où le comédien écrit lui-même sa propre partition. Il y a quelque chose de l’acteur-créateur, et depuis toujours, je ne me suis jamais senti acteur, mais plutôt créateur. C’est comme cela que j’ai commencé à travailler comme comédien. Aussi, au théâtre, on m’a souvent fait danser. Je pense que j’aurai voulu être danseur quand j’étais adolescent, et je ne me le suis pas autorisé. Mais la danse a perlé mon travail de théâtre, puis de cinéma. Bien sûr, les dialogues sont importants, mais avec le corps, on raconte beaucoup avec très peu.
Tu dis te sentir plus créateur qu’acteur, mais tu joues beaucoup dans tes propres courts-métrages. Comment se dirige-t-on comme acteur ?
NLJ : Ça a toujours été très fluide. Dans Looking for Reiko, je reprenais le pouvoir sur des choses qui me dépassaient. Àl’époque, j’avais développé un film sur un an, dont le tournage avait été annulé un mois avant. Looking for Reiko s’est créé en secousse à ça, avec l’idée de partir avec un téléphone et de filmer à l’autre bout du monde, avec mes propres ressources, où je me suis mis au centre du dispositif. Jouer dans Léo la nuit était une évidence, je filmais des gens que j’aimais et que je connaissais très bien pour certains. Le rapport qu’on avait dans la vraie vie m’intéressait, même si c’était une fiction. Je crois dans l’idée que les relations entre les individus, qui existent avant le tournage, permettent de dire des choses au spectateur au-delà du scénario, qui sont impalpables. Léo la nuit a été fait très vite, dans des conditions très précaires. Je pense qu’il a vécu grâce à ces vibrations entre les personnages.

Dans Léo la nuit, un homme doit s’occuper de son fils de huit ans qu’il n’a pas vu depuis longtemps. Qu’est-ce qui t’a intéressé dans le rapport assez inhabituel du père envers son fils ?
NLJ : On m’a proposé de faire une pièce dans un festival : j’ai commencé à écrire une pastorale pyrénéenne sur mon adolescence. Je faisais venir un enfant qui devait m’incarner alors que je jouais mon père. J’ai rencontré Cuysa [Cyusa Ruzindana Rukundo Marcou, l’acteur de Léo] et j’ai adoré sa créativité. Il y avait quelque chose de très vivant, et je trouvais qu’il me ressemblait, je me projetais en le voyant. Il n’a pas voulu joué dans la pièce finalement car il était trop intimidé par la rencontre avec le public mais quelques années après, j’ai réfléchi à l’histoire d’un père et de son fils qui ne se connaissaient pas vraiment et j’ai pensé à Cuysa. Il a d’abord refusé puis accepté de jouer dans un film. J’aimais comment les choses circulaient entre nous. Léo la nuit est venu de questions sur l’amour, la famille qu’on a, celle qu’on s’invente, les enfants qu’on a, ou qu’on a pas… De base, cela devait être une série de courts-métrages. Finalement, j’ai tellement aimé filmer et monter Léo la nuit, que je n’ai pas eu besoin de continuer à développer cette relation-là, même si je voudrais beaucoup rejouer avec Cuysa et avec tous les acteurs du film.
Comment dirige-t-on un enfant ?
NLJ : C’est très surprenant. J’avais tout le temps peur qu’il veuille arrêter de jouer, ce que j’aurais compris. Mais j’ai beaucoup parlé avec lui, je lui ai fait rencontrer l’équipe. Il n’avait pas le scénario, il n’était pas au courant de choses qui auraient pu être traumatisantes. Je lui disais le dialogue une fois, et il l’apprenait immédiatement, c’en était presque déstabilisant. Travailler avec lui, et les autres, était un plaisir. Il y a avait une sorte de fluidité avec les comédiens et l’équipe technique, en laquelle j’avais confiance.
Tes personnages sont souvent caractérisés par une instabilité, et se définissent par leurs interactions avec les autres. Même s’ils ont une vie inhabituelle, on s’y identifie. Comment écris-tu tes personnages ?
NLJ : Mes personnages se définissent vraiment dans leur contexte avec l’autre. C’est pour cela que je les ai joués moi-même. On m’a souvent proposé comme comédien des rôles définis par les autres, comme un passeur. C’est très déstabilisant et désagréable à jouer. En tant que comédien, ça me dérange de me dire qu’on est seulement révélé par les autres. Mais le jouer personnellement, savoir ce que le personnage veut, me plaisait. J’ai un goût pour l’errance, je veux assumer un goût de l’indécision. On est dans une époque où il faut être offensif, savoir ce qu’on veut, le faire vite. Par mon cinéma, je veux dire l’inverse. On peut hésiter, ne pas savoir, et se réapproprier son rythme.

Boléro contraste avec Léo la nuit et Looking for Reiko, notamment en termes de rythme. Comment as-tu réfléchi à cette lenteur, cette indécision ?
NLJ : Dans le début de Boléro, il s’agit d’un homme qui rentre chez lui, et qui erre. Je voulais créer une expérience sensitive, courte, qui durait le temps du Boléro [de Ravel]. Mon personnage retourne dans des paysages qu’il connaît, avec des gens qu’il connaît, où tout semble fantomatique. Au-delà de comprendre le côté queer, le spectateur doit pouvoir faire l’expérience d’un rythme lent, comme j’ai pu m’ennuyer dans les Pyrénnées de mon adolescence. Je ne voulais pas seulement le dire mais aussi que le spectateur se perde dans cette expérience.
En effet, la deuxième partie développe un érotisme très organique.
NLJ : Oui, le personnage principal refait surgir des figures du passé, mais aussi des figures violentes, qui le renvoient à la condition de jeune homosexuel, qui doit se construire dans la marge. Parce qu’on est invisibilisé, on rencontre des gens qui peuvent nous faire du mal, comme il rencontre cet ancien professeur avec qui une chose a dérapé. Pour moi, c’était comme aller au bout du chemin, et décider que cette errance était finie. Mais je ne voulais pas que ce soit négatif, ni trop sexuel. Le protagoniste veut danser pour réenchanter les choses, et montrer comment par l’art, on parvient à transgresser les normes et à rassembler les gens par le biais du groupe.
Il y a quelque chose de l’ordre du Sublime à la fin de Boléro, où le personnage finit par transcender son individualité pour devenir un symbole.
NLJ : Le personnage est plein de blessures, et d’une rage à l’intérieur de lui qu’il exprime par la danse, qui connecte tous les membres de ce petit village. Il rappelle la solitude et le besoin d’être ensemble. Il montre comment on parvient à faire groupe et à réinventer les choses, à se réapproprier ce monde dans lequel on vit, fragmenté et capitaliste. Dans une société où l’on est déshumanisé, je voulais montrer comment on réinvente des récits ensemble. Je voulais le mettre en scène dans une manière simple et épurée, comme un petit conte inoffensif et porteur d’une révolution.

As-tu l’impression qu’on a donné de la visibilité à ceux qui étaient invisibilisés ?
NLJ : Ça dépend. J’évolue dans une grande ville, je pense que les choses ont changé pour des gens plus jeunes que moi. Le rapport a changé, ici ou dans des zones plus reculées. Ce que j’ai vécu n’est pas la même chose que ce que vit un jeune aujourd’hui. Les mentalités ont évolué, mais la violence est toujours présente et s’est déplacée. C’est une violence de minorités, et une violence de classes.
Tu as reçu la Queer Palm et le prix Canal + à Cannes, et Boléro est maintenant nommé aux César 2024. Comment le film a-t-il été accueilli autour de toi ?
NLJ : Ça a commencé directement avec Cannes, et le retour des gens a été très chaleureux, j’ai reçu beaucoup d’amour, alors que je m’attendais à quelque chose de très dur. Et puis il y a eu la projection du film dans les Pyrénées. Montrer le film dans ma ville natale m’angoissait autant que de le montrer à Cannes. Lorsque je suis arrivé à Oloron, je m’attendais à une trentaine de personnes. Mais petit à petit, des centaines et des centaines de personnes sont venues ! Il y a eu beaucoup d’articles, mais les gens n’avaient pas vu le film. Je me disais qu’ils allaient tomber des nues, que ça allait mal se passer. Mais les retours ont été tellement chaleureux, c’était une très belle projection. Avant le tournage, j’avais très peur de comment Fran [François Chaignaud, acteur.ice principal.e de Boléro] allait être intégré.e dans ma ville natale, ce que les gens allaient dire. En fait, il y eut une communion à tous points de vue. Pour moi, même si le film n’allait jamais être montré en festival, l’expérience collective et cette réconciliation me suffisaient.
As-tu des projets pour le futur ?
NLJ : Je suis en train d’écrire un long-métrage depuis quelques mois. Ce sont de nouveaux contes queers contemporains autour de la question de l’amour et de la folie amoureuse. J’aimerais aussi refaire des courts-métrages, c’est un format que j’aime et que je n’ai pas encore exploité complètement. Avec le long-métrage, il faut tenir sur une heure et demie, et il y a des enjeux économiques. C’est un monde différent que je découvre petit à petit. En s’entourant de bonnes personnes, il faut réussir à faire précisément le projet qu’on a en tête, et rester près de ses envies.
Propos recueillis par Mona Affholder
Article associé : la critique du film