Il y a 10 ans, nous faisions la connaissance d’une animatrice brésilienne engagée, solaire et indépendante : Rosana Urbes. Elle avait réalisé Guida, un premier court magnifique sur la représentation du corps féminin et vieillissant qui avait obtenu au Festival d’Annecy une Mention spéciale du jury Fipresci et le Prix « Jean-Luc Xiberras » de la première œuvre. Rosana Urbes est revenue entre temps deux fois à Annecy, une fois, en 2018, lorsque le Brésil était le pays invité et cette année pour y présenter son nouveau et deuxième court, Sappho. Le film a reçu sa toute première récompense, le Prix Alexeïeff-Parker, à Annecy et vient d’être projeté au Forum des images, à Paris. À l’occasion de cet entretien, la réalisatrice revient sur son parcours, les défis de l’animation au Brésil, son rapport aux femmes artistes, l’évolution de son travail et son lien à Sappho, une poétesse effacée de la mémoire collective, qu’elle a réhabilité le temps d’un film personnel, féminin et sensible.

Format Court : À l’époque de notre premier échange, en 2015, tu disais que l’industrie de l’animation brésilienne était en plein essor. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Rosana Urbes : Les choses ont un peu décliné. Le changement de gouvernement a fortement réduit le soutien à la production cinématographique et d’animation. Les gros investissements vont surtout vers l’industrie – séries, jeux vidéo… Les aides aux courts-métrages sont devenues très rares.
Pourquoi n’y a-t-il pas de réelle culture du film d’animation au Brésil ?
R.U. : L’animation y est encore jeune, elle date d’à peine deux décennies. Elle est perçue comme un outil pour développer des séries ou des concepts, pas encore comme un art autonome comme en Europe. Il y a eu quelques films réalisés héroïquement, mais c’est récent. Les festivals locaux d’animation commencent à se structurer.
Le Festival Anima Mundi de Rio de Janeiro et São Paulo a pourtant disparu de la carte des festivals mondiaux.
R.U. : Oui, c’était le deuxième plus grand festival d’animation au monde. Il a formé une génération entière, mais le manque de soutiens, surtout après le gouvernement Bolsonaro, l’a fait disparaître. Tout le monde ne perçoit pas la valeur culturelle de l’animation.
Tu as eu une expérience importante chez Disney avant de te lancer dans tes propres films. Comment cela a-t-il influencé ton parcours ?
R.U. : Disney a été ma grande école. J’y ai appris toutes les étapes de production. J’ai travaillé sur Mulan, Tarzan, Lilo & Stitch… Mais à un moment, j’ai voulu raconter mes propres histoires alors j’ai quitté Disney pour devenir autrice. Un moment très important dans ma carrière a été quand j’ai commencé à développer mon propre style artistique. Avant, je faisais beaucoup de travaux commerciaux, donc j’ai appris plein de styles différents, mais pas le mien. Et au début, mes références étaient surtout des artistes hommes, que j’admire. Mais quand j’ai commencé à découvrir le travail d’artistes femmes, j’ai senti une connexion plus profonde, presque inconsciente. C’était plus que de l’admiration : je me sentais en lien. Je pense à Joanna Quinn, ou à l’illustratrice autrichienne Lisbeth Zwerger. Leur travail m’a donné confiance.
Pourquoi ?
R.U. : Parce que leur approche me semblait accessible, proche de moi. Je n’ai jamais eu envie de dessiner Batman ou des super héros, comme mes amis garçons. La façon qu’avaient les femmes de traiter certains sujets me parlait. Ça m’a permis de me dire : « Moi aussi, je peux tenter quelque chose ».
J’ai aussi lu un livre, The Great Cosmic Mother, de Monica Sjöö, qui parle du patriarcat et de la société. Ça m’a beaucoup éclairée. J’ai réalisé que mon insécurité ne venait pas seulement de moi, mais d’un contexte plus large. En tant qu’artiste, on est déjà souvent dans le doute, mais quand on est une femme artiste, c’est encore plus fort. J’ai vu ça chez beaucoup de mes collègues. Je me remettais constamment en question. Mais avec Sappho, j’ai eu l’impression de contribuer à une sorte d’archéologie de l’imaginaire féminin. C’était une façon de reconstituer, petit à petit, une histoire fragmentée des femmes artistes dans le monde. Sappho, pour moi, c’est une artiste-ancêtre. En parlant d’elle, je voulais ajouter une pièce à ce puzzle, pour donner envie à d’autres d’aller chercher d’autres femmes oubliées. On en connaît quelques-unes, mais souvent, elles ont pu publier ou exposer en signant avec un nom d’homme. C’est une constante.
Qui sait qui on découvrira encore ? La place des femmes dans la société évolue très vite. Si on pense que le droit de vote est récent, et qu’aujourd’hui on prend peu à peu notre place, c’est un mouvement exponentiel. Et je crois que c’est bénéfique pour toute la société. Un monde déséquilibré ne peut pas fonctionner pleinement. Le féminisme, pour moi, c’est d’abord une question d’équilibre, d’égalité. Et ça touche aussi à la création et à l’imaginaire. Je parle d’un principe féminin qui existe en chacun de nous, pas seulement chez les femmes. C’est le principe qui crée, qui prend soin, qui maintient la vie. Et quand je dis « vie », je parle aussi de la vie intérieure, de l’imaginaire, de la création artistique. Pas seulement des enfants.
Que représente Annecy pour toi ?
R.U. : C’est un moment déterminant. Être sélectionnée ici avec Guida a eu un impact énorme sur ma carrière d’autrice indépendante. J’ai voyagé 3 ans sans arrêt grâce à ce film. Annecy m’a offert une visibilité que je n’aurais jamais eue au Brésil. C’est grâce à ça que j’ai obtenu un financement pour Sapho.
Justement, pourquoi avoir mis autant de temps entre les deux projets ?
R.U. : C’était un long processus. L’argent a été utilisé la première année. J’ai travaillé comme freelance pour financer le film moi-même. Ce n’était pas possible de le produire en continu. Je devais m’arrêter, faire d’autres projets, puis revenir sur Sapho.
Qu’est-ce qui t’a poussée à faire un film sur Sapho ?
R.U. : Je travaillais sur un livre. En découvrant Sapho, j’ai été fascinée. C’était une poétesse que je ne connaissais pas. J’ai réalisé qu’il y avait de la matière pour un film. Mais j’ai dû m’y reprendre à trois fois pour obtenir un financement, malgré le succès de Guida. Puis, il y a eu la pandémie. La production a été ralentie, mais on a tenu bon. C’était un long voyage, mais j’en suis fière.
Le film réunit des fleurs, des poèmes, des peintures, des croquis, des images sur ordinateurs. Tu avais besoin de chercher dans plusieurs directions ?
R.U. : Oui, le court-métrage permet d’expérimenter. Je voulais aller plus loin, ne pas me répéter. Même si ça prend plus de temps, c’est enrichissant. C’est un défi personnel. Pour moi, c’est comme chanter en solo, alors que travailler sur des séries, c’est comme chanter dans un chœur.

Avais-tu besoin de te challenger toi-même ? Ton film fait 12 minutes, il aurait pu en faire moins, juste pour que tu le finisses plus tôt. D’où vient ta motivation ?
R.U. : Quand j’ai commencé Sapho, et en particulier après le début de la pandémie, j’ai compris que je ne pourrais pas avoir une équipe avec moi pour répartir le travail. J’ai travaillé seule pendant deux ans. J’ai senti que j’en avais enfin l’opportunité de faire un film d’animation expérimental. J’avais une table multiplane construite, et cette technique offre une infinité de possibilités — on peut y poser toutes sortes de matériaux, les étaler sur les couches de verre et créer des esthétiques, des univers… De plus, sur le plan conceptuel, Sapho s’y prêtait. Je partais de fragments. Ma difficulté, c’est que je ne créais pas quelque chose de purement inventé. Je devais traiter un héritage historique, et cela m’a paru essentiel de faire savoir que Sapho avait réellement existé, qu’il y avait eu une femme poète il y a 600 ans, ce qui est quand même très rare.
Certes, on a retrouvé des papyrus d’autres femmes poètes, mais Sapho a laissé un savoir très riche, comparable à celui d’Homère. Son visage figurait même sur des pièces de monnaie ! Elle était très célèbre dans l’Antiquité. Et pourtant, l’Histoire s’est arrangée pour l’effacer. C’est d’une violence inouïe. Une violence que j’ai vue se refléter dans les vies de beaucoup d’artistes femmes que j’ai admirées, et dont le travail n’a pas été reconnu ou préservé. En racontant Sapho, je racontais aussi l’histoire de toutes ces femmes artistes oubliées.
On parle de fragments, mais aussi de toutes les relectures faites à travers les siècles. On a romancé sa vie, sa sexualité… Sapho est devenue une figure multiple. J’ai donc travaillé avec plusieurs techniques d’animation pour traduire cette diversité d’interprétations. Je disposais de ces fragments de poèmes d’une beauté littéraire incroyable, mais autour d’eux, il y avait tout ce qu’on ne saura jamais. Cette perte, cette absence, je voulais aussi la faire ressentir visuellement. On sait que ses œuvres ont été brûlées à la bibliothèque d’Alexandrie. On a aussi découvert que certaines traductions modernes trahissaient son style poétique. Il y a eu tant de formes d’effacement, et en même temps, ses textes sont pleins de délicatesse, de douceur, d’amour. Cette contradiction, je devais la porter dans le film.
C’est intéressant, cette idée d’effacement. Peux-tu m’en dire plus ?
R.U. : Dans certaines parties du film, j’ai utilisé du charbon, car je n’arrivais pas à construire une image complète de Sapho. Chaque fois que je la dessinais entièrement, ça sonnait faux. C’est comme si l’effacement historique m’empêchait de la représenter pleinement. Alors j’ai imaginé une scène où elle se dessine elle-même. C’est elle qui anime, qui peint son propre corps C’est une sorte de dialogue schizophrénique entre moi et elle. Et ce qui est fou, c’est que j’ai animé d’abord, puis intégré les fragments de poèmes. Et parfois, ça collait parfaitement, presque magiquement.
Ce travail, c’est aussi de l’archéologie de la mémoire féminine. À un moment, ma thérapeute (que j’ai d’ailleurs créditée au générique) m’a dit : « Tu t’acharnes à vouloir clôturer quelque chose qui n’a pas de fin ». Et c’est là que j’ai compris : Sapho est un film fait de fragments, et c’est cohérent avec son sujet. Je voulais à la fois transmettre la douceur de ses mots et la violence de son effacement. Dans Une chambre à soi, Virginia Woolf explique que les premières femmes autrices connues n’apparaissent qu’au XIXe siècle. Sapho, elle, vivait 600 ans avant Jésus-Christ ! Elle est une exception précieuse dans 5000 ans d’histoire littéraire. Là, je me suis rendu compte que Sapho, ce n’était pas juste une poétesse. C’était une pièce manquante dans l’histoire de l’art féminin. Mon film, c’est une tentative de contribution à cette mémoire.
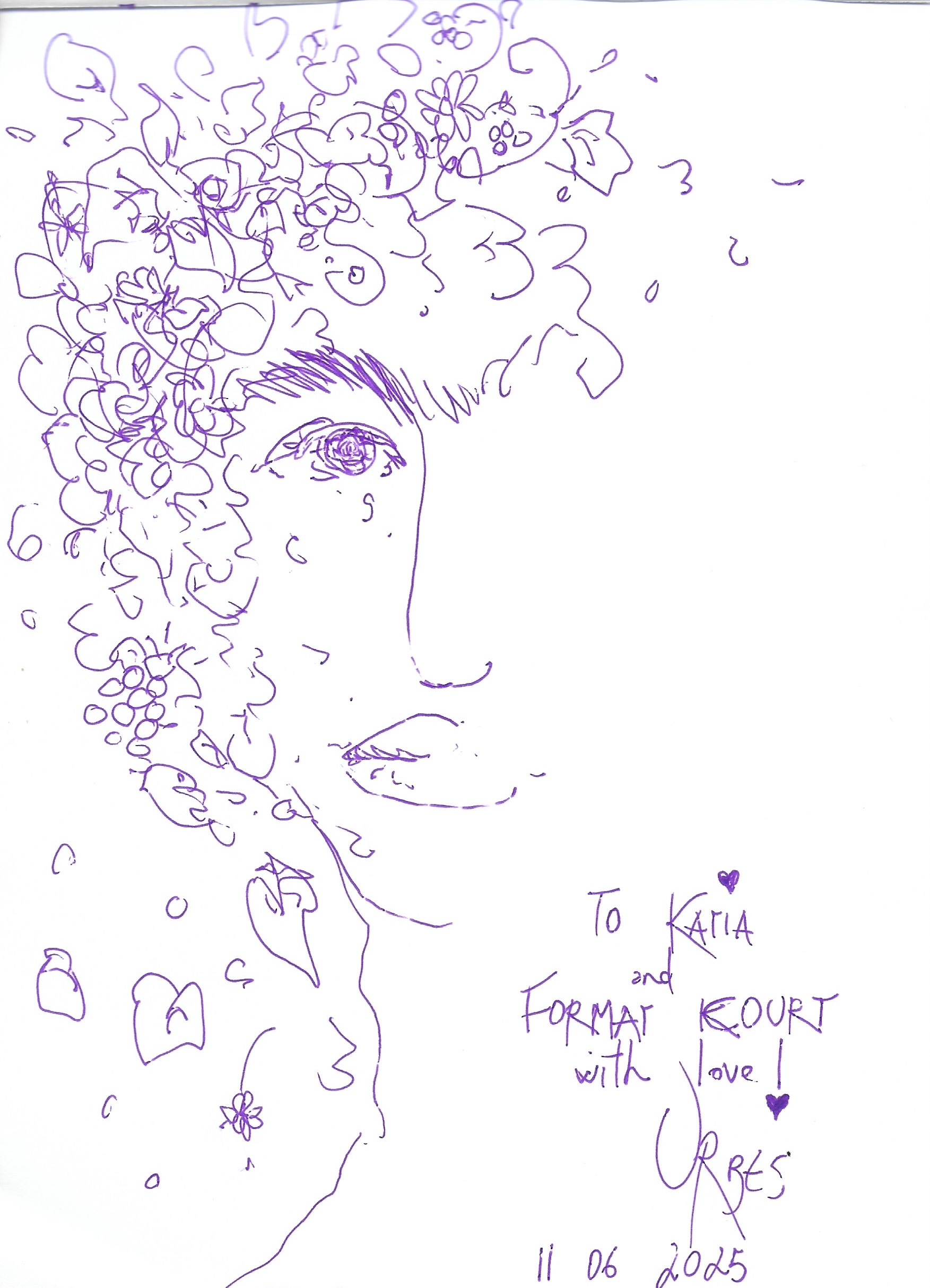
Représenter une figure pareille, l’imaginer sans jamais avoir pu la rencontrer, c’est une sacrée responsabilité, non ?
R.U. : C’est une très belle question. Avec Guida, on était en terrain connu : c’est une création. Le dessin est plus affirmé, plus libre. J’ai pu complètement inventer l’apparence de mon personnage. Mais pour Sapho, oui, il n’y a pas de photographie, évidemment. Certes, il y a eu beaucoup de représentations artistiques d’elle à travers l’histoire : sur des pièces de monnaie, des vases antiques, des peintures, puis plus tard des sculptures. Beaucoup de peintres l’ont peinte dont Gustave Klimt. Chacun avait sa propre version évidemment car personne ne l’a vue.
J’ai rempli 10 carnets de croquis sur elle, ils apparaissent au générique du film, j’ai lu tous les livres disponibles sur elle. Pour l’animation, ça a été un défi, ce n’était pas confortable de l’animer, de lui donner de l’intention. Quand j’ai commencé à choisir le charbon, les objets fragiles comme les feuilles et les fleurs à animer, j’ai senti que les matériaux pourraient m’aider pour parler d’une chose importante : sa disposition de l’imagination du monde. Je ne voulais pas être voyeuriste. C’était une artiste complète : elle jouait de la lyre, composait, composait des poèmes. L’intention, c’était de parler de sa disparition totale de l’histoire.
Dans ton film, il n’y a pas une narration classique avec un début, un milieu, une fin. C’est plus impressionniste, presque comme un poème visuel. Est-ce que c’était une volonté dès le départ ?
R.U. : Oui, complètement. Je ne voulais pas raconter une histoire au sens traditionnel. Je voulais évoquer des sensations, des souvenirs, des états intérieurs. C’est pour ça qu’il n’y a pas vraiment de linéarité. C’est une sorte de flux, comme une mémoire qui revient par fragments. J’ai beaucoup écrit pendant le processus. Pas pour faire un scénario, mais pour capter des impressions, des phrases, des idées. Et ensuite, j’ai cherché à traduire ça en images et en sons.
Dans ton film, il y a une attention au geste, au souffle. Est-ce que c’est quelque chose que tu pratiques consciemment ?
R.U. : Oui, complètement. L’observation du mouvement, c’est une pratique de base en animation. On apprend à regarder : comment une personne se lève, comment elle respire, comment un bras tombe. Et ça m’a beaucoup formée. J’ai aussi étudié la danse, donc j’ai toujours eu cette conscience du corps, du mouvement, de l’élan intérieur. Je pense que ça influence beaucoup mon travail : je pars souvent d’un mouvement intérieur que j’essaie de traduire en animation. Pas juste en bougeant des formes, mais en transmettant un sentiment à travers le mouvement.
C’est très perceptible dans le film : parfois, on sent qu’un geste contient toute une émotion, toute une mémoire.
R.U. : Oui, parce que le dessin animé permet ça. C’est un médium magique : on peut condenser une sensation dans un mouvement simple. Et quand on travaille en animation traditionnelle, image par image, on passe tellement de temps sur chaque seconde que forcément, on y met quelque chose de nous. C’est comme si chaque image portait une charge affective. Ce n’est pas que technique. C’est très incarné.
Et comment s’est passée la construction du film, justement ? Tu avais un storyboard, ou c’était plus intuitif ?
R.U. : C’était très intuitif. J’ai fait un peu de storyboard, mais surtout pour me repérer. Ce n’était pas un plan rigide. J’ai surtout laissé le film se construire au fur et à mesure, en animant, en testant des choses, en suivant mon instinct. C’était un travail très organique. Et parfois, certaines scènes naissaient d’un son, d’une musique, ou d’une sensation corporelle. Il y a eu beaucoup d’aller-retours entre le dessin, le son, le rythme.

Le film est très intime. Il touche à quelque chose de très personnel, mais sans jamais tomber dans le pathos ou l’explicite. Comment tu as travaillé cette frontière-là ?
R.U. : C’était un équilibre très délicat. Je voulais que ce soit intime, oui, mais pas impudique. Il fallait que je sois sincère, mais en laissant aussi de la place au spectateur. Que chacun puisse projeter ses propres émotions, ses propres souvenirs. Donc j’ai beaucoup travaillé par l’évocation, par le flou, par le silence parfois. Je ne voulais pas tout montrer ni tout expliquer. C’est pour ça que le son a été si important.
Justement, le travail sonore est très riche. Il y a des bruits de respiration, des craquements,… Comment tu as construit cette matière-là ?
R.U. : C’est un travail que j’ai fait en parallèle de l’image. Parfois même avant. J’ai enregistré plein de sons moi-même : ma respiration, des bruits d’ambiance, des objets. Je voulais que le son soit presque tactile, qu’il rentre dans le corps. Et puis il y a eu tout un travail de traitement, de montage, de superposition. Le son participe au rythme, à la narration intérieure. Il fait exister des choses qu’on ne voit pas à l’écran.
Guida a été montré dans de nombreux festivals. As-tu reçu des retours qui t’ont particulièrement touchée ?
R.U. : Oui, beaucoup. Ce qui m’a le plus touchée, c’est quand des gens sont venus me dire qu’ils s’étaient sentis compris, que le film avait mis des mots — ou des images — sur quelque chose qu’ils n’avaient jamais réussi à exprimer. Et c’était des personnes très différentes. Certain·es avaient vécu des choses similaires, d’autres pas du tout, mais il y avait une forme d’écho émotionnel. C’est là que je me suis dit que j’avais réussi à créer un espace sensible, un espace de partage.
Tu as envie de continuer dans cette veine-là pour tes prochains projets ?
R.U. : Oui, je pense que c’est ce que je cherche : créer des films qui soient à la fois très personnels et très ouverts. Je travaille déjà sur un nouveau projet, toujours dans une forme hybride, entre documentaire, fiction et poésie.
Propos recueillis par Katia Bayer
Article associé : notre reportage sur nos coups de cœur d’Annecy














































