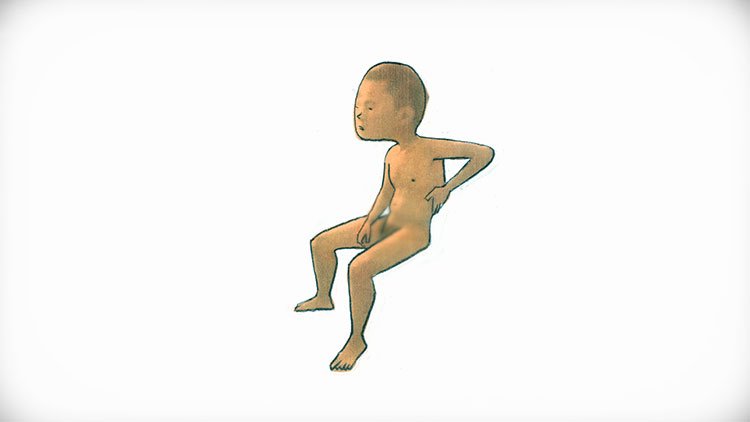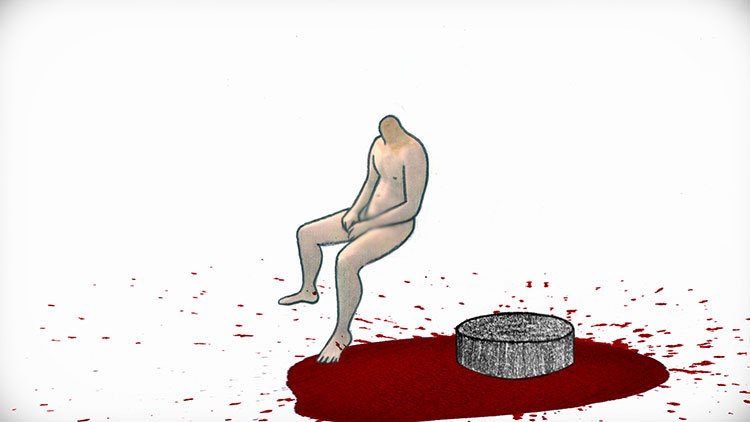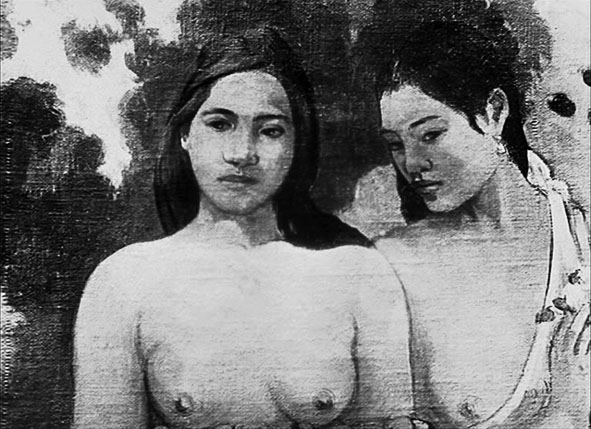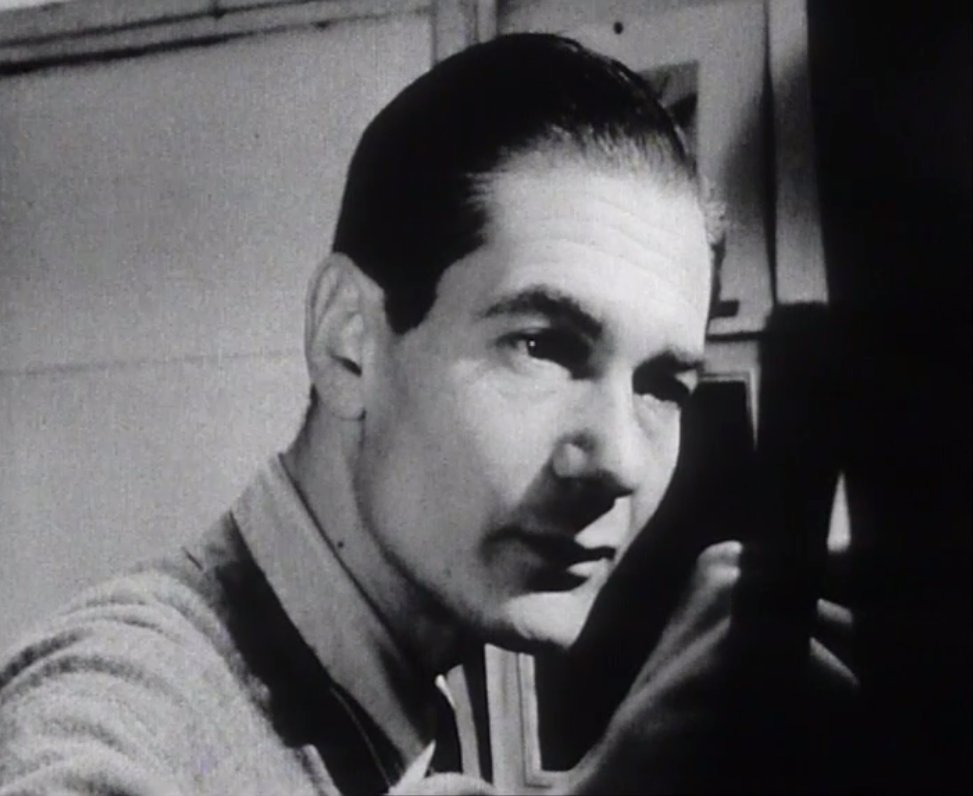Au festival Côté Court de Pantin, le programme 5 de la compétition fiction regroupait quatre courts métrages réunis a priori pour leur propension à inscrire leurs récits dans le cadre champêtre de la province française. Des volutes brumeuses enveloppant les pics des montagnes filmées en plans larges (récurrents dans les films de la sélection) aux enceintes des petits villages chargés de folklore et de légendes, la province filmée par les cinéastes de ce programme se faisait le berceau des rêves, des révoltes ou des miracles.
Devenu quasiment un sous-genre dans la production de courts métrages français, le film-province ou film-de-campagne invite ses personnages à partir en quête d’exils, d’aventures, à emprunter des chemins escarpés pour revenir aux sources. Si les films composant cette sélection ne dérogent sensiblement pas à cette règle du genre, ils invitent néanmoins à prolonger cette réflexion et à l’étendre au processus même de fabrication : comment les auteurs de ces courts métrages appréhendent leurs récits, les possibilités de la fiction et ses glissements de terrains, aussi bien narratifs que formels ?

Le premier film du programme, « Au vent » réalisé par Vincent Tricon, ancien étudiant en montage à la Fémis, constitue une belle entrée en matière. Le jeune cinéaste a exhumé de sa banque d’images les rushs d’un précédent projet mené au sein de l’école et a entrepris de les monter, composant ainsi un étrange court métrage dont le résultat relève d’avantage de l’essai que de la fiction pure.
Le film s’ouvre sur des plans aériens rasant des décors de plaines tandis que s’inscrivent à l’écran quelques sous-titres posant sommairement le cadre de l’action : un jeune homme se remémore un hiver passé à la campagne en compagnie de sa sœur et de leur meilleur ami, l’intimité qu’ils partagèrent et l’instant de bascule qui troubla cette douce harmonie. La narration éclatée procède par une irruption de flashs impressionnistes pour constituer un semblant de cadre, quelques repaires donnés par l’agencement de courtes scènes de vie (jeux dans la nature, confidences échangées à une terrasse de café) en un fil narratif très ténu.

Ces partis pris formels – que l’on imagine aussi bien imposés par la matière dont disposait le cinéaste que par ses intuitions au moment du montage – déplacent l’intérêt du film en réduisant les enjeux du récit de fiction au strict minimum, les figures se mouvant sur l’écran ayant à peine le temps de devenir des personnages. Le film tire sa force et sa singularité de sa capacité à accueillir des images de natures diverses, à faire surgir dans son montage des instantanés a priori déconnectés du récit. Ainsi, lorsque s’insère dans la narration un plan large filmant un troupeau de moutons tournant leur regard vers l’objectif de la caméra, l’on est saisi par la beauté du plan et convaincu qu’il a parfaitement sa place. Les images glanées par Vincent Tricon portent en elles le souvenir d’un tournage peut-être plus émouvant que la fiction recomposée.
Le prologue de « Madeleine et les deux apaches », projeté en quatrième position du programme, semble répondre au film de Vincent Tricon. Un montage de rushes filmés en vidéo restitue la journée d’une famille en vacance, moment saisi par la Madeleine du titre, étrange grand-mère bienveillante dont la seule présence passe par la voix douce et reconnaissable entre toutes de la comédienne Marie Rivière. La caméra s’attarde longuement sur Myrtille, la petite-fille de Madeleine dont elle enregistre les jeux d’enfants qui sont autant de signes annonçant le récit de fiction à venir (le costume d’indien qu’elle enfile, le titre de variété qu’elle chante à capella). Vers la fin du prologue, Myrtille demande à sa grand-mère : « Pourquoi tu ne regardes jamais les images que tu filmes ? Comme cela, tu saurais si ce que tu as filmé est beau !». Cette réflexion contient en germe la principale question que pose le cinéma de Christelle Lheureux : à quel moment décide-t-on de croire à ce que l’on voit, de faire aveuglément confiance à notre seul regard, que l’on soit créateur ou spectateur ?

Passé ce très beau prologue, certainement la partie la plus émouvante du film, Lheureux développe une fiction et filme Myrtille devenue adulte, incarnée par Clémentine Beaugrand. Celle-ci confie, au réveil, un rêve qu’elle vient de faire à son amoureux (Thomas Blanchard). Le récit du film prend alors la forme d’une promenade dans l’univers onirique de Myrtille où elle guide son amoureux et le spectateur à travers différents décors, remontant le fil de sa mémoire et composant progressivement un portrait de l’énigmatique Madeleine. Ce dispositif permet à la cinéaste de procéder elle aussi par digressions pour construire son récit, reproduisant ainsi la forme décousue que prennent les rêves.
Si dans « La Maladie blanche », le précédent opus de Lheureux (lauréate du Prix Format Court au Festival de Vendôme en 2012), nous suivions un sanglier jusque dans une grotte où la découverte de peintures rupestres raisonnait avec la réflexion que menait le film autour des origines du langage, c’est en poursuivant dans « Madeleine » une balle de ping-pong dans un tunnel que l’on remonte aux origines du cinéma, assis dans une salle face à un film muet de Louise Brooks. Christelle Lheureux parvient à nous surprendre en usant délibérément de l’artifice, comme un magicien qui n’hésiterait pas à expliquer les secrets de ses tours de passe-passe en même temps qu’il les exécute. Le pacte de la fiction ainsi renouvelé remet le spectateur fasse à sa propre croyance et l’invite à élargir le cadre de ses perceptions.
Aux antipodes, le film « Poisson » de Aurélien Vernhes-Lermusiaux échoue à remporter notre adhésion. Le film fait le récit du périple entrepris sur les routes de campagne par une mère et ses deux jeunes enfants à la suite de la mort de leur père, ponctué par quelques rencontres insolites et les manifestations d’étranges phénomènes. L’ennui, c’est que chaque péripétie, chaque glissement de terrain dans ce « Poisson » se heurte à un encombrant souci de « bien faire » de la part du réalisateur, soucieux de trouver le juste dosage entre chaque élément qui compose son film jusqu’à figer l’ensemble dans une espèce de carte postale décorative et désincarnée. Ainsi, le casting (trop) bien élaboré réunissant les talentueux Adélaïde Leroux, Samir Guesmi et Nathalie Boutefeu ne parvient pas à transcender un scénario surécrit dans lequel chaque dialogue, chaque intention est surlignée et coûte cher à l’interprétation des comédiens. Lorsque la mère explique la mort à son fils d’une voix blanche en disant que « papa était tout cassé à l’intérieur et que les médecins n’ont pas pu le réparer », on souffre grandement pour Leroux.
À ce souci d’explicitation outrancier, s’ajoute une manie pour l’échantillonnage de scènes « tendances », symptomatiques du court métrage français : la drague inoffensive en mode provoc’ entre adultes qui se comprennent, une séquence documentaire où des « vrais gens » découpent la « vraie viande » d’un « vrai cochon »,…
Le film avance tranquillement sur ses rails, tant et si bien que lorsque la chute survient, son caractère fantastique amuse plus qu’il ne surprend. Vernhes-Lermusiaux a tellement bien préparé le terrain que son miracle final n’émeut pas et laisse flotter une odeur de pétard mouillé.

Terminons avec un film de mauvais élève réjouissant, foutraque qui nous donne des nouvelles de l’une des plus stimulantes jeunes pousses du cinéma français : Frédéric Bayer-Azem, auteur des courts métrages « Les Ficelles » et « Pan » venu présenter « Géronimo », son petit dernier pour la première fois en compétition à Pantin. Comme dans ses précédentes réalisations, Bayer-Azem ouvre son film par un coup de dé fictionnel, un postulat improbable auquel il faut adhérer. Ici, un groupe de parisiens branchés débarquent dans un petit village de province pour y mettre le souk, faire du bruit et surtout investir la fête foraine, perturbant ainsi les bandes d’enfants venus s’amuser tranquillement.
Passé les premières scènes semblant établir une dichotomie un peu rapide entre les adultes et les enfants, les parisiens et les provinciaux (lorsque la bande attaque une parade costumée défilant à travers le village à grand renfort de gestes et de paroles obscènes), le rythme s’emballe, le montage éclate la narration et le film mute vers une forme plus surprenante et abstraite. Dès lors que les parisiens investissent l’attraction phare de la fête foraine, à savoir le stand d’autos-tamponneuses, le film se met à fonctionner comme une centrifugeuse, brassant violemment toutes les images dans un tourbillon furieux et insaisissable.

À l’instar des véhicules colorés pilotés par les protagonistes, les plans s’entrechoquent, surgissent de nulle part et font dévier en permanence nos attentes de spectateurs. Chaque saillie comique se teinte d’un sentiment d’inquiétude, d’une violence latente s’apprêtant à éclater au milieu de ces jeux d’enfants. L’intervention d’un tiers personnage, le jeune et fringuant Géronimo, indien mutique passé maître dans la conduite d’auto-tamponneuse, sera l’incident déclencheur qui sonnera la fin des hostilités. Au milieu de cette nouvelle communauté constituée d’enfants et d’adultes originaires de multiples ethnies (blancs, noirs, arabes, juifs…), se rejouent les enjeux libéraux du monde occidental, où ceux qui ont l’argent (les jetons) mènent la danse et imposent leur régime.
La dimension politique du film de Bayer-Azem devient progressivement acide et tranchante à mesure que les tensions apparaissent entre la bande de parisiens et le jeune apache venu perturber leur manège. Son exclusion est inévitable, et le couperet tombe violemment lorsque le groupe isole l’Indien avant de le dégommer au volant de leurs autos-tamponneuses. Difficile de ne pas deviner, à la vision de cette rixe fantasmée, la douleur et la colère légitime d’un cinéaste qui parvient à sublimer son regard par les moyens du cinéma.
Au détour de l’un des dialogues savoureux du film, un des parisiens échange quelques réflexions avec un enfant noir alors qu’il désigne une des filles de la bande : «Un soleil, Caroline ! Elle libère les gens !». Et l’enfant de rétorquer : «Moi, je me libère tout seul.» Frédéric Bayer-Azem s’est libéré depuis longtemps et poursuit sa route chaotique vers un horizon cinématographique inconnu. Nous le suivrons pas à pas.