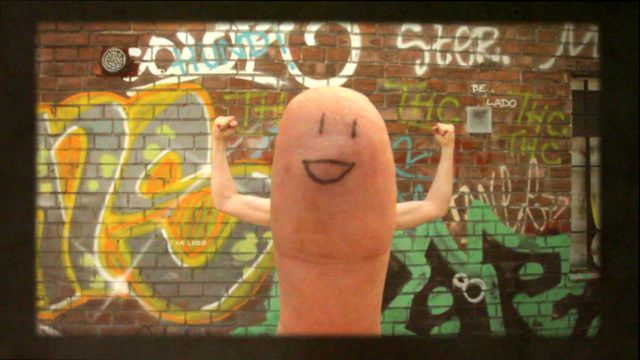Ancien du Fresnoy, Giacomo Abbruzzese a voyagé dans un sens comme dans l’autre avant de poser ses valises à Paris, il y a quelques années. Auteur de plusieurs courts, il a réalisé « Stella Maris », un film qui nous a beaucoup intéressés à Brest et à Villeurbanne (où il a eu une Mention spéciale du Jury Format Court). Au début de l’année, nous l’avons rencontré pour un long entretien aux abords du Canal St-Martin. Au cours de cette discussion, le réalisateur italien est revenu sur son parcours, ses envies de cinéma politique, son goût pour les personnages étrangers et les récits épiques, son travail avec les acteurs ainsi que son intérêt pour la prise de risques et l’inattendu.

Format Court : Tu es italien, tu vis en France depuis cinq ans. Ces dernières années, à fois que tu as tourné un film, tu l’as fait dans un pays différent, mais avec une production française. « Archipel » a été tourné en Israël et Palestine, « Stella Maris » et « Fireworks » se sont faits en Italie, « This is a Way » a été réalisé aux Pays-Bas. Qu’est-ce qui te donne envie d’aller tourner dans des pays différents ? Penses-tu qu’un jour, tu tourneras en France ?
Giacomo Abbruzzese : J’ai besoin d’un peu plus de temps pour tourner les films que je voudrais faire en France. J’ai un rapport très fort à ce pays. J’aime beaucoup le cinéma français des années 60- 70 ; la nouvelle vague m’a formé autant que le cinéma italien. J’aime beaucoup la littérature française de la première moitié du XX siècle, notamment Céline, Camus. Je ne pourrais pas faire un film en France avec une certaine légèreté.
Pourquoi ?
G.A : Les réalisateurs français sont tellement nombreux. Je veux raconter et filmer quelque chose qui a du sens, faire un film parce que je dois le faire et pas le déléguer à quelqu’un qui est né ici.
En même temps tu fais des films en Italie alors que tu as d’importantes références italiennes…
G.A : Oui, mais c’est mon pays. Je cherche à trouver ma voie, ma place, à prendre possession d’une autre langue, d’une autre culture, à les traduire en langage cinématographique. Un des longs métrages que je prépare se passe en France, mais c’est un film sur des jeunes étrangers, sur la Légion étrangère. Ça a un rapport avec ma personne. Je suis étranger en France. Quand j’écris, il m’est plus facile d’imaginer des dialogues pour des étrangers que pour un français. Imaginer le point de vue d’un étranger en France est plus facile pour moi que celui d’un Français en France.
Ce que tu me dis me fait penser à ton film « Archipel » où tu t’intéresses au point de vue d’un palestinien en Israël, filmé comme un étranger.
G.A : Souvent dans mes courts, les protagonistes sont des étrangers. Dans mes longs-métrages, ce sera aussi le cas. Le point de vue d’un outsider me fascine beaucoup plus que celui d’une personne de l’intérieur. De nombreux films et livres m’ont toujours hanté sur cette question-là.
Comme lesquels ?
G.A : Par exemple, « Teorema » de Pasolini ou « L’Étranger » de Camus. La question de l’étranger dans le sens le plus large m’intéresse. J’ai aussi toujours été fasciné par la littérature mineure, écrite par des étrangers dans des langues majeurs, comme ce fut le cas de Kafka par exemple.
Quand tu évoques l’étranger, cela me fait penser à « Fireworks » dans lequel chaque personne parle sa propre langue (le grec, le français, l’arabe, l’italien…). Pourquoi as-tu souhaité travailler avec des comédiens de langues et cultures différentes ?
G.A : D’un coté, j’aime beaucoup travailler avec des acteurs qui viennent d’un peu partout. De l’autre, je change souvent de langue dans une même journée par nécessité. L’histoire de « Fireworks » touchait un sujet très controversé qui se passait dans ma ville d’origine. Que faire de la plus grande industrie sidérurgique d’Europe qui empoisonne toute une communauté mais qui lui fournit en même du travail ?
À l’époque, personne n’avait abordé ce sujet, après le film, ça a explosé. Il est devenu un film-manifeste pour le mouvement écologiste de ma ville. Des gens utilisaient des images du film comme profil Facebook, lorsque le film était projeté, même à minuit, la salle était toujours pleine, c’était vraiment très, très fort pour un court métrage. Ils le considéraient comme un acte politique, car j’y filmais un groupe d’éco-terroristes, solidaires des ouvriers, à la manière des Brigades internationales pendant la guerre civile espagnole.
Dans tes films, on ressent fort l’idée de la révolte. Pourquoi y a-t-il toujours un lien à l’explosion, à l’attentat, au feu d’artifice ?
G.A : Avant de faire des films politiques, j’essaie de les faire politiquement. Souvent, mes films sont tournés dans des lieux dont l’accès est interdit, avec une sorte de démarche antagoniste. Rien que ce fait-là peut provoquer une autre forme de jeu chez les acteurs car on est en train de faire un happening. Sur le tournage de « Fireworks », des voitures de police nous plaquaient contre le sol à la fin d’une scène, sur « Archipel », nous avons échappé plusieurs fois à l’armée israélienne. Il y a toujours un hors-champ dans mes films et c’est aussi à travers lui que je crée et obtiens une autre façon de jouer. Je m’installe dans quelque chose qui est à la fois de l’ordre du théâtre et de la performance.
L’engagement et la conviction sont nécessaires dans tes propositions de réalisateur ?
G.A : Je viens d’une famille très modeste, ce qui n’est pas non plus commun chez les réalisateurs ou les artistes. Je vois souvent des films sur les pauvres ou sur les ouvriers avec un regard misérabiliste et folklorique. Moi, j’essaie de les filmer autrement. Mes personnages ont envie de tout, ils ont faim, ils ne sont pas résignés. C’est pour ça que j’essaie de faire des récits épiques. Je n’aime pas les films bienveillants qui nous confortent dans nos idées. J’essaie de créer un trouble dans nos certitudes, de faire des films qui divisent, de pousser l’engagement dans des territoires où il ne peut plus y avoir de consensus, où les contradictions se révèlent. Mais ce ne sont pas des films réalistes, plutôt des films qui travaillent sur l’imaginaire.
Tes films sont à chaque fois des fictions. Tu aurais pu t’essayer au cinéma direct, engagé. Pourquoi n’as-tu pas fait de documentaires ?
G.A : J’ai fait un documentaire cette année, « This is The Way ». Je travaille aussi sur un autre documentaire sur le street art. En même temps, transfigurer la réalité m’intéresse plus que la capturer. Je pars de la réalité, mais ensuite je vais vers autre chose. Ce qui m’angoisse parfois dans le documentaire, c’est ce discours de vérité alors qu’avec l’image, tu peux travailler avec le faux. C’est plus puissant. Je n’ai pas de message univoque ni de leçons à donner.
Tu as bien des choses à exprimer.
G.A : Oui, mais j’aimerais qu’avec mes films, les spectateurs fassent une promenade libre, un voyage dans une architecture que j’aurai imaginé…
Tu m’as dit que dans ta famille, on ne faisait pas forcément de films…
G.A : Ma mère est secrétaire, mon père est employé à la mairie. Il n’y avait pas d’artistes chez nous. J’ai été le premier de toute ma famille à être allé à la fac. Quand je faisais mes études à Bologne, je suis allé à un festival qui projetait des films d’écoles européens, dont des films du Fresnoy. J’y ai vu un film d’un réalisateur chilien, Enrique Ramirez, qui m’a marqué. Là, j’ai compris qu’il fallait faire une école. Je n’avais pas fait grand-chose à montrer à l’époque, seulement des films faits avec des copains, programmés dans quelques petits festivals. Je n’avais pas de dossier assez solide pour tenter une école comme le Fresnoy. À ce moment-là, j’ai eu la chance de partir en Palestine comme assistant réalisateur. Le projet devait durer dix jours, j’ai fini par y rester un an et demi. Ça a déclenché une expérience incroyable qui m’a beaucoup marqué personnellement mais aussi professionnellement. À la fin, je suis devenu directeur artistique de la télévision publique en Palestine et j’enseignais le scénario à l’école d’art de Bethléem. À la fin, je suis parti et j’ai postulé au Fresnoy avec les projets d’ « Archipel » à tourner entre Israël et la Palestine et de « Fireworks » qui se passait dans ma ville d’origine.
Pourquoi avoir tenté cette école, bien moins classique qu’une autre ?
G.A : Je viens du cinéma expérimental, je me sentais plus dans une démarche Fresnoy que dans une démarche Fémis. Après, je souhaitais être dans une école internationale. Au bout du compte, j’ai fait peut-être le film le plus narratif de l’histoire du Fresnoy, « Fireworks », mon film de fin d’études. Il ne correspondait pas au « moule » plus hermétique de l’école.
Ce n’est pas évident, l’hermétique. Personnellement, je trouve que « Stella Maris » est film le plus accessible que tu aies fait.
G.A : Je voulais essayer de faire un film qui soit vraiment narratif. Mes grands amours au cinéma sont liés aux films de Godard, mais j’apprécie de plus en plus la complexité de raconter un récit, comme le font Scorsese ou James Gray. J’essaye maintenant de travailler beaucoup plus sur le récit en me laissant des libertés d’expérimentation. En tant qu’artiste, je sens le sens le devoir constant de chercher des choses nouvelles dans les images et dans leur façon de raconter des histoires. De l’autre côté, j’ai envie que le public puisse suivre mes histoires. Je veux faire des films que même ma famille peut voir.
Si on évoque « Stella Maris », qu’as-tu eu envie d’y raconter ?
G.A : Dans un certain sens, « Stella Maris » est un film chrétien, même si je ne suis pas croyant. Il aborde le mystère, le pardon, la confession. J’avais envie aussi de parler des traditions immuables qui se répètent depuis des siècles et du monde qui change tout autour. C’est aussi un film tragi-comique, un challenge pour un court métrage de moins de trente minutes de travailler sur les deux bords.

Le film frappe par sa musique très forte, très peps. Est-ce que pour toi, l’expérimentation passe aussi par la musique ? Est-ce que ça te permet d’exprimer un autre message ?
G.A : Mes films représentent aussi mes goûts. J’ai des goûts très hétérogènes, que ce soit dans le cinéma ou la musique. Ca ne m’intéresse pas de faire des films trop cohérents en terme de style. Ça risque de devenir une griffe d’auteur. Je suis quelqu’un d’assez incohérent, donc j’aime que mes films avancent par ruptures, par juxtapositions et du coup, j’essaie de travailler sur des glissements de ton, de style, plutôt que sur une idée de continuité, d’homogénéité. J’aime surprendre le spectateur. Avec ce projet, je savais dès le debout que je voulais faire un film sur la Madone que ça se terminerait en techno !
C’est une forme de petit coup d’état.
G.A : Oui !
Le trouble, la rupture, ce sont des choses que tu as pu expérimenter au Fresnoy ou pas ?
G.A : Au Fresnoy, l’expérimentation, tu l’as fait souvent par toi-même. Il y a bien des commissions à passer, des moments où tu es sous pression, mais la meilleure chose de l’école, c’est que tu peux faire plus ou moins ce dont tu as envie. Après, ça dépend de ta détermination en tant que réalisateur, mais on ne va jamais te censurer, on va te laisser faire. Chaque école a son identité mais après, on est des artistes, on ne doit pas respecter les dogmes de style internes, c’est la dernière chose qu’on doit faire.
Tu as fait deux courts métrages (« This is the Way », « Stella Maris ») avec La Luna Productions. Qu’est-ce qui t’a donné envie de travailler avec Sébastien Hussenot ?
G.A : Notre première rencontre a était assez improbable, elle a lieu au Festival de Dubaï ! On a commencé à parler de « Stella Maris » mais comme c’était un court métrage très complexe et cher qui demandait beaucoup de travail, j’en ai eu assez à un moment d’attendre les fonds et j’avais envie de tourner. J’ai proposé à Sébastien de me donner un budget de 5000 euros pour faire un film en deux mois, du tournage au mixage. C’est devenu « This is the Way ». Je me suis demandé quel outil mon personnage pouvait utiliser pour se filmer et j’ai choisi un téléphone portable. C’est le film où je m’affiche le moins en auteur, où je m’efface le plus derrière la vie de mon personnage.
Tu as fait une apparition dans « Toujours moins », un film de Luc Moullet. Tu n’as pas envie de passer devant la caméra ?
G.A : Jamais dans mes films. J’ai déjà assez de choses à penser quand je tourne. J’ai joué parfois dans les films d’amis, mais je ne pense pas être un acteur. Après, quand tu aimes le cinéma, tu aimes les tournages, et jouer dans un film, c’est être sur un tournage.
Finalement, en faisant autant de courts métrages, as-tu l’impression d’avoir appris à faire du cinéma ?
G.A : Oui, je pense que l’on apprend à faire des films en en faisant. C’est indispensable. Je ne comprends pas comment font certaines personnes qui attendent des années pour pouvoir financer leur long et qui ne font plus rien entre temps. Moi, j’ai besoin de filmer, de faire constamment des films, dont des courts métrages. On apprend de nos erreurs.f Les vrais lieux d’apprentissage sont l’écriture, le tournage, le montage. Ça, c’est la vraie école de cinéma. La plupart des choses que j’ai apprises a eu lieu pendant la réalisation de mes films. Même s’il n’y a pas de financement, il ne faut pas attendre qu’il arrive. Il faut, surtout au début, tourner avec des amis, faire des choses même si ratées pour pouvoir comprendre où on s’est trompé et où on peut s’améliorer.
Comment procèdes-tu pour l’image et le montage ? Ils participent à l’écriture et à la perception de tes films.
G.A : Les gens qui lisent mes scénarios y voient déjà les images du film. Ils sont très précis, très visuels. Quand je travaille sur un film, je m’occupe du cadre souvent. Je ne suis pas le genre de réalisateur qui laisse le chef op se débrouiller et qui ne travaille qu’avec les comédiens. Un film, c’est avant tout des images. Le directeur photo, c’est quelqu’un avec qui j’aime me confronter, mais je ne veux pas déléguer. Comme pour le montage, je suis tout le temps là. J’ai besoin d’être plongé dans le film pour trouver ce que je cherche. Mais en tant que réalisateur, j’essaie d’éviter de tout vouloir contrôler, j’aime aussi me perdre, trouver l’inattendu. C’est pour ça que je tourne souvent à l’extérieur, parce que la réalité peut toujours me surprendre.
Un jour, mon monteur m’a dit que je tournais exactement ce que j’allais monter. Je ne fais pas de plans de secours. Parfois, bien sûr, c’est très risqué, tu peux avoir un problème au montage, tu as besoin d’un raccord de plus, ça peut aider. Mais je pense qu’au cinéma, il faut prendre des risques et donc faire des choix.
Propos recueillis par Katia Bayer
Article associé : la critique du film






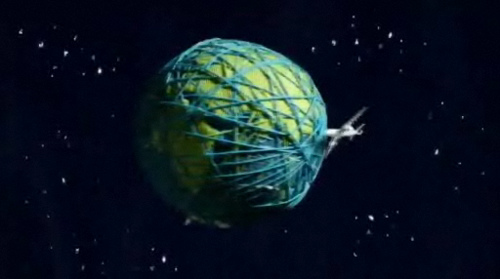

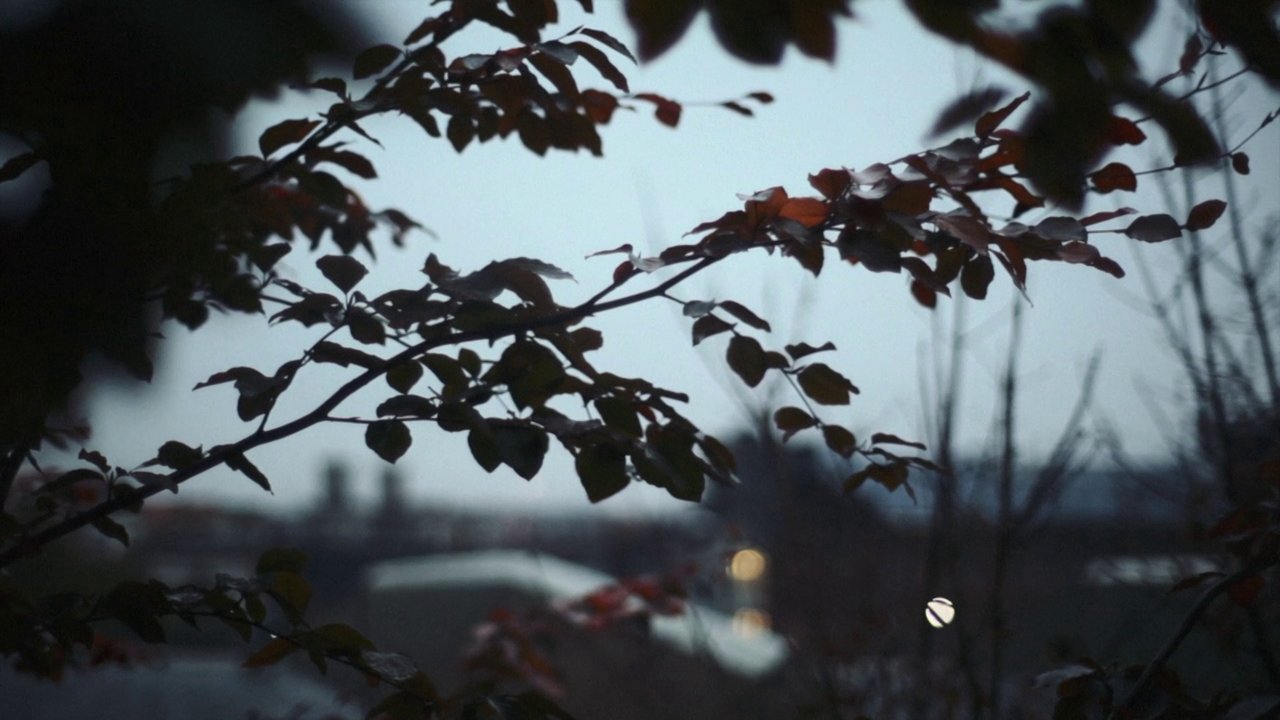






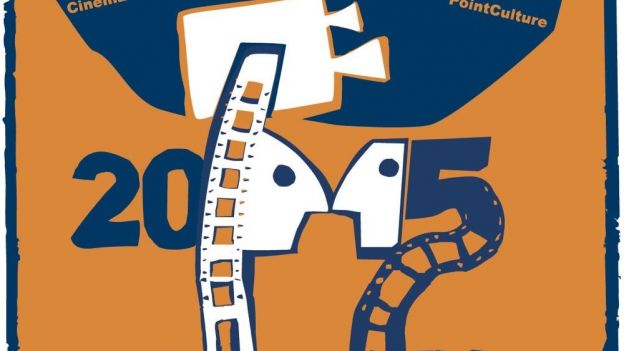





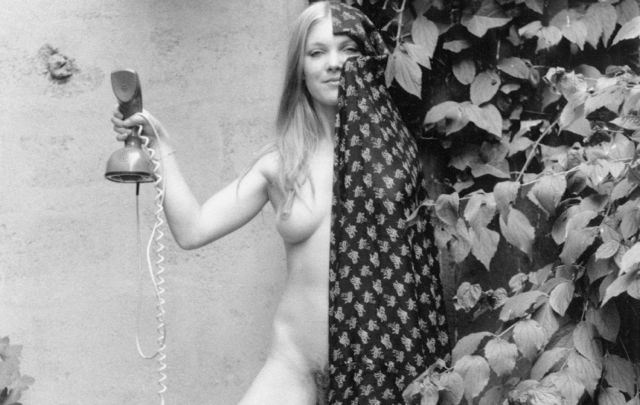

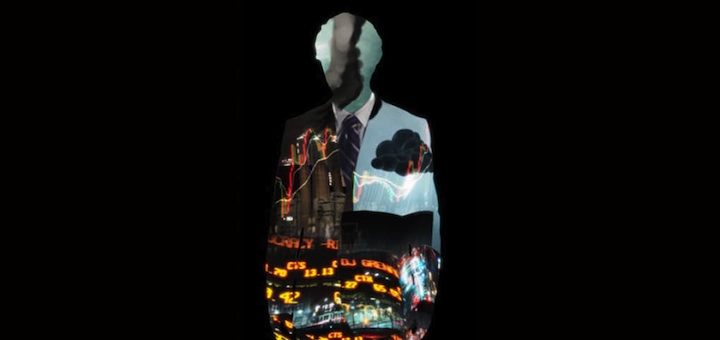
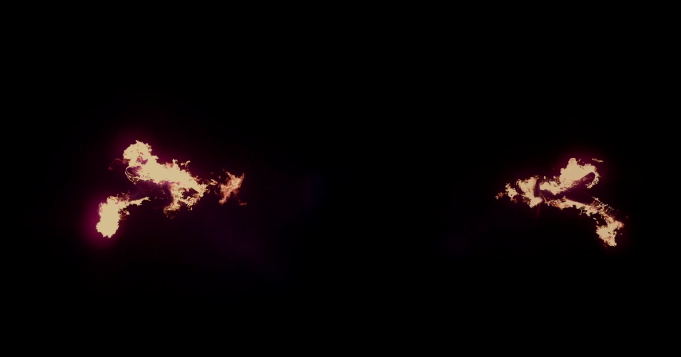



 Ce court-métrage empli de poésie urbaine s’inscrit dans une époque où le street art se développe de manière considérable dans le monde. La ville devient un espace d’expression pour de nombreux artistes. Ceux-ci jouent souvent avec les éléments insignifiants qui la composent pour les transformer en œuvre d’art, faisant ainsi ressortir aux yeux de ses habitants, qui d’ordinaire « la piétinent comme une horde de rhinocéros au galop» (« nashorn im galop » en allemand, d’où le titre), la beauté secrète dont elle regorge.
Ce court-métrage empli de poésie urbaine s’inscrit dans une époque où le street art se développe de manière considérable dans le monde. La ville devient un espace d’expression pour de nombreux artistes. Ceux-ci jouent souvent avec les éléments insignifiants qui la composent pour les transformer en œuvre d’art, faisant ainsi ressortir aux yeux de ses habitants, qui d’ordinaire « la piétinent comme une horde de rhinocéros au galop» (« nashorn im galop » en allemand, d’où le titre), la beauté secrète dont elle regorge.