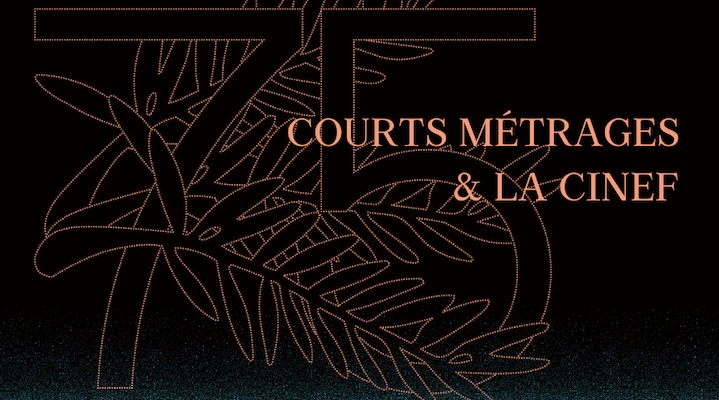Sélectionné à la Semaine de la Critique, Canker de la réalisatrice chinoise Lin Tu, est un court métrage espiègle et marquant de la sélection cannoise de cette année. D’une durée de 13 minutes, aussi dense que vaporeux, ce drame passe en revue des fragments aléatoires qui composent le quotidien de 33, jeune influenceuse chinoise en quête de célébrité. Héroïne typique de son temps, cette habitante de métropole cherche à se cacher derrière sa fausse représentation sur le Net. Cependant les clichés Instagram, les robes glamour, les soirées sans fin ni même les prises de repas gargantuesques filmés avec son smartphone, ne s’avèrent suffisants pour compenser sa solitude et son anxiété, tandis que cette envie de plaire aux followers n’est pas sans conséquences sur elle…

Avec Canker, Lin Tu vas bien au-delà du simple dévoilement de la face sombre de la génération Z, en utilisant comme méthode principale un jeu habile de contrastes déconcertants. Lorsque dans le prologue, l’héroïne énumère, en voix-off et sur un ton très factuel, les malheurs qui ont coûté la vie à tous ses proches, l’évocation de chaque ancêtre décédé est ponctuée par un emoji rieur correspondant, pendant qu’en arrière-plan les photos et vidéos de 33, euphorique durant ses activités quotidiennes, défilent en un montage frénétique.
Ainsi à la matière du film initial, viennent se superposer avant de disparaître tout aussi brusquement, comme si ce n’était que des interférences, des images aux propriétés plastiques. L’effet est significatif, car il participe à la dénonciation des apparences du quotidien : la forme ludique est là pour mieux faire résonner le fond cruel.
Alors qu’elle achève son monologue et qu’on réalise que la jeune femme est sans aucune famille, on la voit pendant une fraction de seconde trinquer avec ses copines, et on pourrait croire un instant qu’on a affaire à une femme forte qui garde sa joie de vivre en dépit des malheurs. Or ce n’est pas le cas, le long plan fixe qui s’ensuit nous montre l’influenceuse, maquillée dès l’aube, attendant devant son téléphone que des abonnés rejoignent son live, en vain.
La princesse est bel et bien seule dans sa tour, et nul ne vient rompre sa solitude, pas même le photographe et amant d’un jour qui trouve encore moyen de la rabaisser en lui disant que son style de vie n’est pas convenable pour une jeune fille.
Rien alors n’agit mieux pour autant sur le spectateur qu’un symbole parfaitement choisi : sur la lèvre de la protagoniste pousse un aphte douloureux. Sa mère l’avait pourtant mise en garde, disant que si elle continuait de se goinfrer de nourritures grasses, elle attraperait un ulcère, Canker.
Les plans tournés sur le vif qui suivent montrent 33 qui continue de s’enfoncer dans sa routine, s’étourdissant avec encore plus d’alcools et de fêtes, tandis que son abcès grossit un peu plus à chaque fois qu’elle l’inspecte. Une oscillation paradoxale entre les paillettes et le repoussant se crée, illustrant son état d’esprit trouble.
Dans cette métropole colorée et au rythme incessant, qui ne pardonne ni hésitations ni échecs, et où on ne peut plus simplement rêvasser à la manière des personnages d’un film de Wong Kar-Wai, la jeune fille est exposée dans sa touchante vulnérabilité. « Seule la douleur est vraie » admettra-t-elle finalement.

Lin Tu dresse le portrait d’une génération et d’une Chine, où la douloureuse vérité (y compris des émotions) se cache sous les faux-semblants de la société de consommation moderne, comme la plaie infectée se tapit au revers de la bouche de l’héroïne, à quelques cm des lèvres sensuelles sous le gloss luisant. Prisonnière sous ses artifices corrosifs, la jeunesse souffre, en silence.