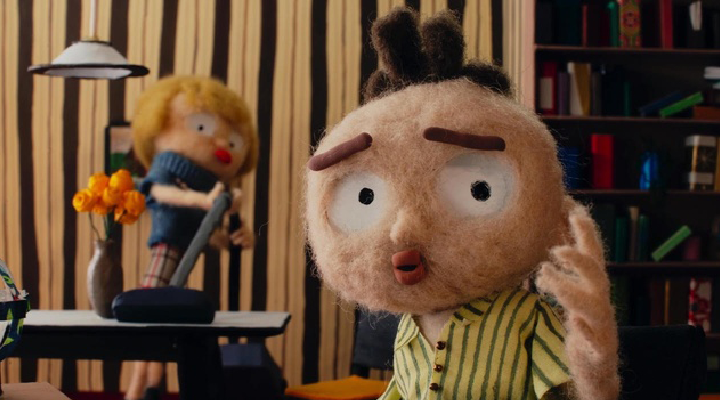Le premier prix de la Cinef a été attribué ce jeudi 26 au court-métrage italien Il Barbiere Complottista (A Conspiracy Man) de Valerio Ferrara, ce dernier empochant la belle somme de 15.000 €. Le cinéaste prometteur récemment diplômé de la prestigieuse école Centro Sperimentale Di Cinematografia (Rome), s’est démarqué avec une comédie de 19 minutes sur un gourou des théories du complot, soudainement arrêté un soir, par la police.

Antonio, un barbier marié avec un enfant, rapporte dans son précieux blog tout ses doutes et ses convictions sur la « réelle » vérité que cache le gouvernement. Il est la risée de son entourage, jusqu’à ce qu’un soir, des policiers interviennent chez lui pour l’emmener au poste et le placer en garde à vue…
Sans évoquer aucune théorie de complot déjà existante, le sujet du film de Valerio Ferrara vibre pourtant avec l’actualité. Lorsqu’on est plongé dans l’univers de cet homme qui doute de tout et n’accorde aucune confiance au gouvernement, on ne peut s’empêcher de penser aux théories du vaccin et du confinement liés à l’épidémie du Covid qui ont fait fureur ces deux dernières années. Le réalisateur préfère cependant inventer de toute pièces dans sa narration des complots comme la défaillance des lampadaires par exemple. Cela lui permet de garder une audience impartiale et créer de l’empathie avec le protagoniste chez le spectateur.
On s’attache effectivement à Antonio, héros ordinaire du quotidien, passionné par ces sujets complotistes. Il est brillamment interprété par Lucio Patanè, nous renvoyant l’image d’un homme au bon fond, victime de sa paranoïa. Valerio Ferrara parvient à nous faire éclater de rire à travers des répliques cinglantes et absurdes. Une tâche qui n’est pas aisée pour un cinéaste, tout jeune de surcroît.
Le rythme rapide du film participe à l’aspect humoristique. Le réalisateur joue avec diverses registres en n’hésitant pas à les exagérer à la manière d’une parodie. Il créé parfois du suspense, frisant avec le registre du thriller et Giallo : la scène d’introduction par exemple, en caméra subjective qui s’approche doucement d’Antonio ou la noirceur du plan et la lumière de l’écran clignotante sur le visage de ce dernier, créent une esthétique familière des films italiens des années 70. Cela offre un réel dynamisme au court-métrage. Valerio Ferrara ose notamment les plongées, contre-plongées provoquant une immersion totale dans le monde complotiste du protagoniste.

Cette familiarité qui évoque les films italiens de l’époque de Dario Argento est aussi provoquée par le décor et l’univers mis en place par le cinéaste. Le vieux papier peint comme la lumière très jaune donnent le sentiment que le film ne se situe pas au 21ème siècle. Et c’est particulièrement le métier d’Antonio (barbier) qui peut rappeler de vieilles comédies (Le Dictateur, Le Barbier de Séville, Beaumarchais). L’élément essentiel qui trahit la date de la diégèse du film, c’est la présence de l’ordinateur, réceptacle de la précieuse « vérité » du protagoniste sur le fonctionnement du système.
Sur un sujet contemporain et anxiogène, Valerio Ferrara renverse la tendance en nous faisant rire et en créant un univers bien à lui, inspiré de l’esthétique des années 70-80 !
Laure Dion
Consulter la fiche technique du film
Retrouvez prochainement l’interview du réalisateur