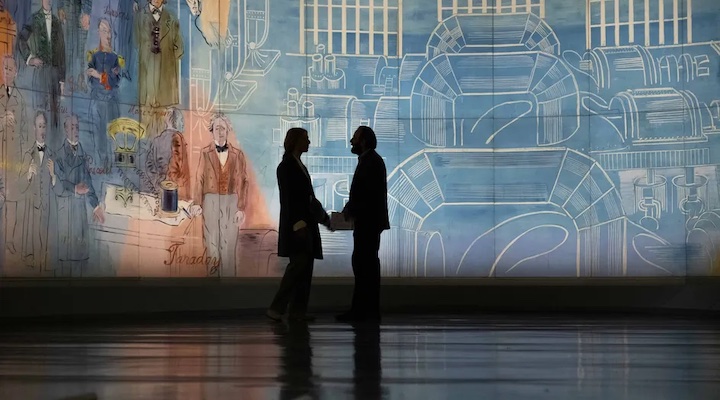Parce qu’il était membre du jury de la compétition nationale au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, nous avons pu rencontrer le cinéaste Alain Guiraudie, l’un des créateurs les plus importants du cinéma français actuel. Parce qu’on se situait en dehors de tout enjeu promotionnel – pas d’actualité de livre ou de film -, nous avons esquivé la compétition pour laquelle il était invité afin de revenir de façon transversale sur son cinéma. Son court-métrage Tout droit jusqu’au matin (1994), le plus bavard de ses films, était lui aussi projeté en séance spéciale pendant le festival.

© Sauve qui peut le court métrage, Anthonin Robineau
Format Court : Profitons d’être à Clermont pour parler des multiples formats de votre travail. Vous êtes un artiste très libre formellement, un contrebandier, et pourtant vous n’êtes jamais revenu depuis votre premier long à des formes plus courtes.
Alain Guiraudie : Moi, les courts… Le premier court ça m’a plu, le deuxième pareil, et au troisième, je tirais un peu la langue. J’avais déjà des projets de longs. J’ai fait longtemps du court par défaut parce que je n’avais pas les moyens et que je n’étais pas reconnu. Même le moyen-métrage, ça a été un peu par défaut… C’était une façon d’étirer le propos, de faire des films plus longs, tout en restant dans une économie de courts. Avec Ce vieux rêve qui bouge (2001), je me suis mis à gagner ma vie avec le cinéma. Mais pendant des années, ça restait compliqué de produire des films, donc j’en faisais un tous les quatre ans. Il fallait que j’en vive, que ça me nourrisse. Le court-métrage ne nourrit pas son homme, donc j’ai bien voulu en faire un peu au début, mais le long, ça a plus d’ampleur. Je pourrais y revenir, mais avec une idée qui s’y prête. Tout comme en tant que romancier, je ne m’interdis pas d’écrire une nouvelle. J’aime bien écrire rapidement, tourner et monter, mais chaque court m’a quand même pris deux ans de ma vie pour être peu vu. Ça pourrait me procurer une autre liberté mais je préfère aller vers d’autres choses maintenant que j’en ai les moyens.
Pourtant, on obtient des clés de compréhension de votre cinéma dans des films plus courts. Toute une liberté, une pensée du territoire ou de la sexualité, on la lit avec Du soleil pour les gueux et Ce vieux rêve qui bouge, qui sont sortis la même année, en 2001, avec deux radicalités esthétiques différentes.
A.G. : Oui c’est un peu mes deux veines, d’un côté la fantaisie barrée en prise avec le réel, et de l’autre, ma veine très naturaliste qui travaille les utopies. Ce vieux rêve qui bouge et Du soleil pour les gueux, je les ai réalisés alors que j’avais déjà écrit mes deux premiers longs. Pas de repos pour les braves (2003), j’ai l’impression de l’avoir tourné avec dix ans de retard. Et Voici venu le temps était déjà écrit quand j’ai fait La Force des choses (1997), qui en est une version raccourcie.
Et vous voyez un prolongement avec l’activité littéraire, qui a une autre ampleur ? « Rabalaïre » est très long, il faut se le manger [sorti en 2021, « Rabalaïre » est un récit ininterrompu sous forme d’un flux de conscience le long de plus de 1000 pages].
A.G. : Ouais, c’est un sacré morceau. Il y a une continuité dans le sens où j’ai toujours écrit des romans, qu’ils aient été terminés ou non, publiés ou non. Ici commence la nuit [son premier roman, publié en 2014], je l’ai écrit en réponse à une frustration du cinéma. On contrôle moins les choses dans le cinéma, il y a l’idéal qui se prend le réel dans la gueule. On fait avec les comédiens qu’on trouve, les décors sont tels qu’on les trouve, surtout si on ne veut pas travailler comme Fellini, en studio. C’est la chance et la beauté du cinéma, mais ça a souvent été une frustration pour moi. « Ici commence la nuit », je vais au bout d’un truc [commencé dans Le Roi de l’évasion (2009)], dans lequel j’ai toujours regretté de ne pas avoir trouvé une comédienne plus jeune que Hafsia Herzi et un comédien plus vieux que Jean Toscan [Le Roi de l’évasion fait le récit d’une histoire d’amour entre un homosexuel quarantenaire et gérontophile, interprété par Ludovic Berthillot, et une adolescente interprétée par Hafsia Herzi].
Parce qu’il y a des enjeux de productions, moraux, qui interviennent ?
A.G. : Oui. J’ai vu des jeunes filles intéressantes, de seize ans, mais elles ne voulaient pas jouer dans un film pareil. Et pour le casting de vieux, on s’arrête à quatre-vingt ans mais ils en paraissent soixante-dix… Et puis, on ne peut pas tourner physiquement avec eux, ils ne se foutent pas à poils. C’est pour ça que je passe au roman. « Ici commence la nuit », c’est le premier que je publie parce que j’ai trouvé une forme littéraire. J’avais trouvé « ma » forme littéraire. « Rabalaïre » c’est pareil : j’embrasse et re-parcours tous les thèmes qui me sont chers. Je pense qu’on fait toujours un peu le même film, sous des formes différentes, et qu’on écrit toujours le même roman. Tout ça, ça s’interpénétre et se mélange.
Il y a justement une différence entre vos films et vos livres qui est dans l’ampleur ou la restriction géographique. « Rabalaïre » a une ampleur géographique immense, des allers-retours permanents sur des centaines de kilomètres, alors que son pendant filmique Viens je t’emmène se concentre exclusivement sur Clermont-Ferrand.
A.G. : Oui. Dans Viens je t’emmène, la bonne idée c’est de ne se concentrer que sur Clermont-Ferrand, et même sur un immeuble. On ne travaille pas de la même façon. Dans un film, on essaie de resserrer les choses. Même moi qui ne suis pas le plus efficace des cinéastes… Sans l’être pendant l’écriture, on le devient forcément au tournage : on n’a pas les moyens de tourner ce qui avait été prévu. J’ai zappé plein de trucs sur le film, sans parler de tout ce qui part à la poubelle au montage : l’écriture s’y resserre encore, on se rend compte qu’il y a plein de choses qui n’ont rien à foutre là… On ne travaille pas dans la complaisance au cinéma, ni dans la flânerie. Bon, après, il y a des mecs comme Albert Serra ou Lav Diaz qui essaient de travailler là-dedans. Mais quand même un film de plus de 1h30 ça me fait chier… Il y a un moment où je me fous dans une situation de spectateur. J’aime un long roman, mais pour un film, il y a une durée idéale. Même deux heures…
Il y a une question de disposition d’esprit, peut-être ? Ma durée idéale, c’est 1h15 ou plus de 3 heures…
A.G. : Oui, dans un film de quatre heures, on rentre dans quelque chose de très différent. Mais ça ne m’intéresse pas de tourner plus long, et ça m’emmerderait au montage. On fait des projections du film in extenso toutes les semaines, alors regarder mon propre film, s’il faisait plus de quatre heures toutes les semaines, je ne le supporterais pas. Je préfère rester dans des formes plus courtes, puis on ne me donnerait sûrement pas les moyens de faire plus long. Et la durée, la flânerie… C’est pour ça que je m’épanouis dans la littérature. J’ai vachement appris avec le cinéma à m’adapter à des contingences extérieures et économiques, d’où une certaine frustration.
Vous disiez ne pas être un cinéaste efficace, mais vous avez une autre vertu qui est la simplicité. Tout a l’air simple, enfantin. Si la technique et l’exubérance sont des critères dans le cinéma majoritaire, vous décidez de faire l’inverse.
A.G. : Je ne suis pas là pour le spectacle, c’est sûr. Et puis, je serais battu : les Américains sont mille fois plus forts que moi, et même pas mal de Français. J’ai été tenté à une époque… Voici venu le temps (2005), ça a été une tentative de film de capes et d’épées, budgété trois millions d’euros et qu’on tourne avec 700.000… A l’arrivée ça fait un truc super cheap, un peu merdique. Ça m’a vraiment calmé. Il faudrait arriver à jouer ce jeu du mainstream, à calibrer des films pour le grand public pour qu’on m’en donne les moyens. Le divertissement ou le spectacle m’intéresse. Je vais voir Spiderman, La Guerre des étoiles, Batman… ça m’attire mais je ne saurais jamais le faire donc je reste sur des trucs dans lesquels je suis dans mon élément.
Vous restez un cinéaste minoritaire (budget, entrées en salles…) tout en jouant avec les codes d’un cinéma majoritaire : le thriller de L’Inconnu du lac (2013), la comédie de boulevard de Viens je t’emmène (2022)…
A.G. : J’ai l’impression de faire des films populaires. Pour moi, Le roi de l’évasion et Viens je t’emmène, c’étaient des comédies populaires. À la sortie, je m’aperçois que non. Ce qui pourrait me faire passer la rampe en termes d’entrées ? Peut-être un premier rôle plus connu, un jeu du casting… Noémie Lvovsky [la tête d’affiche de Viens je t’emmène] ça ne suffit pas. Mon film qui fait le plus d’entrées, L’Inconnu du lac, est le plus simple : il y a des mecs à poil et une enquête.
Et hyper lisible.
A.G. : Oui. La lisibilité, j’y suis hyper attaché depuis mon premier court-métrage, je la recherche. Viens je t’emmène, ça me semblait être un film mainstream mais ça se vautre, peu de gens l’ont vu. Je devrais changer mon mode d’écriture, mon mode de production. Personne ne me le propose… Une fois, j’ai discuté avec un gros distributeur, mais le mec n’a rien compris. C’est un autre monde, mais peut-être qu’il faudrait, parce que j’ai toujours en tête des projets assez ambitieux.
Le public est-il frileux à cause de la part de subversion qu’il reste dans votre cinéma ? Le sexe frontal, et les sujets abordés (le terrorisme de Viens je t’emmène, l’homoparentalité et l’euthanasie de Rester Vertical) qui peuvent rester des tabous.
A.G. : Rester Vertical, c’est très différent. Il est plus difficile, vachement plus sombre… Viens je t’emmène, c’est facile d’accès. Mais fondamentalement, je me demande ce qu’il adviendrait d’un film comme ça s’il y avait un matraquage publicitaire, des pubs dans le métro, un accès aux grands médias par les comédiens, qui auraient accès au journal de France 2 le dimanche soir. Parce que ces gros médias, ceux efficaces, on ne les obtient qu’avec des stars. Le public manque de curiosité mais de toute façon, ceux qui vont au cinoche une fois par mois ont d’autres choses à voir… C’est des problèmes de promotion. Je constate que Viens je t’emmène a quand même eu de bons retours, sans parler de la presse. Les retours sur le forum d’Allociné, qui est assez malsain, n’étaient pas dégueulasses. Sauf qu’à la fin, c’est dur de sortir du lot et d’atteindre le gros public. Si j’avais vraiment ce fantasme, je m’y prendrais autrement. Noémie Lvovsky, pour nous c’est une star, mais dis son nom dans la rue et pas grand monde la connaît. Peut-être qu’avec Virginie Efira et Niels Schneider…
Vous avez un désir de jouer avec des acteurs plus identifiés ?
A.G. : Oui, mais je ne veux pas faire du casting juste pour attirer plus de monde. Des têtes connues peuvent m’inspirer, je ne refuse pas les stars d’emblée, mais je ne suis pas certain d’avoir des projets pour ça. Quand on est parti sur des bases auteuristes, c’est vachement dur de s’en extirper, ou alors il faut commencer très jeune. Je ne sais même pas si Virginie Efira chez moi, ça intéresserait du monde. Magimel chez Serra [pour Pacifiction, 2022], toute la presse en parle, mais c’est 60 000 entrées. Magimel a fait beaucoup plus d’entrées dans sa carrière, au final, personne n’est allé voir le film. C’était quand même une expérience intéressante.
Vous utilisez souvent le désir comme moteur de résolution dans l’écriture, et le sexe comme hypothèse de fiction. Vous re-créez des fantasmes et re-sexualisez tout.
A.G. : Je n’arrive pas à tout régler avec le désir, même si j’aimerais. Je pense par contre que ça reste un moteur de nos vies, du monde. Sans le désir on est un peu foutu. C’est important et politique d’érotiser le monde, des choses qui ne le sont pas. Clermont-Ferrand n’est pas une ville hyper sexy… Ca m’intéresse d’érotiser d’autres corps, et ça s’inscrit dans les débats actuels. Quand je fais Viens je t’emmène, je réagis à Yann Moix qui dit que la femme de moins de cinquante ans n’est pas désirable. Que la vieillesse ne serait pas désirable. Remettre en question les canons en vigueur de la beauté, de l’érotisme, ça m’intéresse. L’Inconnu du lac aussi est fait en réaction, je cherche à camper une autre vision de l’homosexualité. Pareil dans Ce vieux rêve qui bouge (2001), j’ai voulu aller dans les usines, aller contre l’idée que les homosexuels c’est tous des mecs bien foutus qui vivent dans les centres des grandes villes… Ca ne veut pas dire que je refuse les jeunes mecs bien foutus pour autant. Je me suis vite aperçu qu’il y avait quelque chose d’essentiel dans ce déplacement, aussi une résistance face à quelque chose qui se perdait dans la société. Mais je cherche aussi à combattre le puritanisme en vigueur. Maintenant, j’essaie encore de dépasser cette question, pour mon prochain film, je cherche à faire de l’érotisme sans sexe.

Comme dans « Rabalaïre » avec la relation entre le personnage principal et le curé.
A.G. : Oui, ça m’intéresse énormément. J’ai souvent pris le désir et l’érotisme comme terrain de jeu, voire de bataille, parce que beaucoup de choses se cristallisent sur ce terrain. Et ça donne des films plus tendus. On a toujours un peu de mal à voir le sexe, les scènes d’amour au cinéma… Même moi. C’était un vrai enjeu avec L’Inconnu du lac, les discussions et le sexe. On ne l’expédie pas en trois plans : quand on fait l’amour, on fait l’amour, ça dure comme dans la vie.
Et en plan large, fixe…
A.G. : Oui, on garde une durée et surtout un enchaînement. Pas des jump cut où on passe d’une position à une autre… On fait beaucoup et n’importe quoi là-dessus. C’est un enjeu politique et esthétique sur lequel j’ai appuyé un long moment.
Il y a une hypothèse radicale dans vos premiers films, qui apparaît dans Ce vieux rêve qui bouge et Du soleil pour les gueux. Le corps d’un homme d’au moins une soixantaine d’années qui annonce en avoir à peine cinquante ans… Il y a une fragilité énorme dans cette annonce, et une puissance de désir, un poids du corps social.
A.G. : Les ouvriers font toujours au moins dix ans de plus, ouais. C’est marrant parce que même la scripte, quand on tournait la séquence, elle m’a dit : « Non mais tu gardes ça ? ». Quand on est sur le tournage, on se dit que ça ne passe pas du tout qu’il a cinquante et un an. D’une part c’est assez conforme à la réalité, et d’ailleurs sur tous mes rôles, je vais chercher des comédiens qui ont dix ans de plus. Pour 50, je vais chercher à 60 parce que les comédiens font toujours plus jeune. C’est marrant parce que pendant un moment, j’avais ce truc sur les âges, ce que je renoue un peu dans « Rabalaïre », avec un personnage qui a une centaine d’années.
Et ça permet de déplacer les problématiques liées au sexe. La différence d’âge dans Le Roi de l’évasion, ou dans Rester Vertical qui explose le couple hétérosexuel entre Damien Bonnard et India Hair.
A.G. : Ouais, il explose bien ce couple. Depuis L’Inconnu du lac et surtout avec Rester Vertical, j’ai eu l’impression d’être en phase avec les problèmes de l’époque. Dans Rester Vertical, on baignait vachement dans des questions d’homoparentalité, de monoparentalité, d’euthanasie… Beaucoup de débats apparaissaient sur la scène publique, et j’ai aussi fait le film avec ça.
Il y a souvent avec votre cinéma un faux a priori naturaliste. C’est pourtant une fiction totale, tout est absolument fantasque. Vous êtes à contre-courant de ces films qui prétendent être du côté du réel tout en étant hyper artificiels…
A.G. : Ça m’intéresse vachement de rendre l’improbable possible. Je me demande comment ça m’a attrapé cette histoire… A la base, j’étais plutôt amoureux du néo-réalisme italien. Il y a eu une bascule quand j’ai découvert Rohmer et Bresson : il y a quand même des mecs qui ont l’air de faire des films réalistes mais qui ne le sont pas du tout. On touche au quotidien, à la vérité des hommes, avec une façon de parler qu’on n’entend jamais. Je suis en bataille contre la façon de jouer en vigueur, le cinéma mainstream est complètement à côté de la plaque. Les Américains y arrivent encore plutôt bien, mais en France, je trouve ça pas possible de jouer comme ça… Il y a de l’impudeur, les gens étalent leur sentiment trop facilement. Il faut proposer autre chose. Ca vient peut-être d’Almodovar : avec lui on est complètement ailleurs, et pourtant c’est Madrid. Je me rappelle de Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ? (1984), bâti comme un vaudeville mais on saisit bien la vie réelle du prolétariat madrilène. Le côté intemporel m’intéresse. Dans Viens je t’emmène, une pute comme Isadora, blanche et qui tapine dans le centre de Clermont, ça n’existe pas. Même à la gare, ça n’existe pas… Ca ne tapine vraiment que sur internet ou à l’extérieur des villes. Et dans la relation avec son mari, c’est pareil. C’est un couple des années 70, pas d’aujourd’hui. Ca m’intéresse d’être entre la France ancienne et la France nouvelle, ça participe à l’intemporalité de mes films. Je veux aller chercher une vérité du temps d’aujourd’hui et de mon temps à moi… ça m’intéresse d’inventer ou de réinventer le réel. Faire face à la fuite du réel.
Ce que permettent vos dialogues. Écriture très ciselée, et refus de la performance des acteurs…
A.G. : Oui. Je confonds beaucoup l’acteur et le personnage qu’il incarne. J’aime bien cette idée. Il y a soit une vaine mainstream, où l’acteur joue comme il croit que serait son personnage, avec des traits et une psychologique marquée. Dans le cinéma mainstream que j’aime, on voit d’abord l’acteur : Depardieu, Jugnot, même Marlon Brando. Et il y a un cinéma naturaliste dans lequel l’acteur essaie d’être le personnage, d’une façon très nuancée et subtile. J’aime que les deux s’interpénètrent. Je veux que ces deux façons se rencontrent. Je veux utiliser la façon d’être de l’acteur, son corps tel qu’il est.
Saisir le réel, ça serait ressaisir l’acteur au-delà de son personnage ?
A.G. : L’idéal, c’est d’avoir un mélange des deux… Que l’acteur ne rentre pas dans le moule du personnage, n’essaie de pas se fondre, mais qu’avec sa façon d’être, il s’inspire de ce qu’il a vu chez le personnage. J’aime cette idée que le personnage et le comédien font chacun la moitié du chemin, qui vont l’un vers l’autre et qui se rencontrent.
Et vous avez des modèles contemporains dans la direction d’acteurs ? Je trouve que Paul Thomas Anderson ou Abdellatif Kechiche arrivent à saisir cet entre-deux…
A.G. : Daniel Day-Lewis dans There will be blood, je déteste. Licorice Pizza, c’est pas trop mal… Mais ça me fait chier, dans que ça raconte. J’ai plus été inspiré par des gens comme Renoir, Bresson, Pialat. Le gros apport de Pialat, c’est la direction d’acteurs. Il a inventé une façon de jouer très naturaliste, libre. Chez les contemporains, Kechiche, ça m’intéresse. Dans Mektoub… mais lui, ça se joue vraiment au montage.
Et puis c’est l’inverse de vous, formellement. La scène de sexe dans Mektoub est hyper cutée.
A.G. : Je me sens assez loin de ce qu’il fait mais c’est quelqu’un qui m’inspire dans la direction d’acteurs. Je pense beaucoup aussi à Almodovar, Nanni Moretti… Chez les contemporains, en France, ça serait Arnaud Desplechin. Ses films font chier mais la direction d’acteurs est vachement bonne.

« Viens je t’emmène »
Il y a aussi la question du parler et du son. Vous êtes assez hétérodoxe, ça ne vous dérange pas d’être inintelligible. Le vent qui passe au-dessus de la voix est plus intéressant qu’un mixage nickel…
A.G. : J’ai eu un gros changement avec L’Inconnu du lac, où on a fait un film seulement avec le son choppé dans la nature. Avant ça, j’avais du mal à l’aborder, ou alors ponctuellement avec des partis pris très forts. Comme ce plan dans Ce vieux rêve qui bouge avec les voix au premier plan, et les personnages qui marchent au loin… Il y a une question de dénaturalisation et aussi d’efficacité dramatique. Et je n’avais pas les moyens économiques de les suivre.
Mon cinéma place le dialogue au centre. Le gros truc du son, ça a toujours été d’enlever, et je procède déjà en enlevant à tous les niveaux… alors pour le son, c’est encore pire. Je me suis retrouvé face à des processus de fabrication du son qui étaient très établis dans le cinéma : un monteur son qui rentre en piste après l’image, qui prend plein de sons, les empile pour qu’au montage, je lui dise de tout enlever. C’est très pénible pour moi, et j’imagine pour lui aussi. J’ai fini par travailler autrement le son : on a besoin de presque rien, seulement de trouver le bon son. Et le bon son, c’est le cinéma direct. Tout ce que la monteuse son a enregistré pour Viens je t’emmène, ça ne marchait pas. Elle a essayé de reconstituer une conversation dans une cage d’escaliers mais ça ne m’allait pas. Alors au final, j’ai fait un truc tout con, j’ai pris mon téléphone dans ma cage d’escalier à Albi, je l’ai enregistré et je l’ai monté. Qu’est-ce qu’on se fait chier sur le son, à le reconstituer. Pour Viens je t’emmène, on a tourné trop d’intérieurs en studio, il n’y a pas les bruits de la ville… Je suis plus à l’aise avec les tournages à la campagne, avec quelque chose de plus venteux, les feuilles dans les arbres… Le prochain va se tourner dans un village, je rentre à la campagne.
Propos recueillis par Pierre Guidez