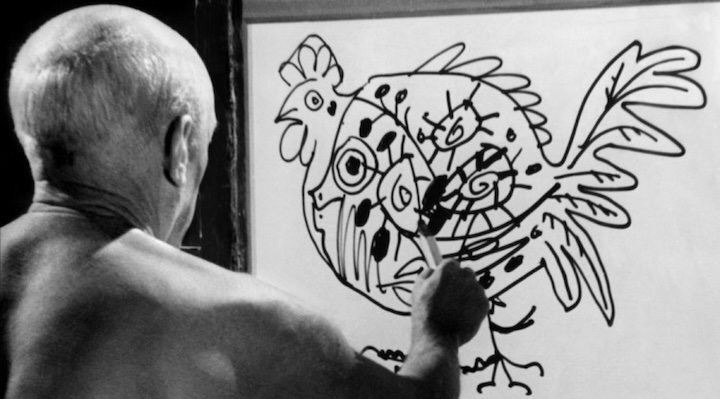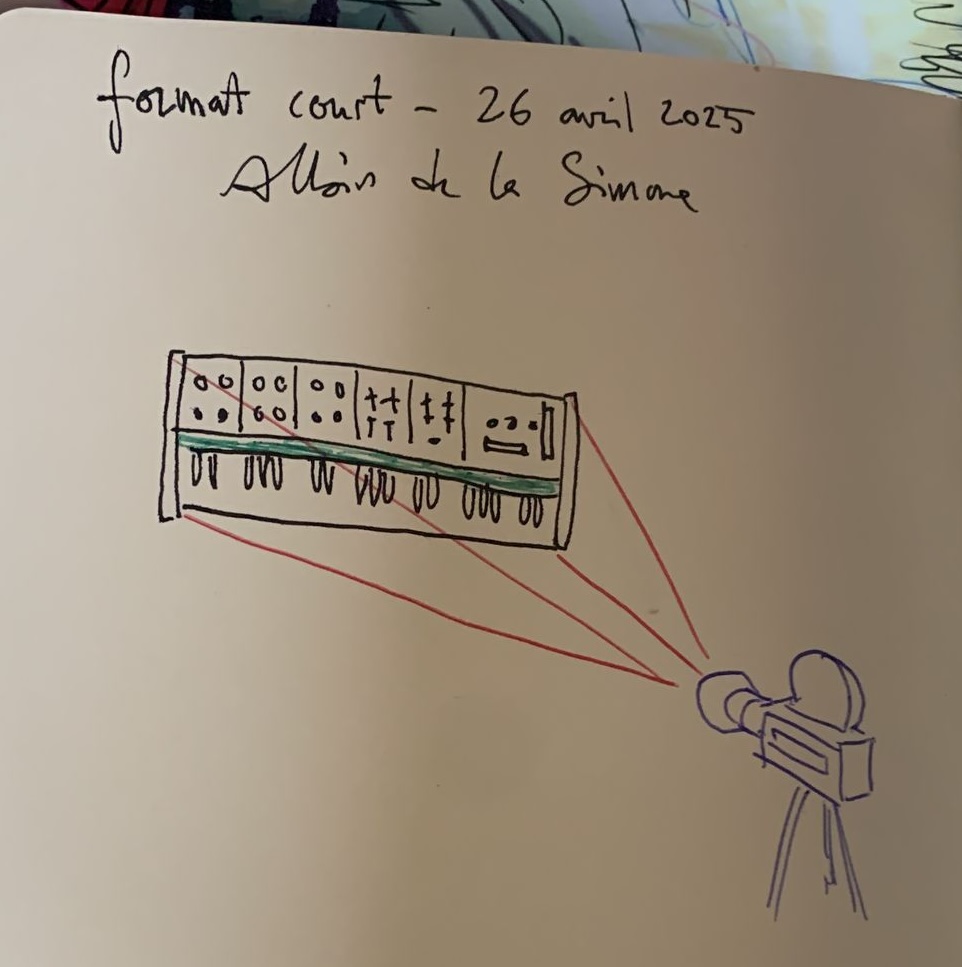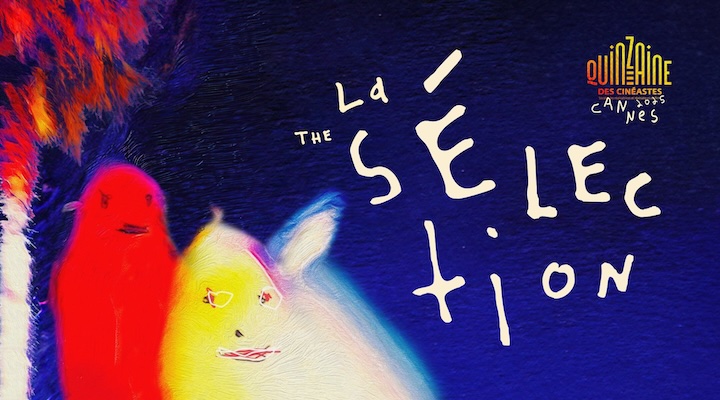Danse avec les queens
Un chahut dans l’eau, une jeune fille bousculée par une bande de garçons : la séquence qui ouvre Le Mystérieux Regard du flamant rose introduit un récit de corps repoussés, mis à la marge, tenus la tête sous l’eau. Après deux courts-métrages El verano del léon eléctrico (1er prix de la Cinéfondation 2018) et Les Créatures qui fondent au soleil (Semaine de la Critique 2022), Diego Céspedes présente son premier long-métrage cette année dans la sélection Un Certain Regard.
Dans une petite ville minière du désert chilien, au seuil des années 1980, une jeune fille grandit au sein d’une ardente communauté queer qui vit dans un cabaret. Une mystérieuse maladie contamine au fur et à mesure les habitants. On la dit provoquée par le regard, lorsqu’un homme en désire un autre. Récit généreux à la croisée des genres : le western, le road-movie, voire le fantastique, Le Mystérieux Regard du flamant rose endosse l’étoffe d’un film queer entre tragédie et burlesque, d’une liberté de ton débridée, qui emporte autant qu’elle importe. Diego Céspedes dans son premier geste révise notre regard autant que la réflexion sur la marge.

La fraîcheur de la proposition tient autant par son sujet que par une volonté de fluidité à travers les genres, ce que contient de facto l’esthétique queer, et ce, en prenant à bras-le-corps le western, genre de cinéma aussi viriliste et violent qu’attentif à la marge et aux frontières, empreint d’homoérotisme. Les corps des personnages féminins, travestis, sont eux-mêmes des corps frontières, en branle, que l’on tente de circonscrire dans un territoire. L’une des séquences voit d’ailleurs les mineurs du village leur interdire la sortie de leur bicoque. Les vendettas imaginaires ou réelles héritent des duels, tandis que les balades en moto, flingues autour des reins dans les terres poussiéreuses du désert, ont la violence du western et la fluidité du road-movie, véritable catalyseur de désir et d’émancipation.
Le Mystérieux Regard du flamant rose aurait pu s’en tenir à ces deux genres du cinéma, pour penser la marge et ses turbulences, mais par d’étranges séquences souvent nébuleuses, il met un pied dans le film de vampires. La maladie qui se propage est nommée «la peste», tenue comme une calamité, comme une plaie. C’est de toute évidence un écho au sida qui a ancré davantage l’homophobie envers les communautés queer. Cette épidémie qui se propage a tout à voir avec les vampires. Lorsque Nosferatu arrive dans la ville, c’est la peste qu’il sème dans son sillage. Si c’est l’horreur et l’ostracisation que permet l’idée du sida comme peste, c’est, dans le même réflexe, là que se situe l’érotisme hypnotique du film. L’union charnelle devient une dévoration au clair de lune dans une séquence hallucinante qui conjugue l’Eros au Thanatos. Les films de vampires prolifèrent dans leur monstruosité, leur déchéance des corps putréfiés, leur grande mort, autant que dans leur séduction envoûtante, leur sublimation, leur petite mort, celle de l’orgasme. Ce côtoiement du vampirisme dans un geste surnaturel renoue avec l’idée du sang comme substance de vie autant que de mort qui cimente le film. Le sida est une maladie du sang, ses effets sont proches de ceux de la peste : maigreur, traits creusés, sorte de bubons turgescents sur le corps, dépérissement progressif, et surtout la mise au ban des victimes, le cœur du film. Cela n’empêche pas que le sang, autant que la maladie, se vivent dans cette bulle qu’est le cabaret comme une fête, comme une représentation. N’y a-t-il pas une séquence de noces où l’on souhaite la félicité dans « le sang et le sperme » ? Uni ainsi au flot créateur, le sang reprend son statut de fluide de jouissance, d’existence et d’organique. Le film est de tous les instants une célébration de la vie dans ses mouvements les plus digestifs, comme une allégresse rabelaisienne, où l’on se raconte des histoires assis sur les cabinets entre deux flatulences.
Le film de Diego Céspedes se distingue par une intelligence des motifs qui dessinent un cercle bien établi et pensent avec force les échos et les miroitements, sans souligner ses intentions, en restant dans une sorte d’effronterie toujours renouvelée, en constante circulation. Là où il est le plus percutant est certainement dans son effort de repenser le regard, levier qui imprime le titre. Qu’est-ce que le regard ici ? Négativement, son absence est un rejet, une manière d’enraciner l’exclusion. Les mineurs du village se cachent les yeux sur le passage des travestis, car une rumeur veut que ce soit par le regard embrasé pour un autre homme que l’on s’infecte. Le regard comme échange donc, comme promesse érotique autant que pathologique. À l’inverse, la communauté du cabaret est un ensemble de personnes qui se regardent, qui échangent, et s’acceptent. Si elles sont stigmatisées, refusées à la vue, leur art et leur salut tient à la représentation, à leur propre geste de monstration. Le cabaret donne ainsi lieu au spectacle, à la sublimation de leurs corps, par des chansons, des danses, ou même lors d’une très signifiante séquence d’hypnose qui vient exorciser l’homophobie dont elles sont la cible.

Il n’y a rien de plus violent que de perdre la vue. Œdipe se crève les yeux pour ne plus voir son crime, pourtant il se soustrait à la possibilité de contempler les autres et la beauté. Ce geste de la vue empêchée est un motif récurrent du Mystérieux Regard du flamant rose : de la simple menace à l’innommable qui vient déchirer le film, ou encore de ce moment bientôt renversé avec beaucoup d’humour des yeux bandés comme prévention. Sur un mur est inscrit « Je me suis perdu dans ton regard mystérieux ». Cela rappelle l’ensorcellement dont le regard est la matrice, qui rend à la chair son potentiel de lascivité autant que sa perdition. À cette phrase probante répond une des plus belles séquences du film, teintée de magie et de sensualité, dans un ensemble rose à plumes, où le regard devient absorption, où le charnel fraie avec la cruauté, où les corps s’unissent à travers les yeux.
C’est une œuvre sans cesse en oscillation entre tragédie et comédie, qui saisit avec originalité et justesse l’idée des marges et du rejet sur ces communautés. Cela témoigne d’à quel point le cinéma est un lieu pertinent pour la pensée queer en cela qu’elle se conditionne sur l’importance du regard à poser, des yeux à ne pas détourner. Le film de Diego Céspedes allie rigueur théorique et mesure des motifs qui n’excluent jamais la fébrilité et l’audace des séquences.
Le mot flamenco évoque autant le flamant rose que l’impétuosité spectaculaire du style de chant et de danse auquel il donne son nom. On ne cesse d’aimer danser avec ces personnages. On est prêt, comme la maîtresse du cabaret, à imaginer une musique et à la précipiter dans le silence de l’enlacement pour en poursuivre l’ardeur. Les femmes du Mystérieux Regard du flamant rose sont autant des reines du drame que des reines de la trame.