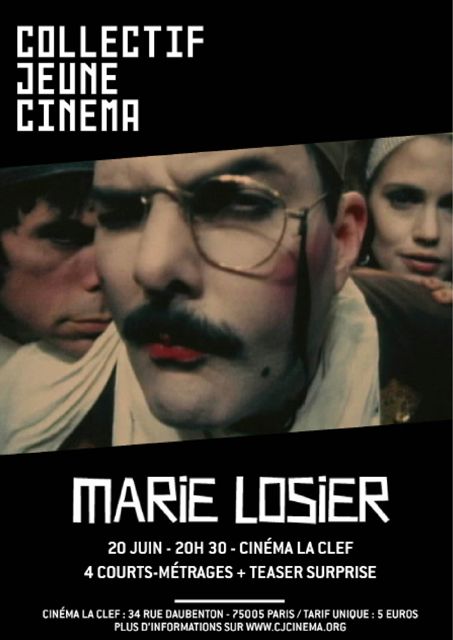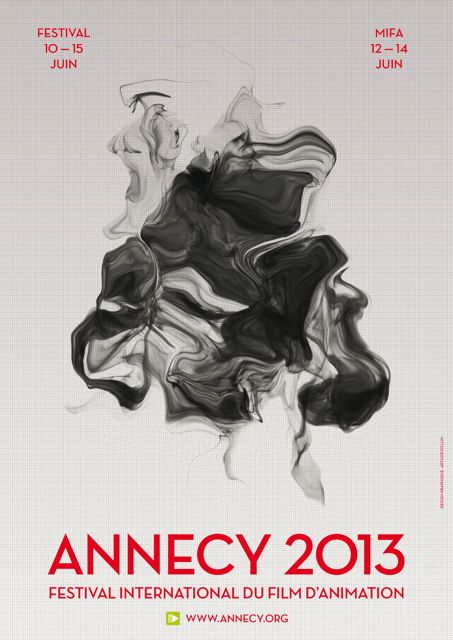Le film « Que je tombe tout le temps ? » était en sélection à la Quinzaine des Réalisateurs lors du dernier Festival de Cannes. Il s’agissait de la deuxième sélection à Cannes pour le réalisateur Eduardo Williams (après « Pude ver un puma » à la Cinéfondation 2012) et presque d’une habitude pour le producteur Amaury Ovise (Kazak Productions) d’être pris à Cannes. Si les deux hommes se sont rencontrés il y a maintenant un an avec l’envie de travailler ensemble, de notre côté, nous avions très envie de les convier à un entretien croisé sur une des plages de la Croisette. Tous deux placides et respectueux du temps de parole de l’autre, ils nous ont parlé de leur manière de travailler et de créer ensemble. Eduardo, dans un français encore fragile, nous a embarqué dans son monde à lui, tandis qu’Amaury est apparu comme un producteur extrêmement attentif auprès de son réalisateur.

Eduardo, peux-tu nous parler des prémisses de « Que je tombe tout le temps ? » ?
Eduardo : Au niveau pratique, tout a commencé au Fresnoy. Dans le cadre de mes études, je devais travailler sur un projet de film. Au niveau personnel, c’est un peu étrange car lorsque je commence à écrire, je ne suis jamais vraiment confiant ; par conséquent, je jette sur le papier un peu tout ce qu’il y a au fond de moi et après seulement, je lui donne une forme, une organisation. C’est toujours mon intimité, quelque chose d’intérieur qui ressort. C’est amusant d’ailleurs car je ne m’en rends pas forcément compte au départ, puis en regardant le film fini, je m’aperçois que ça parle vraiment de moi ou de quelque chose qui s’est passé dans ma vie. Pour ce film, j’ai voulu continuer le chemin que j’avais initié avec mes autres courts, tout en me concentrant un peu plus sur un seul personnage. J’affectionne toujours l’idée du groupe, mais j’aime bien le fait d’avoir extrait un personnage de manière plus claire. À côté de ça, j’apprécie l’idée d’aller chercher encore plus loin, d’explorer des domaines que je ne connais pas forcément. C’est en partie la raison pour laquelle j’ai voulu que cette histoire se déroule en Afrique. Enfin, il y a la question des langues. Avant « Pude ver un puma », j’écrivais toujours en espagnol et je faisais des choses très proches de l’Argentine. Puis j’ai commencé à voyager et j’ai adoré être dans un autre pays, entendre les gens qui parlent une langue que je ne comprenais pas, un peu comme une musique. J’ai ensuite commencé à assimiler des langues, comme le français, et j’ai souhaité l’évoquer dans ce dernier film.
Il semble donc que tes films se créent plus volontiers sur un ressenti, sur une expérimentation sans cesse en mouvement. Dans ce sens-là, la phase de l’écriture du scénario est-elle importante pour toi ?
Eduardo : Oui, c’est important, mais plus pour une question d’organisation, pour avoir une structure qui me guide et pour ne pas être totalement dans l’improvisation. Et aussi parce que c’est une nécessité pour la production du film. Mais c’est vrai que j’aime rester assez libre concernant les dialogues et les détails du film. Comme je ne parle pas bien le français, je préfère que les acteurs parlent de leur propre manière. Ils sont également libres de me suggérer des choses, pas seulement des dialogues, mais aussi des actions. En plus, comme je travaille le plus souvent avec des acteurs qui ne sont pas professionnels, je préfère qu’ils se sentent à l’aise dans des éléments qu’ils me proposent plutôt que de leur imposer une manière de jouer.
Avec autant de liberté, peux-tu nous décrire un tournage avec toi ?
Eduardo : Idéalement, j’adorerais avoir trois mois de tournage pour un simple court métrage (rires) ! Mais je sais que c’est cher. Néanmoins, pour ce tournage à Sierra Léone, je n’avais jamais eu autant de jours : 18 au total, pas uniquement pour le tournage en fait, mais aussi pour les repérages et pour connaître les gens. On y est d’abord allé avec mon comédien, Nahuel Peréz Biscayart pour être en immersion là-bas, puis mon chef opérateur, Julien Guillery, nous a rejoints la dernière semaine. En tout cas, j’ai toujours essayé que durant le tournage, il y ait la même ambiance que ce qui se voit dans le film. C’est très important pour moi, pour pouvoir créer, d’avoir une ambiance amicale et pacifique sur le tournage, de telle sorte que des choses viennent de chacun.
Aussi bien dans « Pude ver un puma » que dans « Que je tombe tout le temps ? », les décors sont incroyables. Comment procèdes-tu ? En as-tu une idée très précise avant de découvrir les lieux où tu tournes ? Ou bien, est-ce pendant les repérages que tu vois des lieux qui t’inspirent ?
Eduardo : En général, les lieux sont toujours à l’origine de l’idée ou bien alors, je mélange des idées que j’ai avec des endroits que je connais. Ce sont en tout cas des éléments essentiels à prendre en compte afin d’écrire le scénario. Le décor, pour moi, n’est pas un accessoire décoratif, je le considère comme un personnage qu’il faut que je fasse dialoguer avec le reste du film. Par exemple, j’ai découvert la grotte du film « Que je tombe tout le temps ? » lorsque je suis allé manger chez la mère d’un ami et ça m’a évoqué beaucoup de choses. Je suis vraiment très sensible aux lieux que je découvre.
Pourtant, dans tes films, on a l’impression que parfois, l’improvisation domine et qu’il n’y a presque pas d’effort esthétique. Comment expliques-tu cela ?
Eduardo : En fait, c’est très important pour moi de mélanger l’irréel, le quasi fantastique, avec quelque chose de beaucoup plus naturel, comme si c’était l’un des personnages du film qui tenait lui-même la caméra pour tourner. J’ai toujours besoin d’éléments contraires et de créer des contrastes. Alors, c’est vrai que j’adore mettre en relation des aspects irréels avec des caractéristiques proches du documentaire. Et je pratique ça sur le film en général, aussi bien auprès des personnages, des actions que des décors.

Justement, tes personnages sont à la fois étranges et très normaux. Ils ont des discussions qui semblent complètement sorties du contexte et d’autres qui sont très terre à terre, de l’ordre du quotidien. Et tu filmes le plus souvent des jeunes dans des situations peu valorisantes. Qu’est-ce qui t’amène à faire ces choix ?
Eduardo : Il y a des expériences et des sentiments que j’ai vécus, que j’ai partagés avec d’autres, et par conséquent, que j’ai envie de montrer. Parfois, ça passe par des choses étranges en effet, ce qui m’aide à être en connexion avec des lieux ou avec des personnes. Mais c’est aussi parce que c’est très intime et très personnel. Néanmoins, j’aime bien raconter ça, même si les spectateurs ne voient pas toujours bien ce que je veux dire ! Disons qu’il y a des choses qui sont importantes et significatives pour moi et pour d’autres, peut-être un peu moins. Après, j’espère que les gens vont tout de même comprendre ce que j’ai voulu dire.
On réussit tout de même à cerner des thèmes récurrents dans tes films, comme la destruction par exemple, et on imagine que c’est aussi ce qui explique que tu emploies souvent des jeunes. C’est un sujet qui t’est cher ?
Eduardo : Oui, c’est un thème qui vient naturellement pour moi. Après, il est vrai que je me demande pourquoi ça me vient et pourquoi ça m’attire (rires). Quelques fois, je me dis que c’est génial, et d’autres fois, je me dis que je ne suis peut-être pas bien dans ma tête. En réalité, j’aime bien chercher des éléments qui me sont inconscients et les analyser.
En même temps, il y a de l’espoir dans tes films, tout n’est pas chaotique.
Eduardo : Oui, c’est ça : toujours mettre en valeur et en scène des contrastes. En effet, la destruction et l’espoir sont des idées contraires, et c’est notre action qui fait qu’on bascule de l’un à l’autre. Dans mon dernier film, un de mes personnages dit : « Pour me comprendre, je me suis détruit ». C’est quelque chose que j’ai lu pendant mon année au Fresnoy, mais c’est en tout cas une phrase, une notion qui me parle beaucoup et qui ressemble à ce que je veux faire passer. Je pense qu’il y a quelque chose de positif dans la destruction. Qui plus est, selon moi, la destruction est naturelle. Et la relation entre les personnages pour s’aider ou pas, est très importante aussi.
Amaury, lorsque nous t’avons contacté pour réaliser cette interview et qu’on a commencé à parler d’Eduardo, tu nous as dit que lorsque tu avais vu « Pude ver un puma », ça avait été comme une évidence de le suivre pour collaborer avec lui sur un prochain film, dont « Que je tombe tout le temps ? » est la preuve. Pourtant, lorsqu’on voit ce que vous produisez avec Kazak, même si les films sont tous uniques en leur genre, ce que fait Eduardo va encore plus loin dans la différence. Par conséquent, peux-tu nous dire ce qui t’a attiré dans son travail ?
Amaury : Chez Kazak, lorsqu’on produit un film, on se pose la question suivante : est-ce que les films précédents des réalisateurs avec qui on travaille nous donnent envie d’aller plus loin ? Lorsque j’ai vu « Pude ver un puma », ça faisait très longtemps que je ne m’étais pas retrouvé devant un film avec une grammaire de cinéma, une manière de raconter une histoire aussi particulière, unique et finalement rare dans le court métrage. En fait, j’ai l’impression que les films que fait Eduardo sont des films qu’on ne peut pas faire en Europe. Je pense que les courts-métragistes en France ou en Europe ont une culture cinématographique et une grammaire qui sont infuses, et par conséquent, on a souvent le sentiment de voir des films qui se ressemblent, ou tout du moins avec la même façon de raconter une histoire, quelle qu’elle soit. Chez Eduardo, il y avait quelque chose qui n’est pas narratif et j’ai trouvé ça formidable. Dès le début du film, on devine qu’on va être perdu, qu’on ne va pas tout comprendre, mais que c’est poétique et qu’il y a des choses qui circulent dans un espace complètement surréaliste. Par conséquent, à la fin, on y réfléchit longtemps, on y revient. Personnellement, j’ai vu plusieurs fois « Pude ver un puma » et il a toujours le même effet sur moi. Fort de ça, j’ai vu en Eduardo un auteur avec qui j’avais vraiment envie de travailler, sachant que dans son cas, ça n’allait pas exactement être la même façon de travailler qu’avec les autres auteurs avec qui on collabore pendant très longtemps en développement. En effet puisque comme il l’a si bien dit, il a une manière de construire ses films de manière plus intuitive.
Par conséquent, comment en es-tu venu à ce film-là ?
Amaury : C’est Bernard Payen, à la Semaine de la Critique, qui m’a dit que c’était un film qui pourrait me plaire, sachant que je l’ai vu après Cannes. Du coup, on s’est rencontré avec Eduardo à Paris et on a évoqué l’idée de travailler ensemble, mais il avait déjà intégré le Fresnoy. Néanmoins, Eduardo m’a parlé de son projet de film en m’informant qu’il devait le faire dans le cadre de l’école. Ça restait donc un film d’école et il était difficile pour nous, à Kazak, de mettre de l’argent du CNC pour faire le film. Après, comme le film avait lieu dans la jungle, en Sierra Leone et que c’était un peu plus cher que le prix habituel des films d’écoles, on a décidé de co-produire ce film avec le Fresnoy. Mais j’ai très envie de travailler avec Eduardo sur un autre projet. D’ailleurs, on en parle pour cet été. Si bien que là, l’un des enjeux est d’essayer de faire en sorte que dans le cinéma d’Eduardo, il y ait un point d’équilibre qui se fasse entre le narratif et son univers. On s’est dit qu’il faudrait donc peut-être travailler plus longuement sur l’écriture, parce que personnellement, je n’ai pas suivi cette phase pour son dernier film. Dans notre boîte, de toute façon, on aime la diversité et la radicalité; par conséquent, on met nos désirs à l’épreuve. Eduardo fait partie des gens avec qui ça m’excite de travailler. Notre but est de collaborer avec eux en leur laissant la plus grande latitude possible pour qu’ils puissent exprimer pleinement leur talent, leur cinéma.

Et vous n’avez jamais peur de la prise de risques, justement sur des films différents à produire ?
Amaury : Non, parce qu’on a un crédo chez Kazak, c’est de dire qu’il faut absolument que le court métrage soit vraiment une recherche de développement, sinon, il n’a aucun intérêt d’exister. On se dit toujours qu’il mieux vaut rater des films que de faire des films académiques, confortables, qu’on oublie. En Eduardo, je vois un grand cinéaste en devenir avec qui j’ai envie de travailler au niveau de l’écriture dans une configuration classique de développement, comme on aime le faire en général. Je trouve personnellement que le tournage est un espace qui n’appartient qu’au réalisateur, dans le choix de ses comédiens, de ses techniciens, de ses décors, et encore plus chez Eduardo. Dans ce que met en place Eduardo, il y a des enjeux excessivement forts sur le développement et sur le montage également.
Ce que je trouve intéressant, c’est de découvrir le travail et l’univers d’un nouvel auteur avec qui on travaille. Chaque réalisateur nécessite une collaboration différente et c’est ça qui nous plaît. Notre métier est de trouver leurs points forts et de les mettre en avant. Ici, c’est un film essentiellement produit par le Fresnoy on n’a pas encore eu le temps de réellement expérimenter notre collaboration. C’est ce qui nous donne l’envie de trouver de nouveaux défis entre nous, d’aller jusqu’à créer un dépassement dans son prochain film.
Propos recueillis par Camille Monin et Fanny Barrot. Retranscription : Camille Monin
Article associé : la critique du film
Consultez la fiche technique du film