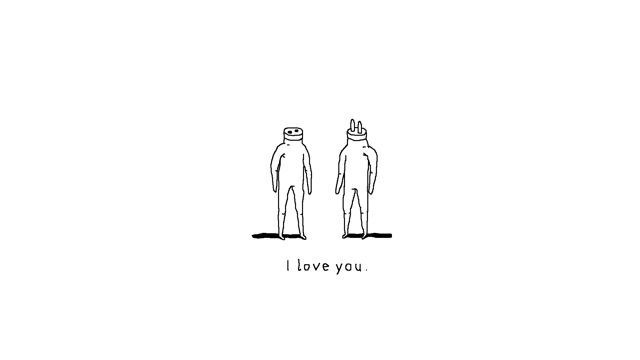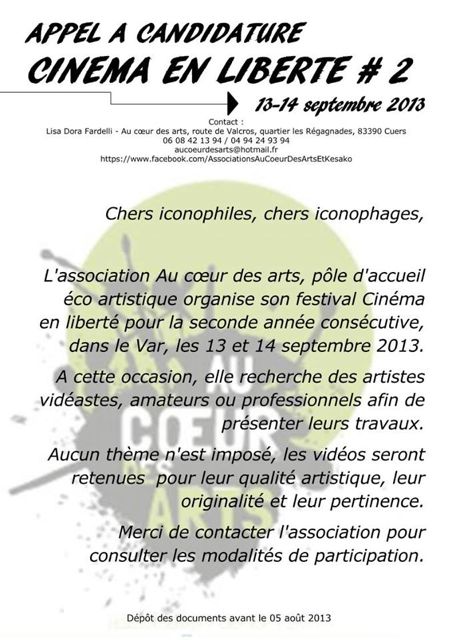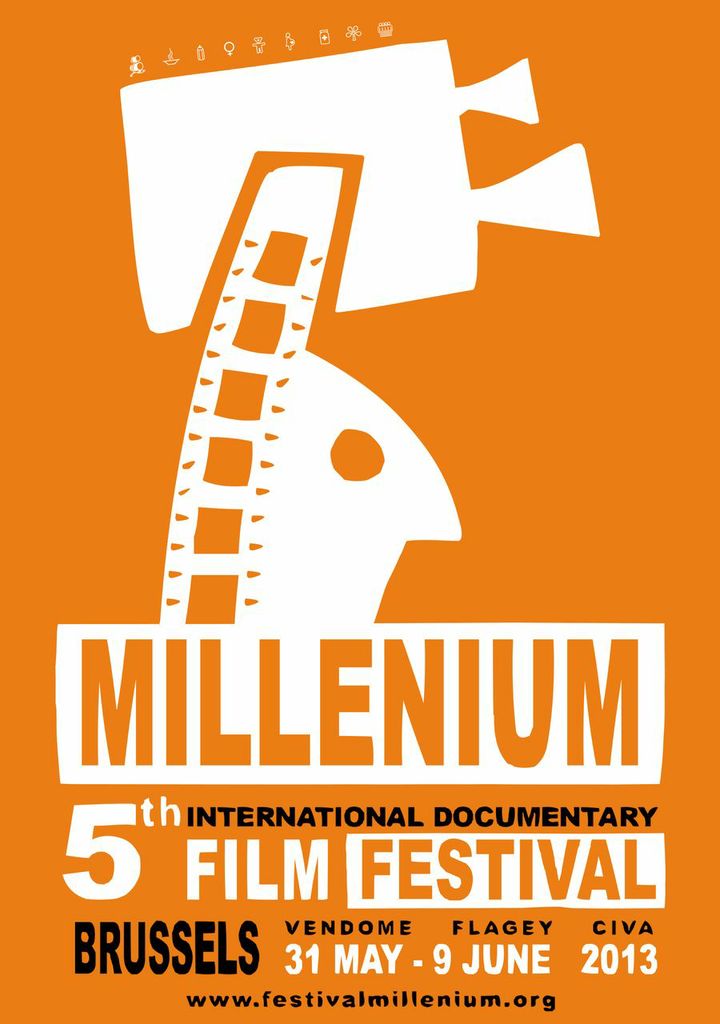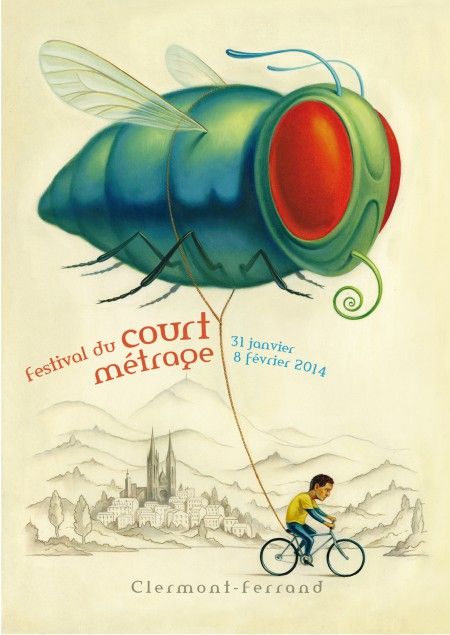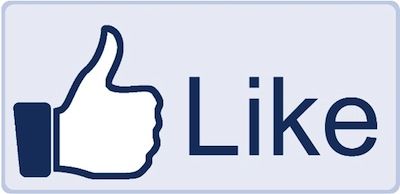Pour sa 5ème édition, le Millenium International Film Festival s’est offert un programme de 7 films entièrement consacrés au cinéma du Bangladesh. Pays de 150 millions d’habitants, l’ancien Pakistan oriental compte parmi sa production cinématographique quelques perles documentaires d’une qualité surprenante, dont trois réalisées par une même cinéaste, Yasmine Kabir.
My Migrant Soul de Yasmine Kabir
Yasmine Kabir est de ces cinéastes pour qui cinéma rime avec engagement. Amoureuse de son pays natal, elle en révèle les failles avec humanisme et ferveur. Au départ de « My Migrant Soul », il y a une histoire individuelle, celle de Shah Jahan Babu, un jeune homme parti travailler en Malaisie avec l’espoir d’améliorer son futur et celui de sa famille. Mais au lieu de trouver un accueil chaleureux, il n’y a rencontré que désillusion et misère liées à une condition de vie innommable qui le vit rentrer au pays dans un « joli » cercueil. Touchée par ce fait-divers, Yasmine Kabir a décidé de retrouver les traces de Shah Jahan Babu afin de donner une voix à tous ces travailleurs anonymes qui chaque jour, risquent leur vie dans le sillon de l’esclavage moderne. Pour appuyer son propos, elle se sert des enregistrements vidéo que le Bangladais avait envoyés à sa famille. La réalisatrice mêle ceux-ci aux témoignages de la mère et de la sœur du jeune homme auxquels elle ajoute des plans filmés en Malaisie. Ainsi, on suit sa descente aux enfers. Grâce à cette narration à la fois classique et singulière, Kabir arrive à nous faire ressentir la solitude et l’isolement de Shah Jahan, victime d’un système socio-économique où « tout est à vendre » et où l’âme humaine, en revanche, ne vaut rien.
A Certain Liberation de Yasmine Kabir
« A Certain Liberation » dresse le portrait de Gurudasi Mondol, jeune paysanne qui, suite à la guerre de libération de 1971, sombre dans la folie lorsque toute sa famille est assassinée sous ses yeux par les Razakars (des collaborateurs pro-Pakistan). Dès les premiers instants, la caméra à l’épaule de Yasmine Kabir suit les pérégrinations de Gurudasi dans les ruelles étroites et chaotiques de Kopilmoni. L’image tremblante met mal à l’aise et suggère la nécessité de filmer cette femme, de retracer son terrible passé. Des chemins de terre au logis de Gurudasi, la cinéaste aime montrer à quel point celle que l’on considère comme la « folle » est devenue une légende dans son village et sa folie lui confère des laissez-passer dans la société bangladaise qu’aucune autre femme n’aurait le droit d’avoir: armée de son bâton, elle frappe les hommes, leur vole de l’argent, leur hurle des injures sans qu’ils n’osent protester. Ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, Gurudasi s’expose et s’exhibe, sans aucune gêne, comme seule la folie le permet. Mais plus tard, quand elle se raconte et se dévoile fragilement, la caméra de la documentariste se fixe enfin. C’est une femme blessée et vulnérable qui, sous ses airs d’insoumise, s’offre pudiquement au regard du spectateur. Et pour un instant, la douce folie fait place à une froide lucidité et à une immense tristesse. « A Certain Liberation » traite de la cruauté des Hommes, de la folie d’une femme, et du manque de liberté aussi. Ironie du sort, en sombrant dans la folie, Gurudasi semble avoir symboliquement traversé les frontières de toute soumission.
The Last Rites de Yasmine Kabir

Troisième et dernier documentaire de Yasmine Kabir présenté dans ce panorama sur le Bangladesh, « The Last Rites » se veut être un poème visuel, une ode muette à ces milliers de travailleurs des chantiers de démolition de navires de Chittagong qui, par leurs efforts physiques, travaillent nuit et jour au milieu des déchets toxiques, des restes de navires, de la poussière d’amiante pour un salaire de misère. Si les deux films précédents s’attachent à raconter l’histoire d’un individu et n’hésitent pas à filmer le personnage (ou sa famille) de près, pour « The Last Rites », Yasmine Kabir reste volontairement distante. L’homme a dès lors perdu son individualité, sa particularité pour ne devenir qu’une masse mouvante et anonyme, un ensemble, une machine. Le son plus dysharmonique que cohérent, renforce le décalage avec l’image et permet une vraie réflexion sur le rapport de force et de pouvoir des uns par rapport aux autres. Visuellement interpellant, « The Last Rites » apparaît dès lors comme une efficace diatribe contre la pensée politico-économique dominante.
The Projectionist de Shaheen Dill-Riaz
Dans le cadre d’un projet pour la télévision allemande, Shaheen Dill-Riaz a réalisé « The Projectionist », un court métrage documentaire sur Rakib, un enfant de 7 ans. Le film retrace une journée de sa vie, du lever au coucher. Partagé entre l’école, la famille et la salle de projection d’un cinéma de quartier où il apprend le métier de projectionniste, il connaît les répliques du grand acteur de Bollywood, Shahrukh Khan par cœur. Et dans la moiteur des soirées bangladaises, la magie du cinéma permet à tout un chacun d’oublier ses problèmes le temps du film. Shaheen Dill-Riaz porte un regard tendre et complice sur Rakib, sans jamais outrepasser les frontières du voyeurisme. Avec subtilité, il arrive à dessiner l’essence d’une enfance en quête de rêves tout en la plaçant dans la plus commune des routines. Un joli pari réussi !
Consultez les fiches techniques de « My Migrant Soul », « A Certain Liberation », « The Last Rites » et « The Projectionist »