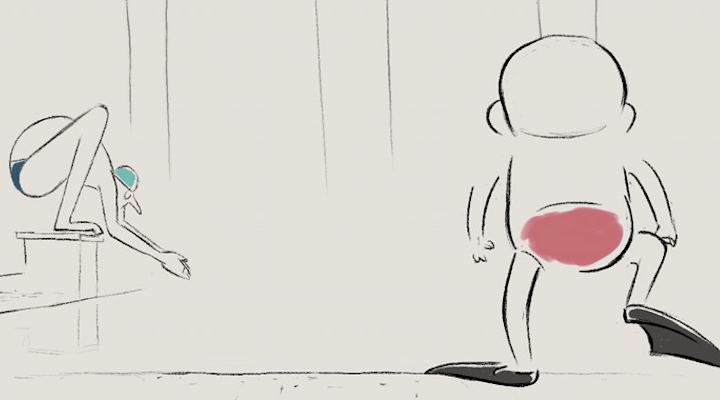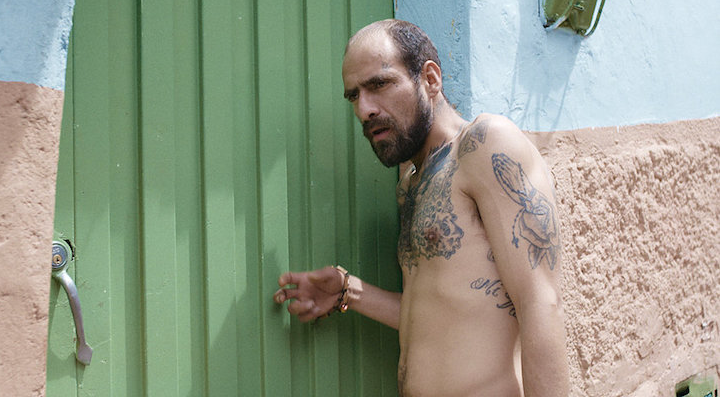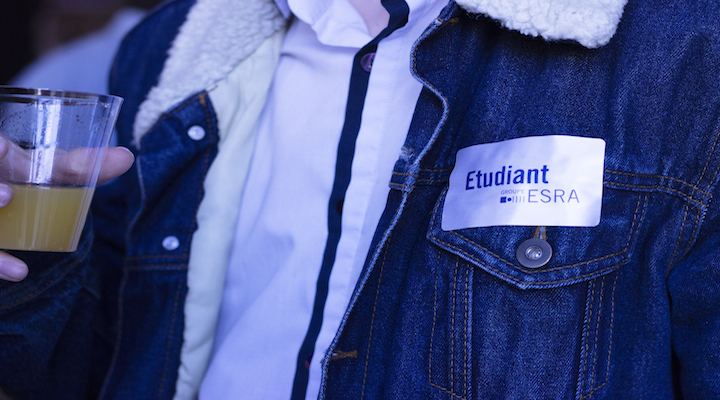Tiphaine Raffier, dramaturge, metteuse en scène et comédienne pour le théâtre vient de réaliser La Chanson son premier court-métrage. Après avoir découvert son film lors de la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes, nous avions envie d’en savoir un peu plus sur l’univers de Tiphaine et son rapport au cinéma…

Qui es-tu ?
Je suis Tiphaine Raffier, je suis actrice, auteure et metteure en scène. Et puis… réalisatrice, maintenant (rire)
D’où t’es venue l’idée de la pièce de théâtre, puis de son adaptation cinématographique ?
Val d’Europe, la ville dans laquelle j’ai grandi est une ville simulacre qui pratique le façadisme. La ville est une copie du patrimoine architectural européen. (faux immeubles haussmaniens, fausse place italienne, rue d’inspirations londoniennes). C’est en quittant la ville où j’avais grandi que je me suis rendue compte qu’elle était bizarre.
Comme mon premier métier c’est le théâtre, j’ai d’abord écrit une pièce sur cet endroit. Je voulais parler d’une fille, vivant à côté d’une industrie culturelle mainstream, qui se destine à l’art. Avec la distance, je me rends compte qu’en vivant à proximité du parc Disneyland et notamment de Disney Studios, tout appelait à la fiction et surtout, au cinéma. Alors la décision de traduire les mots de la pièce en image s’est imposée très rapidement.
Comment passe-t-on d’une dramaturgie théâtrale à une dramaturgie scénaristique ?
La première question a été : comment passer du cadre de scène fixe et unique à tous les cadres possibles ? Je me suis très vite posé la question du régime des images aussi. Comment filmer cette ville ? Les images diégétiques dans le film croisent des images documentaires et les personnages eux-mêmes se filment. Filmer ce regroupement de communes, Disney et Val d’Europe, c’est sans cesse interroger la réalité des bâtiments qui nous entourent. L’exercice mental qui m’a fait passer du théâtre au cinéma n’a finalement été qu’un moyen extraordinaire de formuler les questions philosophiques que soulevait la ville.
Il y a des éléments perturbateurs dans ton film, comme des cartons et l’apparition de mots à l’écran. Peux-tu nous expliquer comment tu es arrivée à briser la linéarité de ton court-métrage ?
C’est exactement ça. Ce sont des éléments perturbateurs. Le film hésite au début comme s’il cherchait son sujet. Va-t-on parler de la ville ? De Barbara ? Alors qu’au final, on raconte l’histoire de Pauline. Au milieu du film, Pauline voit un documentaire animalier qui fera naître en elle une vocation, un appel. Comme une crise mystique. Mais c’est l’art qui va l’appeler (rires). À partir de là, elle va intellectualiser. Et le spectateur assiste aussi à sa progression, son cheminement plastique. Elle écrit des mots sur du papier, puis projette ces mots via un vidéo projecteur, jusqu’à ce que les mots viennent eux-mêmes coloniser le film.
D’une certaine manière, Pauline tire le film vers elle. Au début, c’est Barbara qui est maîtresse des cadres, des corps et du temps. Pauline, elle, change les codes du film, et ainsi, dérègle l’immuable sérénité de la ville.
Je me souviens que l’écriture de la pièce avait été concomitante avec ma découverte du concept de « désir mimétique » de René Girard. Barbara est la « jeune fille » parfaite, tel qu’on nous l’a présentée dans les teen movies de Disney. Dans sa perfection, elle est l’incarnation de cette ville. Pauline et Jessica n’en sont que des pâles copies. De toute manière, tout n’est qu’affaire d’imitation dans ce film. La ville imite d’autres villes. Les objets que chante Pauline imitent d’autres objets. Les filles font elles-mêmes un spectacle de sosies. Et Jessica, dans un ultime exercice d’imitation va rendre hommage aux chansons de Pauline. On imite toujours ce qui parait plus désirable. La copie est aussi fondamentale en histoire de l’art et sans le savoir, Pauline soulève aussi ces questions.

Peux-tu nous expliquer pourquoi, dans ton film, tu as décidé d’utiliser la dystopie – une société fictionnelle à l’utopie sombre – en détruisant la ville qui t’a vu grandir ?
Ça m’amusait de détruire ma ville d’enfance. Ca m’a fait beaucoup de bien, en fait (rires). Ma position sur Disney est très ambiguë. Je ne suis pas dans une critique frontale, c’est une culture qui fait partie de moi. J’ai fredonné toute ma vie des chansons de Disney. Le rêve de Walt Disney père est magnifique, fascinant. Mais c’est toujours le dilemme entre la carte et le territoire : c’est-à-dire qu’au début, on s’intéresse à la carte, au projet, au dessin. Et puis à un moment, c’est le vertige du double, quand la ville devient réelle. C’est un thème Borgesien ou Hitchcockien, comme on veut. Un jour, la ville n’est plus une maquette, elle est habitée par des êtres de chair et d’os, dont la destinée va se voir façonnée par cette ville. C’est précisément sur ce point que La Chanson est aussi politique.
Comment s’est passé le déroulement de ton film, de son écriture à sa post-production ?
J’ai déposé au CNC une première version du scénario fin 2015. On nous a alors donné le droit de nous représenter, puis on a eu l’aide à la réécriture dans un second temps. Ensuite, j’ai travaillé avec une scénariste qui s’appelle Clémence Madeleine-Perdrillat. Comme les personnages, l’univers et l’histoire étaient déjà là, Clémence m’a surtout donné les clés pour que mon scénario soit plus lisible, elle sait comment les gens lisent les projets en commission. Elle a vraiment fait preuve de pédagogie. Après, nous avons touché la contribution financière du CNC.
Le tournage a duré deux fois 5 jours. Nous avons eu pas mal de soucis avec Disney qui nous donnaient des autorisations de tournage puis nous les refusaient au dernier moment. J’ai donc dû beaucoup réécrire la veille pour le lendemain et adapter mes scènes dans de nouveaux décors.
Concernant la post-production, nous avons eu un peu plus de deux semaines de montage image, une semaine de montage son, quatre jours d’étalonnage et quatre jours de mix. Les chansons du film (sauf la première, composé par Noémie Gantier, Victoria Quesnel et moi-même) ont été écrites par Guillaume Bachelé. Nous travaillons aussi ensemble au théâtre, nous avons une langue commune, ce qui rend le travail plus fluide.

D’où est venue ta vocation artistique et quelles sont tes références cinématographiques ?
J’ai un père curieux, généreux qui m’a montré beaucoup de comédies musicales quand j’étais petite. J’ai aussi vu beaucoup de films de genre avec mes frères. Puis mon père, à un moment travaillait chez Hachette et il rentrait avec des DVD gratuits. Parfois, on ne les ouvrait pas, ils restaient sous plastique. Mais d’autres fois on les ouvrait. Je me souviens avoir vu Les Idiots de Lars von Trier, comme ça (rires).
Avec le théâtre, j’ai découvert Bergman, Rohmer. Et aussi Dumont, Haneke qui m’ont fascinée sur cette question du régime de l’image. On se pose alors la question de l’origine des images : d’où viennent-elles ? Sont-elles fictionnelles ? Documentaires ? Quelles sont leurs portées ? Quel est le point de vue de l’auteur ?… Avec Rohmer, j’ai découvert l’intensité du dialogue et les questions philosophiques qui peuvent surgir d’une histoire très simple.
J’ai aussi fait une option cinéma à la fac. C’est là que j’ai découvert Hitchcock. Hitchcock, c’est magnifique pour apprendre à lire un film. Ensuite, j’ai suivi un parcours plus autodidacte : je passe des heures sur le site du Forum des Images. Je suis quelqu’un qui ne s’ennuie pas du tout devant une master class. J’adore les gens qui passent des heures à décortiquer quatre plans. Le cinéma a cette vertu d’être totalement divertissant et d’être en même temps une source de savoir inépuisable. Le cinéma est l’art où la pensée, le spectaculaire et l’émotion pure sont compatibles. Aller au cinéma me remet toujours dans un état de petite enfance. Parce que c’est une expérience intense et que face à l’écran, on se sent tout petit.
Si tu devais me citer un court-métrage qui a marqué ta vie…
Boro in the box de Bertrand Mandico et peut-être aussi La Boulangère de Monceau d’Eric Rohmer.
Propos recueillis par Pierre Le Gall
Article associé : la critique du film