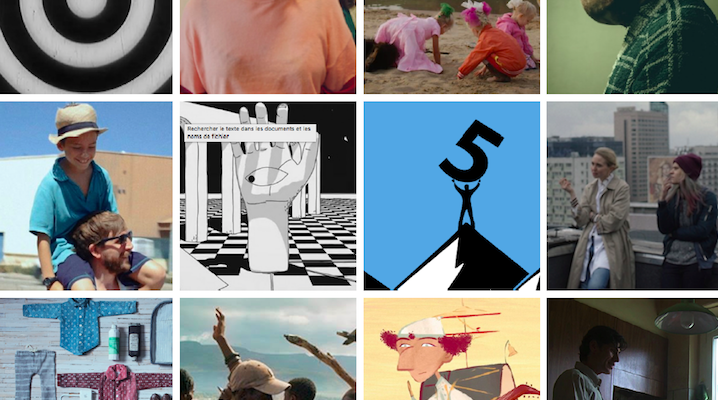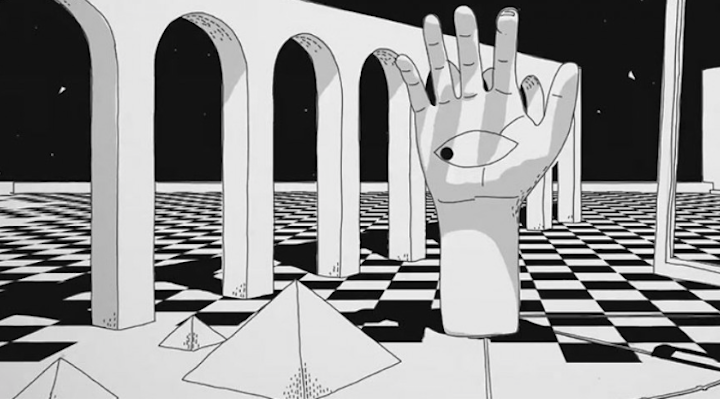Clément Cogitore cinéaste et vidéaste plasticien, très présent dans l’actualité de ce début d’année, était membre du jury des longs-métrages au festival d’Angers le mois dernier. Il présente au Festival de Clermont plusieurs courts-métrages dont Braguino, western sibérien alternant entre douceur et rigueur ou encore Les Indes Galantes, oeuvre théâtrale qui mêle danse urbaine et musique baroque. Se démarquant par une approche résolument contemporaine dans le monde du cinéma, il alterne et mélange les genres dans ce qu’il appelle le Cinéma avec un grand C, un cinéma qui est partout, dans les salles obscures ou entre quatre murs blancs.

© Johann Bouche Pillon
Tu as étudié au Fresnoy. Qu’est-ce que cela t’a apporté ? As-tu cherché à te libérer de cette école par la suite, sortir du cadre ?
Tout d’abord j’ai fait une école d’art à Strasbourg, puis ensuite, je suis allé au Fresnoy. Je ne la considère pas comme une école mais plutôt comme un lieu de rencontres et de production. On rencontre des réalisateurs, des artistes de toutes disciplines, des techniciens. J’ai pu suivre des gens de ma promo qui sont devenus des amis ou des réalisateurs et artistes avec qui il m’arrive régulièrement d’être programmé en festivals et dans des expositions. (Damien Manivel, Bertrand Dezoteux, Gabriel Abrantes…) Je n’ai pas vraiment eu à m’en libérer car il n’y a pas vraiment de cadre. Il y a une grande liberté au sein de l’école.
En ce début d’année, tu as été membre du jury des longs-métrages à Angers et tu a trois films courts en sélection à Clermont-Ferrand. Qu’est-ce qui t’intéresse dans cet aller-retour entre court et long ? Qu’est-ce que le court t’apporte par rapport au long ? Te pose-tu la question de la visibilité de tes courts ?
Je ne me pose pas la question de durée, c’est plutôt une décision arbitraire car il n’y a pas de règles pour moi. C’est le Cinéma avant tout qui m’intéresse. Les questions de durée me semblent bien loin derrière l’amour du cinéma. Même en tant que spectateur, je prends autant de plaisir à voir des films ultra courts, que des séries Netflix ou des longs-métrages de fiction. Il y a aussi des films très court qui ont changé ma vie. J’apprécie beaucoup par exemple un film de Malcolm le Grice intitulé Berlin Horse.
Pour la visibilité, je me pose moins la question également. C’est le film au sens large du terme qui m’intéresse – le cinéma en général. Pour moi, les deux se confondent.
On parle souvent de deux mondes bien distincts entre l’art contemporain et le cinéma, on sent que ton travail casse certaines frontières car il est montré à la fois dans les galeries et les musées et également au cinéma. Comment te perçois-tu par rapport à cela ? Qu’est-ce que ces différents lieux de diffusion t’apportent ?
Oui, je ne suis pas le premier ni le dernier. Ce sont des manières de produire différemment, de penser différemment les images. C’est pour moi aussi une idée de remettre en question ma manière de faire un film.
Par exemple, dans un espace d’art contemporain, ce que l’on veut avant tout, ce sont des prototypes. Dans une salle de cinéma, l’objet que l’on va fabriquer est cher et produit de manière industrielle (même pour un film d’auteur). Le cinéma, c’est aussi une industrie, la questions de la rentabilité se pose donc.
Notre rêve à tous, réalisateurs/trices, c’est de faire des prototypes dans cette industrie-là. C’est assez dur. Les contraintes d’un scénario, d’un récit sont fortes et la question à se poser, c’est comment réinventer tout cela. Dans un musée ou une galerie, il y a beaucoup plus de liberté sur la manière de raconter ou celle dont sont fabriquées les images et comment on les montre, alors qu’au cinéma les choses sont plus rigides. En revanche, dans un film produit pour le cinéma, on a une force de frappe que l’on a rarement. Et ces moyens-là, nous ne les avons pas (ou peu) dans l’espace de la galerie.
Si on évoque ton court-métrage Les Indes galantes, qu’est-ce qui t’a intéressé dans ce projet commandé par l’Opéra de Paris ?
Il s’agit d’une carte blanche de l’Opéra de Paris pour leur collection 3ème Scène. J’avais cette idée depuis un moment et j’attendais l’occasion pour la mener à bien et l’Opéra est arrivé un peu comme une bonne fée. Le film a pu se faire grâce à eux.
C’est un film à la fois très écrit et pas du tout écrit, c’est un mélange assez radical, assez simple mais aussi assez rigide, c’est-à-dire une scène noire, une douche de lumière avec un groupe de spectateurs-danseurs et des danseurs au milieu qui se relayent avec des parties chorégraphiées et d’autres improvisées.
Il y a des moments précis où l’on savait exactement ce qui allait se passer et puis entre ces brefs moment, c’était totalement improvisé car un danseur pouvait réaliser tel ou tel geste et je ne maîtrisais pas forcément grand-chose à cet instant-là.
On savait juste qu’en tournant, à chaque prise, on dirigeait chaque danseur en lui disant :“ Tu vas arriver à la suite de cet autre danseur”, chose qu’on répétait à tous les participants. Ensuite, c’est parti et advienne que pourra. Le tournage s’est fait sur un temps très court et très intense et cela a donné un film de 6 minutes environ.
Vous avez d’ailleurs fait des arrangements sur la musique des Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau ?
Oui, on a rajouté un support de percussion et les arrangements ont été faits par Thomas Debordes et Arnaud Toulon. Il y a à la base beaucoup de percussions pour cette musique, mais ce sont des partitions qui sont assez peu écrites en terme d’orchestration. La musique peut se jouer dans des orchestres très différents en fonction des chefs et des ensembles, il peut y avoir beaucoup de percussions comme pas du tout. Dans la musique romantique par exemple, les choses sont vraiment écrites et tout est détaillé dans les moindres détails sur les accords et les notes (comme Wagner par exemple). La, c’est de la musique baroque, elle est beaucoup moins écrite et est, donc, beaucoup plus souple dans sa manière de s’orchestrer.
Braguino ton dernier film, se focalise sur les paysages du nord et isolés, tu as déjà travaillé sur ces lieux avec l’intervalle de résonance. Y a t-il une raison spécifique ? Une attache particulière à ces endroits ?
Pas spécialement, juste avant, j’ai fait mon long-métrage “Ni le ciel, ni la terre” qui abordait plutôt les grands espaces du sud. Il y a ce côté western dans Braguino comme il y a aussi dans “Ni le ciel ni la terre”. C’est la confrontation entre l’homme et le paysage qui m’intéresse et cela amène très vite ce côté western dans mes films. Ce genre là peut se décliner dans tous les univers possibles et inimaginables. Je cherche une manière de faire rentrer du cinéma par la confrontation des corps avec le paysage, et les grands espaces le permettent beaucoup plus que la ville et les intérieurs.
En tout cas, pour l’instant, ce sont des choses qui m’intéresse même si mes prochains films ne vont pas vers cela.
Peux-tu nous raconter le processus de tournage de Braguino, qui s’intéresse à une famille russe habitant dans un lieu isolé de Sibérie et comment tu as amené une équipe là-bas ? As-tu rencontré des problèmes notamment avec la barrière de la langue ?
Il y a beaucoup de réalisateurs qui tournent comme moi avec des interprètes. Je baragouine aussi un peu de russe, je me repère avec quelques mots et j’ai toujours un décalage sur ce qui est en train de se passer, donc je n’ai pas le sens exact mais avec l’interprète, je sais ce qu’il se dit. Quelquefois, lors d’entretiens, si je veux avoir certaines informations, j’arrête et je demande si une phrase en particulier à été dite exactement de la manière que je cherche ou non.
Parfois, je laisse les choses totalement vivre, ensuite je parle avec l’interprète qui me dit ce qu’il s’est passé ou ce qui a été dit, mais c’est sur la table de montage que je vois exactement ce dont je dispose, avec la transcription des rushes.

Ensuite pour aller là-bas, nous étions dans un hélicoptère 5 places. Il y avait le pilote, l’équipe de tournage et une place occupée par tout le matériel et un groupe électrogène pour être totalement autonome en énergie. Un peu comme la famille Braguine que j’ai filmé, qui économise ses ressources au maximum, nous avons fait pareil.
Les Braguine, lorsqu’ils tuent un ours, ils prennent ses viscères pour la médecine chinoise, la fourrure pour les tapis, et les pieds pour en faire des chaussons. Nous, nous avons calculé les litres d’essence nécessaires pour le groupe électrogène, pour recharger les batteries des caméras et pour tout autre nécessité énergétique. Il y avait en quelque sorte une économie du tournage qui était assez proche de l’économie d’autarcie et de survie de la famille que j’ai filmé.
Quel regard portes-tu sur le court-métrage ? Y a t-il un essoufflement ou un regain d’énergie chez les réalisateurs d’aujourd’hui ? Certains réalisateurs t’intéressent-ils plus particulièrement ?
Je n’ai pas vraiment d’avis général. J’ai été Président du prix de qualité au CNC (aide après réalisation aux films de court métrage) l’année dernière. Je voyais donc des films qui demandaient de l’aide après réalisation et souvent, il y avait deux-trois films qui étaient vraiment très bien, beaucoup de choses étaient bien faites. D’autres films étaient moins intéressants.
Quels sont tes futurs projets ?
J’ai un long-métrage de fiction qui est en écriture mais je n’ai pas de date de tournage précise. Je ne sais pas non plus quand on arrivera au bout mais ce sera tourné intégralement à Paris. Je suis également artiste associé au Palais de Tokyo pour une exposition prévue à l’été 2018 où je conçois des installations autour du thème de l’enfance.

Il y a aussi un troisième gros projet qui est la préparation d’une mise en scène d’opéra pour l’Opéra de Paris pour septembre 2019. Il s’agit d’une ne mise en scène de l’intégralité des Indes Galantes à l’Opéra Bastille. Il y aura de la danse urbaine mais pas seulement. Il y a beaucoup d’éléments que je veux exploiter dans les Indes Galantes, il y aura donc une diversité visuelle en réponse à la diversité de l’oeuvre.
Propos recueillis par Clément Beraud
Articles associés : la critiques des Indes Galantes, celle de Braguino