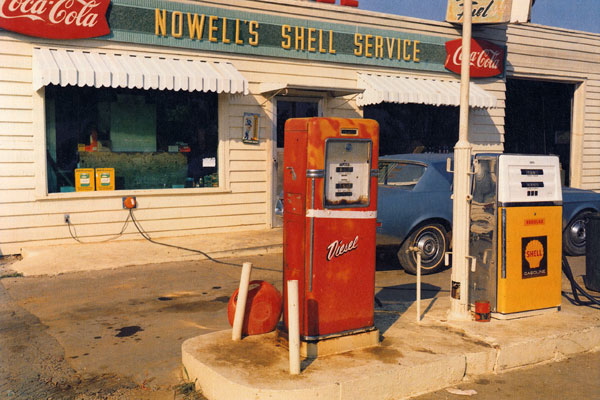Natalia Garagiola, petit bout de femme argentine, est venue pour la première fois cette année au Festival de Cannes afin d’y présenter, en compagnie de ses deux producteurs, son film « Yeguas y cotorras » sélectionné à la 52ème Semaine de la Critique. Sous sa carapace, la jeune réalisatrice semble finalement assez fragile et un peu perdue au cœur du plus grand festival de cinéma au monde. Lors d’une brève interview (d’autres, nombreux, attendent leur tour), elle nous a livré des clefs pour mieux comprendre son film, évoquant les conflits féminins au sein de la jeune aristocratie de Buenos Aires.

© CM
Ton film « Yeguas y cotorras » a été sélectionné à la Semaine de la Critique. Comment as-tu pris la nouvelle ?
Dans un premier temps, j’ai bien sûr été très heureuse; puis j’ai eu un peu peur car je sais qu’à Cannes, le niveau est très exigeant. Je ne savais pas avec qui j’allais concourir, ni à qui j’allais présenter mon travail au festival. Mais au final tout de même, j’étais, et je suis, très contente. Qui plus est, j’ai vu ensuite le programme avec les autres films et ça m’a tranquillisée.
Le film traite de trois jeunes filles, trois meilleures amies et de leurs questionnements autour de la vie de femme en particulier. Ton premier film, « Rincon de Lopez », tournait autour de trois petites filles. Comment expliques-tu cet attrait pour un univers si féminin ?
En réalité, c’est un univers dans lequel je me sens à l’aise. Cela me vient du passé. Dans mon lycée, il n’y avait quasiment que des garçons, tandis que je suis allée dans un collège composé uniquement de filles. J’ai donc pu analyser les relations depuis divers points de vue : celui des filles entre elles, et celui des filles face aux garçons. J’aime sentir cette attraction sexuelle qu’il y a entre les filles et les garçons, de la même manière que j’apprécie observer les liens entre les filles. Il y a bien évidemment une différence relationnelle entre les hommes et les femmes qui m’intéresse beaucoup.
Dans ton court métrage, tu évoques l’enfermement, la fin de la liberté, pour l’une des jeunes filles qui va se marier et l’autre qui est enceinte. Seule celle qui ne rentre pas dans ce schéma semble être libre. Doit-on y voir un rapport avec la condition féminine en Argentine ?
Oui et non en fait. Disons que selon moi, ça vient plus volontiers du contexte social et non pas du genre ou de la culture. Ici, bien entendu, on peut y voir une question de genre puisqu’il n’y a que des femmes à l’écran, ici en Argentine, mais en réalité, je ne pense pas que les femmes en Argentine souffrent d’un machisme plus important qu’ailleurs. Dans ce cas, l’enfermement est beaucoup plus dû à la classe sociale. Je souhaitais montrer comment, dans certaines familles conventionnelles et traditionnelles, il y a des règles à suivre. J’aurais tout à fait pu évoquer ce thème des classes sociales avec des hommes, mais j’ai juste préféré traiter ça ici, du point de vue féminin. Et si on se penche vraiment sur le film, on s’aperçoit que le personnage d’Alvaro va aussi se marier avec une personne qu’il n’aime pas. Ces personnages savent qu’ils doivent faire certaines choses et ils se posent à peine de questions car ils savent que c’est un passage obligé. Ils sont angoissés, certes, mais jamais ils ne s’imaginent pouvoir dire « non » ou renoncer car ils occupent tous des rôles assumés. Ce sont généralement des personnes assez mal élevées qui passent leur temps à dire et à faire ce dont elles ont envie sans vraiment se soucier des autres, et pourtant, sont-elles plus heureuses que les autres ? Il est vrai que c’est univers-là me fascine, et d’autant plus que j’ai fait des études de cinéma avec des gens issus de classes privilégiées que j’ai pu observer à loisir.

À propos de cinéma, as-tu des références de réalisateurs sur lesquels s’appuie ton travail ?
Oui et non. J’en ai certainement mais je n’ai pas cherché à en avoir avec ce court métrage en réalité.
Peut-on se permettre de comparer ton travail à celui de Sofia Coppola ?
Oui, on m’a déjà dit qu’il y avait des similitudes avec ses films et son univers, surtout et justement pour les niveaux sociaux qu’elle traite elle aussi. J’aime énormément ce qu’elle fait et il est vrai qu’elle possède également un univers très féminin qui a beaucoup d’impact sur moi. Dans mon film, on retrouve un peu les mêmes décors chics ainsi que des personnages féminins, toutes les trois très beaux. En effet, d’autres me l’ont déjà fait remarquer, mais je ne sais pas si j’ai cherché à m’y référer consciemment.
Ces trois actrices si belles justement, tu avais déjà pensé à elles avant de faire le film ?
Disons que je suis assez instinctive avec ça. En réalité, j’ai terminé le scénario en sept mois, plus ou moins et au début de l’écriture, je souhaitais travailler avec des comédiennes très expérimentées. Puis, au fil de l’écriture, j’ai eu envie d’actrices peut-être moins connues, mais avec qui on vivrait une réelle expérience et qui conviendraient par conséquent plus à ce que je faisais. Et au final, entre une chose et l’autre, j’ai fini par chercher dans un registre de comédiennes semi-professionnelles. Si bien qu’on obtient la présence de Julia Martínez Rubio, interprétant Delfina et étant expérimentée et les deux autres comédiennes, un peu plus débutantes. En fait, Guillermina Pico est réalisatrice et pour la première fois, ou presque, elle est passée devant la caméra. Je la connaissais d’un autre contexte et je pensais qu’elle conviendrait bien au rôle. Elle a lu le scénario et ça lui a plu. À elles trois, elles ont réussi à donner la fraîcheur que je souhaitais pour le film, à la fois structurée et moins structurée.
Si je te cite le film « Abrir puertas y ventanas » de Milagros Mumenthaler, ça te dit quelque chose ? Que penses-tu du travail de cette réalisatrice, également argentine ?
On m’a beaucoup parlé de ce film également, mais je ne l’ai pas encore vu. Et il est vrai qu’apparemment, on peut comparer mon travail au sien puisqu’il s’agit encore une fois de questions de femmes, ici de trois sœurs, d’une classe sociale élevée, à cheval entre les conventions qu’elles doivent suivre et ce qu’elles ont réellement envie de faire. A l’identique, elles se retrouvent seules, dans une grande maison familiale.

Cliquer sur l’image pour voir le film
La maison où l’intrigue a lieu est imposante, belle et chic, un temps soit peu d’un style colonial. Comment as-tu trouvé ce décor idéal ?
On a tourné dans la maison de famille d’un des producteurs, dans les alentours de Buenos Aires. Il vient d’une grande famille, assez privilégiée et cette maison leur appartient depuis plusieurs générations. C’était idyllique car la maison est énorme, si bien qu’on disposait de tout l’espace nécessaire non seulement au tournage, mais aussi aux besoins du tournage. Je ne sais pas si les personnes qui y résidaient étaient très friandes qu’il y ait un tournage dans leur maison, mais on a tâché de prendre beaucoup de précautions en étant sur place.
Combien de jours a duré le tournage ?
Pour toutes les scènes dans la maison, le tournage a duré cinq jours ; après, il y a eu un jour supplémentaire pour tourner dans un champ assez proche de Buenos Aires.
Peux-tu nous expliquer le choix de ton titre qui, littéralement en français, signifie « Juments et perruches » ?
Il reprend les deux moments forts et centraux du film, c’est-à-dire la scène du début durant laquelle Delfina chasse des perruches de manière assez violente et sauvage alors qu’elle appartient à une famille conventionnelle. Cela représente un aspect assez névrosé qu’elle porte en elle à cause du bruit provoqué par ces perruches qui l’insupporte sans qu’elle sache réellement pourquoi. Sans compter cette autre scène, plus proche de la finn durant laquelle toutes les trois rappellent un accident survenu avec une jument : Delfina en était tombée étant enfant et son père avait envoyé la dite jument à l’abattoir. De cette façon, on se rend ainsi compte de la manière dont on prend soin de cette jeune fille depuis qu’elle est petite et du pouvoir de ses parents sur la vie ou la mort d’un animal. Mais ce titre possède un double sens : en Argentine, lorsqu’on compare les filles – généralement de bonnes familles – à des juments et des perruches, c’est pour caractériser leur côté mauvais et pipelette. Et justement, mon court métrage reprend un peu cette idée.
Pour terminer, peux-tu nous dire ce que représente pour toi, le format du court métrage ? Et avec ça, nous dire quels sont tes projets ?
Pour moi, il s’agit d’un format très confortable, même si depuis le début, j’ai utilisé le court métrage de deux manières très différentes. Dans mon premier film, j’avais profité du format court pour réaliser un travail très minimaliste avec seulement deux plans très radicaux. Tandis qu’avec ce deuxième film, mon ambition était vraiment de me préparer au long-métrage ou plus exactement, de prouver que j’en étais capable en montrant ma relation à l’image, aux comédiens et au langage audiovisuel en général. Et en réalité, j’en suis plutôt satisfaite.
Propos recueillis par Camille Monin
Consulter la fiche technique du film
Article associé : la critique du film