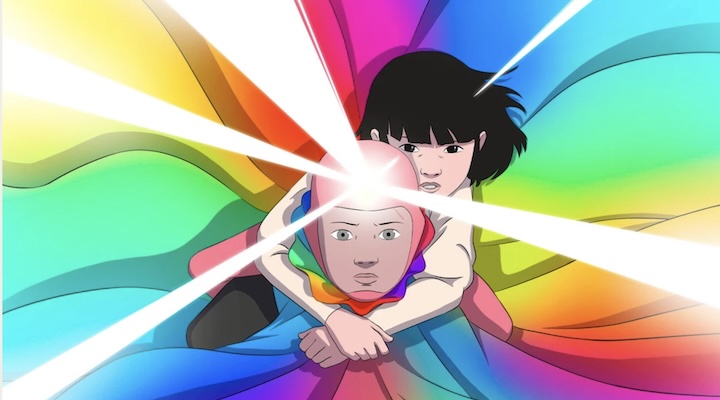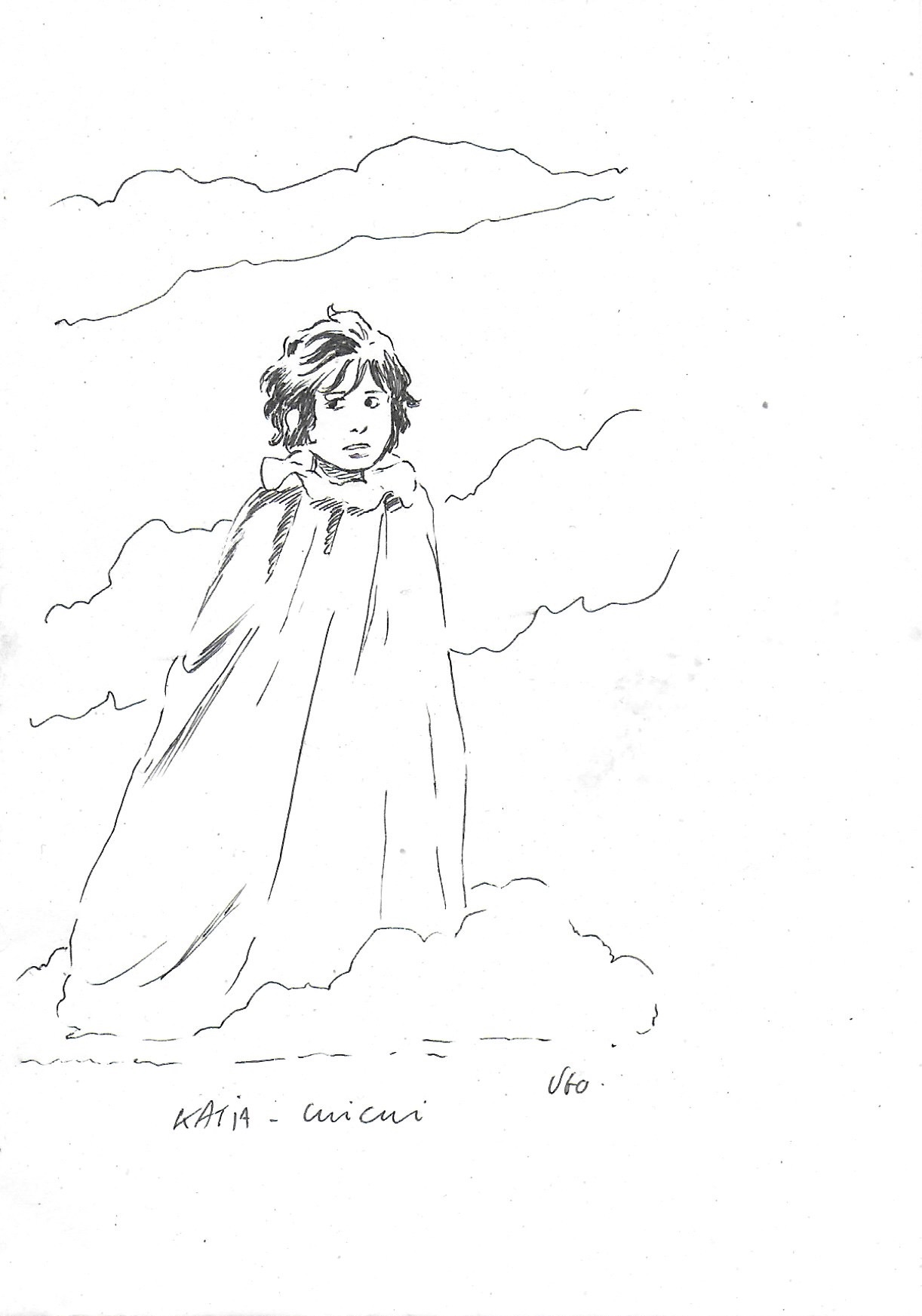Retour sur Cannes et sur les courts métrages de la Cinef, cette sélection qui se concentre sur les films d’études. Cette année, le jury similaire à celui des courts métrages et présidé par la réalisatrice, scénariste et productrice Maren Ade, a remis le premier prix au film First Summer, un court métrage de Heo Gayoung, également lauréate du prix Lights On Women’s Worth (prix L’Oréal). La réalisatrice sud-coréenne met en scène une femme âgée qui défie les conjonctions sociétales en préférant assister à la messe de commémoration de son petit ami plutôt que d’aller au mariage de sa petite-fille. Un portrait rare sur la vieillesse, sur la féminité passé la jeunesse, le désir et l’émancipation. Heo Gayoung s’est entretenu avec Format Court, elle nous parle des origines du film et de sa réception auprès des personnes âgées, notamment en France à Cannes.

Format Court : Les femmes âgées ne sont généralement pas les personnages principaux dans les films. Pouvez-vous nous parler de l’idée de traiter l’histoire du point de vue d’une d’entre elles ?
Heo Gayong : Ce film est né d’une interview avec ma grand-mère. J’ai vécu avec ma grand-mère pendant six mois. Nous étions seules toutes les deux, mais j’ai toujours trouvé ma grand-mère étrange, car elle n’était pas comme les grand-mères coréennes habituelles, que l’on imagine généralement chaleureuses, attentionnées envers leur petite-fille ou leur famille, et souvent confinées à la maison et aux tâches ménagères. Ma grand-mère n’était pas comme ça. Elle était toujours bien habillée et très élégante. Même si elle n’avait pas beaucoup d’argent. Elle n’était pas très riche, mais elle essayait toujours de prendre soin d’elle-même. J’ai donc des souvenirs très précis, comme le fait qu’elle mettait toujours un masque facial tous les soirs, mais qu’elle ne m’en a jamais donné un. C’est comme si elle ne se souciait pas de moi, même si nous vivions ensemble. Je me sentais donc toujours éloignée d’elle et je me demandais pourquoi ma grand-mère agissait toujours de cette manière très étrange. J’avais l’impression qu’elle ne m’aimait pas, même si je faisais partie de sa famille. Je me posais donc des questions et je me sentais éloignée d’elle. Le temps a passé, j’ai quitté la maison de ma grand-mère, je suis entrée à l’université et un professeur m’a donné un devoir à faire. Il s’agissait d’interviewer des personnes âgées et je suis retournée chez ma grand-mère. Nous avons beaucoup discuté à cette occasion. En fait, je pense que c’était la première fois que je parlais avec ma grand-mère, car nous ne communiquions que très peu lorsque nous vivions ensemble. Pendant l’entretien, j’ai été très surprise, car cela a brisé tous mes stéréotypes sur les personnes âgées. La première question était : « Comment vas-tu ? ». Elle m’a répondu qu’elle prenait des médicaments pour dormir car elle s’inquiétait pour son petit ami. Il ne lui avait plus donné de nouvelles. Elle se sentait très mal à ce sujet. J’ai été très choquée, car je n’aurais jamais imaginé que ma grand-mère avait un petit ami. Elle m’a parlé de sa vie et de ce qu’elle ressentait avec son petit ami ou lorsqu’elle dansait. J’ai donc eu une idée à partir de cette interview. Je veux simplement montrer à quel point la vie des personnes âgées est variée et que nous devrions parler de leur sexualité, de leur amour et même de leurs rêves, de leur vie, car nous n’en parlons pas en Corée.
Vous abordez également le conditionnement d’une femme au sein de la famille mais aussi de la société, était-ce important pour vous d’évoquer ce sujet ?
HG : Oui, je pense que oui. C’est pour cela que je réalise des films, car j’ai toujours envie de parler des minorités en Corée. Donc, en général, je parle toujours de la vie des femmes et des droits des femmes, les droits humains en Corée. Il y a tellement de vies différentes là-bas, mais nous n’en parlons pas et nous ne les voyons même pas dans la société coréenne. Je sens aussi que beaucoup de femmes se sont sacrifiées pour cette société, mais elles essaient toujours de se retrouver. Je veux donc parler de ce genre de personnages, de vies, parce que je veux transmettre cette valeur aux gens à travers mon film. C’est donc une partie très importante de la réalisation de mes films.
Était-ce difficile de tourner cela en Corée ?
HG : Oui, en quelque sorte. Je ne sais pas. Parce qu’il y a beaucoup de films sur les femmes, mais j’ai quand même l’impression qu’il en faut davantage.

Et que pensez-vous du fait d’être une femme réalisatrice en Corée ?
HG : La société coréenne évolue très rapidement et, comparé à la génération de ma mère, je pense que j’ai beaucoup de chance. J’ai également reçu une bonne éducation et il y a beaucoup de femmes cinéastes. Nous travaillons avec des hommes et il y a beaucoup de réalisatrices. Mais parfois, je me sens déprimée ou frustrée, car j’ai besoin de plus d’ « empowering » [émancipation]. Il n’y a toujours pas beaucoup de réalisatrices connues en Corée, parce que j’ai l’impression que le tournage et le plateau sont une atmosphère parfois très masculine et pas très favorable aux femmes. Je pense donc que j’ai besoin de plus de modèles. Et je veux aussi devenir un modèle pour mes collègues, mes collègues féminines. Je veux inciter la prochaine génération de femmes à devenir réalisatrices.
Et pouvez-vous nous parler du langage symbolique utilisé dans le film, en particulier de la figure du papillon ?
HG : Il y a beaucoup de symboles dans mon film. Les papillons sont sans doute le symbole le plus important, car ils sont très courants dans la poésie ou les romans, beaucoup de gens considérant les femmes comme des papillons. Mais j’avais l’impression que Yeongsun, mon personnage principal, était toujours prisonnière ou coincée dans sa maison, et que sa vie avait été prise par la société, sa famille ou autre. J’avais l’impression que mon personnage principal, comme le papillon, était coincé dans une cage. Je voulais donc la libérer à la fin du film, en particulier dans le temple. Je voulais voir mon personnage principal voler, danser, comme dans le temple, rien que pour elle-même. C’est pourquoi j’ai créé ce symbole du papillon piégé dans la maison, mais qui finit par être libéré de sa cage et s’envole pour danser tout seul.
Comment avez-vous travaillé l’écriture du scénario?
HG : C’était très dur. Je pense que c’était la partie la plus difficile quand j’ai écrit le scénario, parce que ça parlait de ma grand-mère et aussi parce j’avais peur de blesser les femmes coréennes. Le film parle de personnes âgées, mais je ne suis pas vielle, donc c’était très difficile de ressentir ce que ressentait ou faisait mon personnage principal, car je n’ai jamais connu la vieillesse et je ne pouvais pas imaginer ce que ressentent les femmes âgées après avoir fait l’amour ou après avoir marché longtemps. Je ne pouvais pas ressentir cela physiquement. C’était très difficile, j’avais peur de faire semblant, car je ne voulais pas blesser les personnes âgées avec mon « faux » film. Ma grand-mère est décédée, je ne pouvais donc plus lui parler, alors je me suis rendue au club de mon film, un club pour personnes âgées. J’en ai rencontré beaucoup et j’ai simplement essayé de comprendre comment se déroulait leur vie. Et puis, mon actrice a le même âge que mon personnage principal, elle a environ 74 ans, et elle m’a beaucoup apporté. Je pense qu’elle a complété mon film, car elle a fait ce que je ne pouvais pas faire. Cela a donc été très difficile de travailler avec des personnes que j’aimais et d’autres que je ne pouvais pas avoir, mais j’ai quand même fait de mon mieux.
Avez-vous montré le film à des personnes âgées ?
HG : Oui, oui, je l’ai fait.

Et qu’en ont-elles pensé ?
HG : Je pense que ça a été la meilleure expérience avec mon film, parce que beaucoup de personnes âgées sont venues me voir et m’ont dit : « Oh, ton film me donne du courage ». Elles ont aussi ressenti de la chaleur. C’était incroyable d’entendre ce genre de commentaires de la part de personnes âgées parce que c’était très significatif et je pense qu’elles ont repensé à leur vie grâce à mon film. Et même à Cannes, j’ai rencontré de nombreuses personnes âgées de différents pays, même des Françaises, des grand-mères françaises, qui sont venues me parler de mon film et qui ont ressenti la même chose que mon personnage principal. Ce fut une expérience très incroyable pour moi. Je tiens simplement à les remercier.
Travaillez-vous sur un nouveau projet ? Le lauréat du prix Cinef voit son premier long-métrage sélectionné à Cannes. Ressentez-vous une certaine pression ?
HG : Oui, je travaille actuellement sur un nouveau scénario pour un long métrage. Et même maintenant, j’ai l’impression de rêver. J’ai été récompensé à Cannes, je suis très reconnaissante de pouvoir avoir l’opportunité de réaliser un nouveau film. Je pense que cela va être un peu plus facile en Corée, car ils veulent investir dans mon projet puisque mon nouveau long-métrage peut être présenté à Cannes. Je suis donc très reconnaissante d’avoir cette opportunité. Je prévois de réaliser mon prochain long métrage dans deux ou trois ans. Alors oui, nous verrons bien.
Propos recueillis par Garance Alegria
Article associé : la critique du film