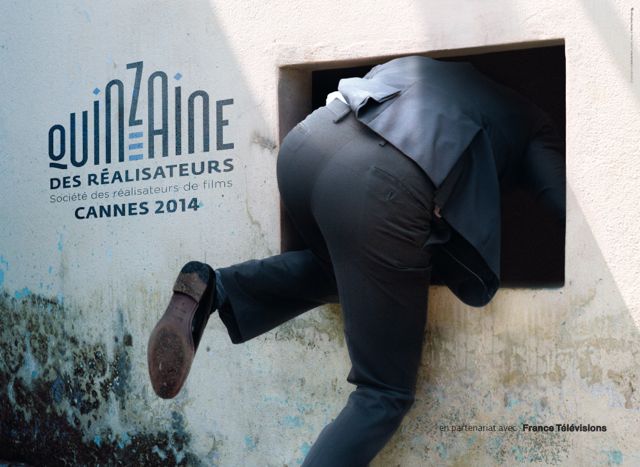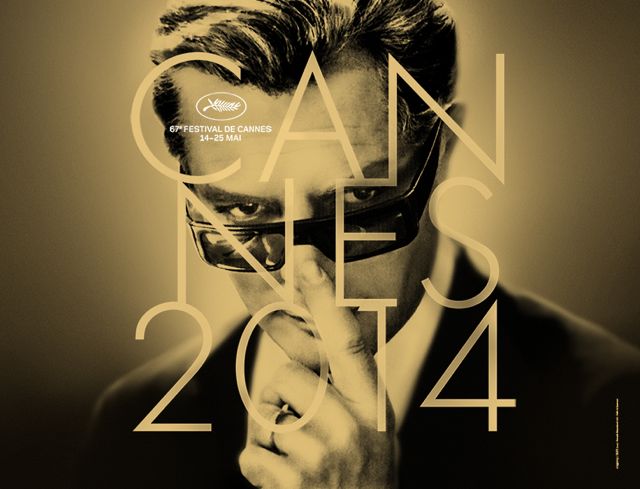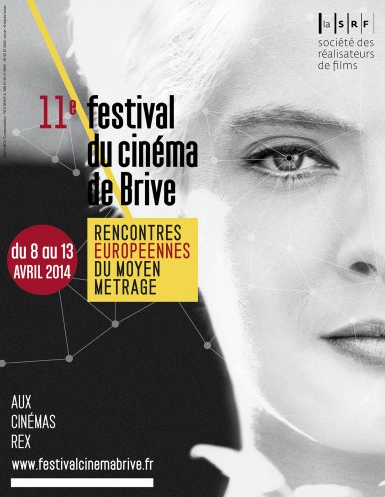La onzième édition des Rencontres du moyen-métrage de Brive s’est achevée le 13 avril dernier au terme de cinq jours de festival bien remplis. La compétition européenne, les rétrospectives et autres projections parallèles, le workshop de pitch ont émaillé ces quelques journées de (re)découvertes, de surprises, de déceptions et de promesses.
Le festival de Brive a acquis, en dix ans d’existence, le statut de catalyseur et de révélateur des jeunes talents du cinéma français. Force est de constater que nombre d’auteurs remarqués y ont fait leurs gammes, profitant de la fidélité des sélectionneurs pour présenter au fil des ans leurs premières réalisations. Justine Triet, Arthur Harari, Sébastien Betbeder, Shanti Masud ou encore Yann Gonzalez, cinéastes aujourd’hui passés au long-métrage pour la plus part, se sont auparavant approprié ce format un peu ingrat mais follement libérateur qu’est le moyen-métrage pour expérimenter, chercher de nouvelles formes et proposer des films singuliers.

© Marc-Antoine Vaugeois
La compétition
Cette année, certains habitués étaient de retour (Shanti Masud avec « Métamorphoses », Arthur Harari avec « Peine perdue ») au milieu de nouveaux arrivants. Parmi eux, quelques têtes déjà connues de Format Court (Karim Moussaoui et son film « Les Jours d’avant », reparti du festival avec deux mentions, Pagel G. Vesnakov et son « Pride », lauréat du Grand Prix Europe), et d’autres découvertes plus ou moins heureuses. De cette compétition européenne de moyens-métrages, que retient-on ? Si l’on peut effectivement vanter l’éclectisme de la sélection des films en compétition, jonglant allègrement entre les genres (drame, comédie, fantastique, film social, de reconstitution…) et les dispositifs (fiction, documentaire), on constate qu’elle inventorie également certaines tendances plus ou moins néfastes de la production de courts-métrages.
Passons donc rapidement sur « Sunny » de Barbara Ott, le film social post-Dardenne dont la paresse formelle (caméra à l’épaule dédouanant la cinéaste de toute question de regard et de mise en scène) dispute au sensationnalisme de son sujet (les tribulations d’un jeune père irresponsable) un opportunisme franchement malsain. Dans un autre registre, « KK » de Wictor Ericsson ne valait pas beaucoup mieux, en privilégiant une photographie léchée et des cadres publicitaires pour enrober d’un emballage clean son histoire d’adolescents suédois jouant à touche-pipi le temps des vacances d’été. Dans un cas comme dans l’autre, les cinéastes se prémunissent de la moindre prise de risques vis-à-vis de leurs sujets, adoptant des partis pris de mise en scène passe-partout leur permettant de filmer n’importe quoi à peu près n’importe comment (le naturalisme tremblé droit dans ses bottes pour l’un, la fausse pudeur enveloppée dans de la joliesse pour l’autre).

La palme du laisser-aller et de la fausse subversion revient néanmoins au film de Jean-Christophe Meurisse, « Il est des nôtres », reparti avec le Prix Ciné + et le Prix du Jury Jeunes. Le metteur en scène attitré de la troupe des Chiens de Navarre tente d’adapter son dispositif théâtral au cinéma, reconduisant un travail sur l’improvisation avec son groupe d’acteurs fétiches réunis autour de la figure de Thomas de Pourquery, musicien marginal installé dans un entrepôt à l’écart de la ville. Il en résulte une succession de scènes déconnectées les unes des autres, égrainées le long d’un fil narratif ténu suivant le déroulé d’une soirée où sont réunis dans la caravane de Thomas une bande de freaks sociaux, petits bourgeois profitant de leur isolement pour babiller sans discontinuer avant de se livrer à des jeux régressifs. L’ennui, c’est que même les acteurs donnent l’impression d’avoir lâché l’affaire, car pris au piège du dispositif, leur jeu se résume à celui qui parlera le plus fort et tirera la couverture à lui. Que reste-t-il, alors ? Une connivence perverse avec le spectateur, invité à se laisser aller comme les comédiens à ses pulsions les plus triviales, les plus régressives, à étaler ses réflexions insignifiantes et ses couilles sur la table. Le réalisateur cite Buñuel et Korine comme références. Tristesse de constater que l’horizon atteint est plus proche des franchouillardises filmées de la troupe du Splendid. « Les bronzés jouent aux cannibales ».
Heureusement, au laisser-aller et à l’opportunisme de certains films, répondaient des œuvres de cinéastes rigoureux, plus soucieux de trouver l’harmonie dans la mise en scène et dans l’écriture.
C’est le cas notamment de « Mahjong », surprenante variation autour des codes du film noir réalisé par le couple de réalisateurs portugais Joao Pedro Rodrigues et Joao Guerra da Mata. En réduisant l’intrigue policière à une peau de chagrin (un homme en costume arpente le plus grand Chinatown du Portugal à la recherche d’indices), les cinéastes procèdent d’une économie savante, distillant à des endroits stratégiques de multiples signes constituant progressivement sinon une fiction, un cadre suffisamment large pour accueillir l’étrangeté de la ville de Varziela. La seule séquence d’introduction donne la mesure des possibilités du dispositif : le héros fait une ronde au volant de sa voiture à travers les rues du township, intégralement filmé en plans-séquences derrière le pare-brise du véhicule. La longueur des plans, leur force contemplative emplit la scène d’une tension dramatique en même temps que se dessine une cartographie de la ville. Le récit, construit comme un jeu de piste qui ne mène nulle-part, nous ballade à travers les lieux communs du genre (une femme disparue, des mafieux, une filature…) et les décors incongrus de Varziela pour un trajet ludique en terres portugaises.
Un autre couple de réalisateurs, français cette fois, avait réalisé un film jumeau de « Mahjong » : Caroline Poggi et Jonathan Vinel, les benjamins de la compétition, venus présenter leur première co-réalisation, le très prisé « Tant qu’il nous reste des fusils à pompes ». Changement de cap, c’est à Bouloc (le village natale de Vinel) que les jeunes cinéastes ont posé leur caméra. De la même manière que pour le couple Rodrigues/Guerra da Mata, c’est en procédant par soustraction que Vinel et Poggi construisent leur fiction. En vidant les rues et les jardins du petit village pavillonnaire avant d’y placer leurs protagonistes, à savoir deux frères faisant face à la perte de leur meilleur ami, les cinéastes réorganisent l’espace et injectent à l’intérieur un imaginaire emprunté au cinéma américain (celui de Gus Van Sant et d’Harmony Korine) et aux jeux-vidéos. Un spleen adolescent traverse le film, charriant avec lui des obsessions qui laissent augurer la redite (la perte, le détachement, l’envie de suicide…). Il n’en est rien. Grâce à une sorte de miracle plastique, le film tient debout tout seul et gagne lui aussi sur le terrain du réenchantement.
Comme antidotes à la grisaille qui imprégnait la majorité des films de la sélection, nous pouvons également citer le détonnant « Ennui, Ennui » de Gabriel Abrantes, film foutraque et imparfait (donc attachant) traversé de visions surréalistes (la scène d’ouverture dans le bureau d’Obama, le drone militaire pris d’états d’âmes ou encore l’incroyable scène de sexe entre Laetitia Dosch et un bédouin). Citons également le très beau « Métamorphoses » de Shanti Masud et sa succession de portraits d’hommes et de femmes guidés par leurs sentiments vers une transformation en créatures fantastiques. À ces visages contrit de désirs, éructant de colère ou crachant une bile haineuse à l’encontre d’un amant invisible, répond le vide de l’espace infini, seul réceptacle capable d’accueillir ce flot de paroles puissantes. On n’a pas vu cette année de vision plus romantique à Brive, excepté peut-être la délicate et sensuelle ronde des désirs organisé par Arthur Harari dans son magnifique « Peine perdue », lauréat du Prix Format Court sur lequel nous reviendrons bientôt (et qui sera projeté au Studio des Ursulines, en présence de l’équipe, le jeudi 8 mai 2014).
Le workshop de pitch
Pour la deuxième année consécutive, le festival a organisé un workshop de pitch réunissant huit participants placés sous la tutelle des réalisatrices Dorothée Lachaud et Pauline Racine. Ils disposaient de deux jours pour préparer chacun un oral de sept minutes présentant leurs projets de moyen-métrage à une assemblée de professionnels (producteurs, représentants de région…). Cet exercice difficile, visiblement douloureux pour certains, a néanmoins eu le mérite de présenter quelques projets singuliers et prometteurs. Celui d’Hubert Viel par exemple, de retour à Brive un an après sa récolte de prix avec le film « Artémis, cœur d’artichaut ». Son nouveau projet, mélange improbable entre « Princess Bride », « Bugsy Malone » et « Les contes de Canterburry » pose une fois de plus un pari curieux : mettre en scène le Moyen-Âge comme âge d’or du féminisme. Gageons que le résultat sera à la hauteur de la dinguerie du concept.

© Marc-Antoine Vaugeois
Une jeune réalisatrice, Doris Lanzmann, a également fait sensation avec son projet doté du titre le plus accrocheur de l’atelier : « Royan la Rage ». Une fiction conçue à partir de la fascination de la jeune cinéaste pour un phénomène internet déroutant : celui des dominatrices financières, comprenez des jeunes femmes instaurant des jeux de soumission avec leurs clients par webcams interposées. Le projet, au scénario très ambitieux, est actuellement en recherche de financements.
Du côté des rétrospectives

Pour conclure, un petit tour d’horizons des rétrospectives proposées par le festival de Brive cette année. On se souvient des films d’Agnès Varda et de Koji Wakamatsu qui ont fait se déplacer de nombreux festivaliers dans les salles. Il y avait également un programme de courts-métrages suisses, réunissant des classiques du genre. À Format Court, nous avons retenu deux courts-métrages rares : « Daïnah la métisse » et « Le 6 juin à l’aube » de Jean Grémillon, cinéaste français fondamental des années 30.
Le premier film est une fiction tournée en 1931 qui suit les mésaventures de Daïnah, une belle métisse courtisée par les bourgeois et les marins du bateau sur lequel elle fait croisière en compagnie de son époux. Le film, d’une inventivité formelle ahurissante et d’une insolence folle, rappelle que les années 30 constituaient un âge d’or du cinéma français, ouvert à la poésie et à la fantaisie des auteurs. En filmant le destin tragique de Daïnah, Grémillon raconte le racisme, la frigidité de la bourgeoisie et les rapports de jalousie et de désir qui empoisonnent le cœur des hommes. Une merveille qui n’as pas pris une ride.
Le second film, en apparence plus classique, retrace minutieusement le déroulement de l’opération Overlord lors du débarquement des troupes américaines en Normandie. À l’aide de séquences animées sur une carte de la France, Grémillon filme la dévoration d’une terre par les ravages de la guerre, insérant des images d’archives rendant compte des scènes de désolation dans laquelle se trouvaient les victimes des bombardements. Le film atteint son acmé dans les séquences documentaires mises en scène par Grémillon lui-même, lorsqu’il va à la rencontre des survivants tentant de reconstruire un semblant d’existence au milieu des décombres. Une scène suffit : un professeur d’école, entouré de ses élèves, donne un cours de géographie dans les ruines d’un village. Leur terre, détruite, défigurée à jamais, reste leur terre. Magistral.
Marc-Antoine Vaugeois