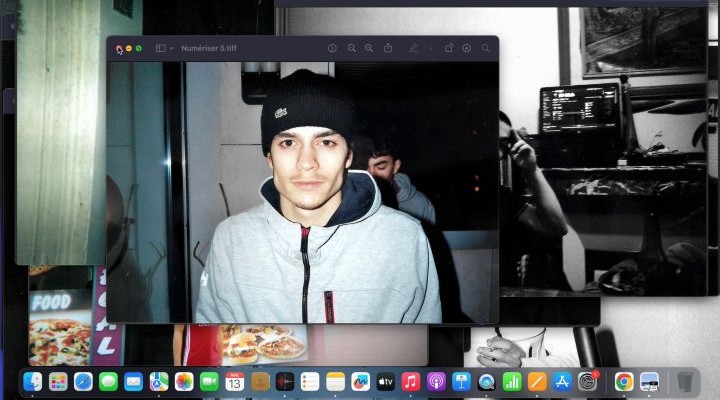Alors qu’il recevait plusieurs prix au Festival de Saint-Jean-de-Luz (Prix du public, Prix du SFCC-prix accordé par des membres du syndicat de la critique de cinéma-, et Prix vision d’avenir) pour son très subtil premier court En Beauté, nous avons eu l’envie d’interroger le jeune cinéaste Rémi Mardini. Il revient pour nous sur ses inspirations, son amour du format court, son parcours et ses envies, qui l’ont mené à réaliser ce premier film sur un couple âgé qui décide de mettre fin à ses jours. Au gré d’un entretien entrecoupé parfois par les imprévus de réseau, le cinéaste et scénariste se raconte avec beaucoup de générosité et de légèreté et effeuille les dessous de son beau film tristement drôle et drôlement triste. Rencontre.

Format Court : Tu es passé par Sciences Politiques Paris, et un master en scénario à Nanterre. À quel moment la voie du cinéma s’est éclairée pour toi ? Quelles sont les traces de ce parcours universitaire dans ton processus créatif ?
Rémi Mardini : L’envie de création est arrivée assez tôt dans mon parcours, dans ma construction en tant que jeune personne. J’ai su assez tôt que je voulais écrire, que j’avais envie d’être scénariste, quand j’ai découvert le cinéma, au début de mon adolescence. Mais je n’avais pas du tout d’entrée dans ce milieu-là. Je viens de Lyon, tout cela me paraissait assez lointain. Mon profil était quand même assez académique. Il y avait cette envie de faire tout de même des études plus classiques, parce que c’est un métier qui peut être assez difficile. Je souhaitais apprendre des choses, avoir un diplôme, pouvoir rentrer après dans le monde du travail. Ça permet d’avoir un petit filet de sécurité. J’ai eu la chance de pouvoir faire Sciences Po, je savais que ça serait une première étape. Ce qui était beau avec cette école-là, c’est que ça ne me spécialisait pas d’entrée de jeu. C’est une école dans laquelle on fait plein de choses très différentes, de l’histoire, de l’économie, de la philo, plein de types d’humanités différentes. On faisait même des mathématiques, des langues. Ça m’a beaucoup nourri, ça m’a permis de toucher à plein de choses. Je me dis, a posteriori, que si j’étais directement allé en école de cinéma, je ne sais pas ce que j’aurais raconté. J’aurais été un très jeune artiste qui n’aurait eu aucune connaissance du monde et même de la vie en règle générale. Sans dire que maintenant, je suis un vieux sage ! Ensuite, la passerelle s’est faite assez naturellement vers un master à Nanterre, en un an, spécialisé en scénario. C’est un bon complément de formation. Ça m’a appris à formuler une pensée de manière relativement intelligible. Pour pouvoir faire un film, il faut réussir à embarquer un tas de gens avec nous dans notre vision qui n’est pas du tout tangible au départ. On est sur une idée, un scénario. L’écriture et la pensée plus académiques aident aussi à rendre plus tangibles les projets qu’on essaie de porter. Sur un aspect plus créatif, ça m’a appris une curiosité que je n’avais peut-être pas forcément développée avant. Quand j’étais plus jeune, mon inspiration venait de ma vie, des films, de la littérature. J’étais vraiment dans un circuit fermé entre mon expérience de vie personnelle et des œuvres artistiques. Maintenant, je me nourris peut-être tout autant de choses qui sont, finalement, de la philosophie, de l’histoire. J’ai travaillé pendant quelque temps au développement d’un long-métrage historique. Et là, cet aspect de recherche documentaire m’a beaucoup aidé.
En ce moment, tu arrives à vivre uniquement de la création ou est-ce que tu as un autre travail en dehors ?
RM : J’ai eu pendant deux ans un travail en dehors, dans la distribution. C’était un super moyen de passer vraiment à l’autre bout de la chaîne de création et d’entrer dans des logiques de marché : qu’est-ce qui intéresse les gens, qu’est-ce qu’ils ont envie de voir, … ? Après, j’ai fait le petit saut dans le vide en essayant de commencer à vivre uniquement de l’écriture. En ce moment, c’est le cas. Je n’ai pas d’autres activités en parallèle. Je coécris plusieurs films que je ne vais pas réaliser. J’ai aussi travaillé l’année dernière, sur de l’’écriture, pour des interviews à la télé, France 2 notamment, avec HugoDécrypte. Après, j’ai aussi été lecteur de scénario. J’ai la chance d’avoir des projets qui sont dans des étapes de développement où j’ai des échéances, où je gagne un petit peu d’argent. Mais peut-être que dans trois mois, je reprendrai d’autres missions à côté, des fiches. Ce n’est pas un long fleuve tranquille.
J’ai vu que tu avais travaillé aussi sur des clips. Qu’est-ce que tu faisais exactement et qu’est-ce que ça t’a apporté ?
RM : Mon premier pas dans le milieu du cinéma, c’était en fait via Sciences Po, durant ma troisième année. J’ai eu la chance de la faire dans une université d’art aux États-Unis qui s’appelle Sarah Lawrence College, il s’agit d’une petite école d’art privée. J’ai commencé mon apprentissage du scénario et un petit peu de mise en scène, même si c’était vraiment des introductions. J’ai commencé avec cette formation plus américaine de l’écriture du scénario. Quand j’étais là-bas, j’ai donné des coups de main sur des projets à droite à gauche. J’ai travaillée sur du clip après en France, mais en tant qu’assistant à la mise en scène pour des artistes comme Oxmo Puccino, Matthieu Chedid. J’ai beaucoup aimé ça. C’était pendant que j’étais encore à Sciences Po, j’avais envie de commencer à mettre un pied sur des plateaux. J’en ai enchaîné pas mal sur de la publicité et sur des clips. Je découvrais tout, je partais de zéro. Ce qui était intéressant, c’est cette répartition des tâches. C’est vraiment un art collectif. D’une autre manière, le travail du clip m’a permis d’avoir une connaissance des enjeux de timing. Quand tu fais ton premier court, tu peux complètement te laisser embarquer, oublier qu’il y a des horaires. C’était un premier petit pas avant de passer derrière la caméra.

Tu parlais de « saut dans le vide ». Comment en es-tu arrivé à te pencher sur ta première réalisation ? Quels en ont été les enjeux ?
RM : Je ne m’étais pas forcément trop projeté sur le fait de réaliser. J’étais assuré de devenir scénariste. Quand je suis sorti du master scénario, j’ai commencé à bosser en tant que scénariste sur des projets. J’avais écrit une première version d’ En beauté pendant mon master. C’était un court qui, justement, était dans une économie assez réduite avec seulement deux comédiens en un seul lieu. Je me suis dit que si un jour je voulais faire quelque chose d’autoproduit sans moyens avec des copains, je n’allais pas me lancer tout de suite dans West Side Story. J’avais cette envie-là de pouvoir me concentrer sur la direction d’acteurs, sur la mise en scène, et d’avoir peut-être moins de problématiques de production à gérer. Les enjeux étaient multiples. Déjà, celui de travailler avec des comédiens qui avaient beaucoup plus d’expérience que moi, qui étaient plus âgés. J’ai eu énormément de chance que Jackie Berroyer et Saadia Bentaïeb veuillent me suivre sur ce projet, alors que je n’avais rien fait. Il y avait tout de même un syndrome de l’imposteur, il fallait réussir à trouver ma légitimité. Un autre enjeu a été lors de l’étape de l’écriture d’essayer de faire une comédie avec un sujet qui était quand même assez lourd et glissant, celui de la fin de vie. C’est une des raisons pour lesquelles on a eu beaucoup de mal à avoir des financements. Le développement du film était assez difficile parce que je bougeais des curseurs en craignant à chaque fois de perdre l’humour du film ou de verser dans quelque chose de trop macabre. Le concept est justement d’avoir des personnages qui sont en train de vivre quelque chose de décisif, qui les dépasse : la mort. Mais, ils s’appesantissent sur des détails qui paraissent démesurément petits et insignifiants à côté de ce qu’ils s’apprêtent à vivre. C’était ce décalage-là qui m’intéressait. J’ai rencontré tous les enjeux inhérents au fait de tourner un premier film : des petites galères de tournage, le manque de moyens par moment. Rien de nouveau sous le soleil. En ce qui concerne la genèse, il y a eu un instinct à un instant de l’écriture. A ce moment-là, je ne m’étais pas dit que ce serait mon premier court-métrage. J’ai commencé à écrire ce projet dans un atelier d’écriture au Master de Nanterre, dirigé par Jacques Martineau. Il donnait un cours, dans lequel chaque semaine, il nous proposait une phrase, une citation, une contrainte d’écriture. On avait une heure pour écrire de manière très libre, pour faire sauter tous les verrous de l’écriture, de la page blanche. C’était le premier cours de toute l’année, lors d’un atelier, il nous donne une citation, je crois tirée de En attendant Godot de Beckett qui était en substance : « Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait ? On attend. Et s’il ne vient pas ? ». Je me suis dit qu’il serait amusant d’avoir cette scène avec ce couple de personnes âgées. Le film commençait par cet échange-là : « Et si elle ne vient pas ? ». On comprenait progressivement qu’ils parlaient de la mort et le fait d’être allongés à attendre en s’ennuyant ferme après avoir ingéré des médicaments, provoquait un décalage. Cette attente lente et ridicule s’oppose au romanesque qu’ils s’imaginaient à travers le geste du suicide. J’ai commencé à écrire ce film-là de manière assez intuitive. Chaque semaine, on devait revenir et continuer à écrire les scènes suivantes. J’ai tout réécrit, mais cette première version a posé la base, trois ou quatre ans avant que je fasse le film. Je me suis beaucoup inspiré de mes grands-parents, dans les personnalités des personnages. J’avais enregistré leurs mémoires indépendamment, quelques années plus tôt, en leur demandant de me parler de leur relation amoureuse : la rencontre, les premiers rendez-vous, les premières années de vie commune, les enfants, etc. Je n’avais jamais eu leur regard là-dessus. Les amours des personnes d’un certain âge me touchent beaucoup, elles sont peut-être plus invisibilisées. Mes grands-parents fêtent leurs soixante ans de mariage dans quelques jours. Même s’ils ont passé toute leur vie ensemble, qu’ils se connaissent sur le bout des doigts, il y avait beaucoup de moments où ils me disaient : « Je te dis ça, mais tu ne le répètes pas, tu ne lui dis pas ». De là est venue cette envie de jouer ce sujet sous la forme d’une comédie, de m’amuser avec une sorte de marivaudage. J’avais lu peu de temps avant un livre d’André Gorz qui s’appelle Lettre à D., une lettre qu’il écrit à sa femme à la fin de leur vie et dans laquelle il revient sur leur amour. C’est très court et absolument magnifique. André Gorz a passé toute sa vie avec cette femme. Mais c’est un petit peu un mea culpa de tout ce qu’il a pris pour acquis dans cette relation, et des choses qu’il n’a pas bien faites. Cette lettre-là, il l’écrit juste avant qu’ils se donnent la mort tous les deux, parce qu’elle est malade à ce moment-là. C’est vraiment le dernier testament de leur amour.
En beauté, d’une certaine façon, relance le débat sur la fin de vie et sur le choix d’une mort digne, belle, qui appartient au futur défunt. Et il faut croire que la mort doit rester dans l’indicible et dans l’obscène en France, on a du retard par rapport à la Suisse, par exemple. Tu te positionnes comment là-dessus ? C’est quelque chose qui t’a parlé pendant que tu préparais ton film ?
RM : L’envie du film, c’était justement de faire un petit pas de côté par rapport à ce traitement du sujet qui est assez lourd. Mes grands-parents ont toujours eu une grande fierté à ne pas être un poids pour quiconque. Je trouve ça beau que ces personnages-là cherchent à mettre un terme à leur existence par leurs propres moyens sans que ce ne soit questionné sur un plan moral. Le film apporte une réponse, une sensibilité personnelle par rapport à cette question, il parle pour lui-même. J’ai préféré me concentrer sur eux et leur envie, plutôt que sur des attentes sociétales. Effectivement c’est une question sur laquelle il y a une grande pudeur, en tout cas en France.
Ton film est traversé par des interrogations contemporaines, notamment celles qui concernent notre rapport dépendant aux images, aux représentations et les assignations patriarcales. Dans En beauté, c’est comme s’il suffisait d’un détail, un mot de trop, une parole échappée pour que la révolution advienne. Est-ce ce qui à motivé la forme de ton court ?
RM : Le film s’appelle En beauté, j’ai été très travaillé par cette question de l’image, celle qu’on laisse, celle que les autres ont de nous et celle qu’on a de soi-même. J’aimais cette idée de suivre des personnages qui se rendent compte qu’ils se sont attachés à beaucoup de choses qui ne sont finalement pas aussi importantes. Cette absurdité-là jaillit de manière complètement folle lorsqu’il n’y a plus rien à perdre, que l’on décide que la vie est terminée. Parce qu’il n’y a plus de lendemain, tous ces petits jeux-là, toute la petite musique du couple qui se répète, ainsi que les assignations à des rôles deviennent absurdes.

D’où t’est venue cette idée de faire un film autour de la fin de vie ? Comment le tempo comique s’est-il imposé et comment as-tu réussi à l’accorder à une certaine mélancolie ? C’est un film de scénariste, non ?
RM : Ça se voit en partie que c’est un film de scénariste. Un film en trois actes qui, dans le petit vocabulaire des scénaristes, a beaucoup de fusils de Tchekhov qu’on pose au début et qui vont payer à la fin. L’envie en tout cas d’utiliser un tempo comique pour traiter ce sujet s’est imposée immédiatement afin que ces personnages-là abordent cette situation de manière assez légère. C’est un film qui est quand même très contenu. C’est souvent de là que vient, je pense, le rire du film. Le début du film ressemble globalement à une fin de film : les deux personnages s’allongent dans leur lit, il y a un fondu au noir. Et là, le film reprend. Comment est-ce que leur petite mise en scène du début s’effondre-t-elle ? C’est le décalage entre la situation assez solennelle de départ et une situation qui s’emballe et qui commence de plus en plus à s’éloigner du petit plan qu’ils avaient initialement. Plus ça avance, plus il y a des choses qui viennent s’ajouter et plus ça crée de la drôlerie.
Tu as parlé tout à l’heure de tes acteurs qui sont absolument formidables. Comment s’est passée la rencontre avec eux ? Où est-ce que tu les as vus et qu’est-ce qui t’a donné envie de travailler avec eux ? De quoi procède cette espèce d’alchimie à étincelles qui donne à ce tandem quelque chose de fusionnel et de conflictuel à la fois ?
RM : Jackie Berroyer a eu beaucoup de rôles, souvent secondaires, dans des films que j’aime beaucoup, comme chez Fabrice Du Welz notamment. Je l’ai aperçu souvent dans des films qui n’appartiennent pas au genre de la comédie. Pour ce rôle, il y avait une forme d’évidence dans sa persona, dans ce qu’il dégage. J’ai été très heureux de pouvoir le rencontrer et que le scénario l’intéresse. Saadia Bentaïeb vient plutôt du théâtre. J’avais eu la chance de la voir dans La réunification des deux Corées, une pièce de Joël Pommerat et au cinéma dans des seconds rôles pour Anatomie d’une chute, Le règne animal et Le monde après nous. Je les ai vus dans une période courte. À chaque fois que je la voyais, je la trouvais vraiment super. Ils ont deux écoles de jeu complètement différentes. Jackie est un instinctif, qui a un clown en lui. Il improvise très bien, il écrit lui-même, il a proposé pas mal de choses pendant les répétitions. Il me disait : « Tiens, pourquoi est-ce qu’il ne dit pas ça ? », « Mais ça, il ne le dirait pas », « Moi, je ne dirais jamais ça ». Il s’approprie vraiment le texte. Saadia, c’est quelqu’un qui vient d’une école plus technique et avec qui on faisait un travail plus référencé où on discutait vraiment des intentions. C’était un super exercice d’essayer de faire cohabiter ces deux univers-là. C’est un couple qui à la fois devait être crédible à l’écran et dans lequel il y avait plein d’étincelles. On comprend au fur et à mesure que leurs vraies natures étaient assez différentes.

En beauté a tourné dans plusieurs festivals où il a récolté une pluie de prix. Tu as pour le moment essentiellement travaillé sur le format court. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce format-là ? As-tu envie de continuer à explorer des choses avec ?
RM : J’adore le court-métrage. J’en regarde beaucoup. Je trouve qu’il y a plein de libertés qu’on peut prendre. Ce que j’aime dans le court-métrage, c’est justement cette grande pluralité. J’aime la nouvelle. En quelques pages, on entre dans un univers, on rencontre des personnages, et on les laisse. Je trouve ça vraiment magnifique. Ce n’est pas forcément la durée qui fait la force de l’œuvre. Un court doit être un concentré de choses qui viennent nourrir le projet. C’est un challenge qui est assez joyeux à essayer de relever. Si j’en ai l’opportunité, j’aimerais en refaire. L’économie du court est toujours particulière. Pour beaucoup de personnes, le court-métrage est un tremplin, un passage vers le long. Je trouve ça beau lorsqu’il y a des cinéastes de longs-métrages qui reviennent au court sur un projet. J’aime les courts qui ne sont pas le court du long. J’aime qu’on choisisse un format en fonction de l’histoire à raconter. Je ne crois pas que j’aurais un long-métrage En beauté à faire. J’espère que les prochains courts que j’écrirai seront aussi de vrais courts-métrages au sens où ces histoires se racontent bien dans ce format. Le passage du court au long de Xavier Legrand avec son diptyque Avant que de tout perdre et Jusqu’à la garde est remarquable. Ce que je trouve passionnant dans sa démarche, c’est qu’il reprend dans son long-métrage les mêmes personnages et les mêmes comédiens. Jusqu’à la garde est un prolongement de l’histoire du court. Ce qui est assez fort, c’est que ce sont deux temporalités complètement différentes. Celle de Avant que de tout perdre, raconte ce qu’il se passe dans ce couple avant la séparation. Tandis que Jusqu’à la garde se penche sur des épisodes qui se passent bien après la séparation. C’est un projet qui adapte en long l’univers d’un court, mais les deux œuvres se répondent et se regardent indépendamment, elles se complètent. C’était assez malin comme manière d’appréhender ce format et de lui donner une vraie place.
En beauté, c’est un peu le pendant heureux d’Amour de Michael Haneke. Est-ce que c’est un film que tu as vu, qui a compté pour toi ? Y a-t-il eu des influences secrètes sur ton film, dans le cinéma ou en littérature ?
RM : J’ai évidemment vu Amour. On pourrait dire grossièrement que c’est Amour avec des blagues. Mais ce n’est pas le cas. Je pense qu’il a une ampleur totalement autre. Les petites références que je pouvais avoir portaient sur des films qui traitaient de sujets graves avec un décalage comique ou en tout cas léger, comme Ménage, un court-métrage de Pierre Salvadori, un de ses premiers films. Il y a un humour plus noir, le mien est plus tendre. J’adore ce film, c’est l’histoire d’une accro à la propreté qui reçoit la visite d’une amie qui est en grande détresse psychologique. Je trouve que le film est vraiment génial parce qu’il est très bien écrit et dosé, rythmé. Ça a été une vraie référence. Il y a un autre court-métrage que j’aime beaucoup, c’est Six Shooter de Martin McDonagh. C’est un court très noir, avec un humour un peu britannique. Il y a une scène très spécifique de A Serious Man, des frères Coen dans laquelle une femme annonce qu’elle veut divorcer à son mari qui ne réagit pas ou complètement à côté. J’aimais jouer avec ces codes du vaudeville. L’impression que le film prend ce chemin pour finalement s’en détourner.

« Ménage »
Avec qui maintenant as-tu envie de travailler ?
RM : Les personnes qui m’inspirent beaucoup n’ont pas besoin de moi pour collaborer. Par ailleurs, ce que j’adore, ce sont les rencontres avec des réalisateur.ices dont je connais le travail ou non. C’est tellement beau de rentrer dans l’univers de personnes que tu ne connais pas du tout et d’essayer d’accompagner, de faire naître des choses. Si j’avais le choix, je ne suis même pas sûr que je travaillerais avec des gens dont je connais déjà l’univers sur le bout des doigts. Je vis les rencontres artistiques et à chaque fois, ce sont de belles surprises.
Quels sont tes prochains projets ? Projettes-tu par exemple de faire un autre court-métrage ?
RM : En ce qui concerne l’écriture, je coécris une comédie policière, plutôt grand public. Je collabore à l’écriture d’un drame, un premier film d’une réalisatrice qui s’appelle Giulia Grandinetti, que j’aime beaucoup. Je coécris plusieurs cours pour des amis réalisateurs dans des genres assez différents. Et je travaille aussi sur deux projets qui me motivent et qui sont encore embryonnaires : mon prochain court que je suis en train d’écrire et un projet de série que je coécris avec une amie, très inspiré de sa vie personnelle. Le point commun entre ce second court et cette série, c’est l’envie d’aller toucher à des thématiques qui me semblent intéressantes, profondes, mais avec une forme de décalage, une légèreté. C’est un style que j’aime bien manier, et l’expérience de ce premier court m’a donné envie de poursuivre dans cet esprit-là.
Propos recueillis par Lou Leoty