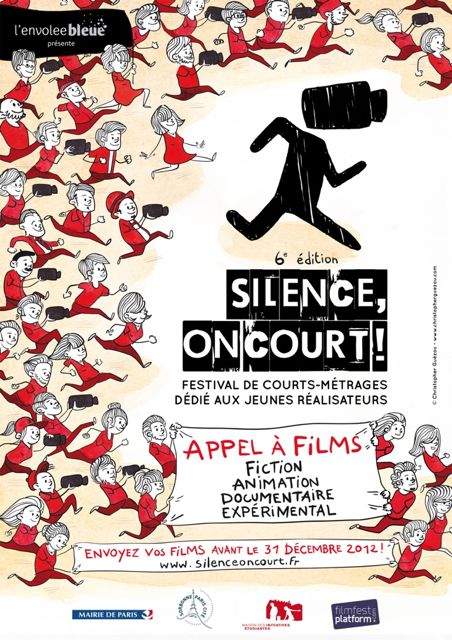« Mamembre », Métrange du Format Court 2012 au Festival Court Métrange de Rennes, est le fruit de l’imagination de sept réalisateurs issus de Sup’infograph 3D, la branche animée de l’ESRA (Ecole de Cinéma, de son, de film d’animation). À l’occasion de la projection du film au Studio des Ursulines en novembre , nous avons rencontrés cinq des co-auteurs : Christophe Feuillard, Caroline Diot, Guillaume Griffoni, Julien Ti-I-Taming et Quentin Cavadaski, Sylvain Payen et Clarisse Martin manquant à l’appel. Entretien groupé donc.

Avant d’intégrer Sup’infograph 3D, leurs parcours étaient très différents et leurs ambitions aussi. Le premier avait une sœur dans l’école, la deuxième voulait se prouver qu’elle était capable d’intégrer une formation pareille, le troisième pensait faire du cinéma, le quatrième voulait travailler dans le jeu vidéo, le dernier pensait plutôt à la photo. Pourtant, à un moment de leur cursus, Christophe, Caroline, Guillaume, Quentin et Julien se sont rencontrés et se sont découverts des affinités et des goûts communs. Tous le reconnaissent : à l’école, ils ont été aiguillés et pas dirigés. Ils ont pu faire preuve de liberté, raconter ce qu’ils voulaient et recourir aux techniques d’animation de leur choix. Ce qui n’est pas le cas partout. Pour Christophe Feuillard, « il y a des écoles qui n’auraient pas forcément accepté les thèmes qu’on a abordé dans « Mamembre » ou dans nos films précédents. Les Gobelins, par exemple, produisent les films des étudiants, et peuvent refuser de poursuivre un film si celui-ci ne leur plaît pas ». Parallèlement à l’avantage de la liberté, il y a celui du lien. Quentin l’admet : « On est beaucoup moins nombreux que les étudiants en cinéma de l’ESRA. On est une trentaine et ils sont 240 par an. On a une relation différente aux professeurs, un lien différent avec eux. On peut parler avec eux, ils nous connaissent et ils connaissent nos projets, nos intentions, nos histoires. C’est quelque chose de précieux quand on sait que dans la même école, d’autres n’ont pas ce même lien avec les professeurs. »
À l’école, des amitiés se développent et des sensibilités communes se rejoignent. Comme des films se font dès la première année, des groupes se créent par le travail. À plusieurs, ils réalisent, comme en deuxième année, « Bleu-fraise », un film auquel collaborent Clarisse, Guillaume, Christophe et Quentin. Le sujet choisi se rapproche de l’amour destructeur, annonciateur du sujet du film de fin d’études, « Mamembre ». Celui-ci traite de la relation entre une mère et sa fille, deux mannequins désarticulés évoluant tant bien que mal dans une société déshumanisée (lire à ce sujet l’excellente critique de Xavier Gourdet). L’idée du film vient d’un rêve, celui de Guillaume. Laissons-lui la parole : « On cherchait un scénario. Mon rêve parlait d’une mère qui accouchait en continu. On greffait à ses enfants des vis et des tuyaux en acier pour qu’ils ne bougent plus et la seule chose qu’il leur restait était l’instruction. Seulement, ça ne marchait pas. Les enfants devenaient fous et on les jetait dans une fosse pleine de milliers d’enfants. À la fin, la mère s’approchait d’eux, tombait d’une falaise… . Et je me suis réveillé ! Pendant un mois, on a discuté de ce rêve mais l’idée ne convenait pas à tout le monde. On s’est donc regroupé autour d’une table et on a rassemblé les idées de chacun avant d’envisager l’étape du scénario ».
Parallèlement aux idées, des envies ont rapidement entouré le projet, leur dernier avant la sortie de l’école. Christophe l’atteste : « On souhaitait faire un film plutôt original, avec un sujet sensible qu’on n’ose pas vraiment révéler au public. Lorsque les formations se terminent en écoles d’animation, les professeurs poussent généralement les étudiants à faire des films lisses, à la Pixar, parce que l’objectif est de trouver du travail à la sortie. Le film de troisième année représente en soi une carte de visite pour être embauché par une grosse boîte. Nous, le lisse ne nous intéressait pas trop, le style Pixar nous agace. On voulait faire quelque chose qui sorte du lot ». Caroline renchérit : « Ce qui m’intéresse en général, ce n’est pas quoi raconter mais comment le raconter, c’est trouver une forme qui ne soit pas celle de Canal ou Pixar, mais quelque chose d’un peu plus risqué. Pour « Mamembre », on voulait transmettre des impressions personnelles et pas des clichés, des choses déjà faites ». Christophe rebondit : « Souvent, les sujets des films d’écoles d’animations sont très volages : on est soit dans une course poursuite soit dans l’espace ! Parce qu’on touche à la 3D, on est conditionné pour parler du futur. Nous, on voulait surtout aborder d’un sujet humain. Ceux qui traitent de vrais sujets ont généralement un vécu, un bagage. Nous voulions aborder la relation entre une mère et sa fille, les conflits potentiels entre elles et le sentiment amoureux. Nous avions envie de projeter les sensibilités des filles du groupe et travailler avec leur vécu. On les a donc beaucoup cuisiné pour le film. Avec nos petits moyens et nos deux demoiselles, on a pu ainsi arriver à parler d’autre chose. »

Pour illustrer cette autre chose, entre sombre, étrange et dérangeant, il a bien fallu des emprunts, des inspirations. Guillaume confirme : « Une exposition sur les surréalistes au Centre Pompidou nous a marqués, notamment à travers une photographie floue de Man Ray, représentant la Marquise Casati avec deux grands yeux surexposés et le travail de Hans Bellmer qui a photographié une poupée désarticulée qui a nourri une réflexion sur la sexualité. D’autres personnes nous ont influencé : Rembrandt, Caravage, Fragonard sur certains aspects et David O’Reilly, un réalisateur anglais assez jeune, qui cartonne. Même si visuellement, on est très éloigné de lui, il travaille dans une perspective d’innovation qui nous inspire. Sa phrase fétiche, c’est innovez ou allez vous faire foutre ! ». Julien rajoute : « Ce qui nous a intéressé aussi, pour illustrer cette société déshumanisée, c’était de façonner une image très fragmentée : on filmait des membres et pas les visages, un peu comme ce qui se fait dans la pornographie. Dans le magasin, il n’y avait que des corps et les mannequins étaient froids, anonymes. »
Sur ce projet de troisième année, ils étaient d’abord neuf, puis sept à se greffer au film. Pourquoi avoir réuni autant de monde ? Comment s’est passé leur collaboration et comment se sont-ils répartis le travail ? Julien est le premier à répondre : « Chaque plan demandait beaucoup de temps, soit plusieurs semaines de travail. On ne pouvait pas se disperser, improviser sur le tournage. (…) En un an, il aurait été impossible de faire le film tout seul. Pourtant, on y a travaillé pendant tout ce temps tous les jours, à sept, mais malgré ce travail régulier, ça a été juste pour terminer les six minutes du film. L’année n’était pas de trop. On nous aurait enlevé ne serait-ce que deux semaines, il nous aurait manqué des plans. » Guillaume poursuit, hilare : « Pendant le tournage, il n’y avait plus de cours, de TP, de vie (rires) ! Les deux dernières semaines avant la deadline, on les a passés ensemble, dans 15 m², à sept, avec nos ordinateurs, Il y en avait toujours un qui allait faire les courses, on mangeait des pâtes toujours trop cuites dans des assiettes en carton (rires) et on se relayait pour dormir ! ».
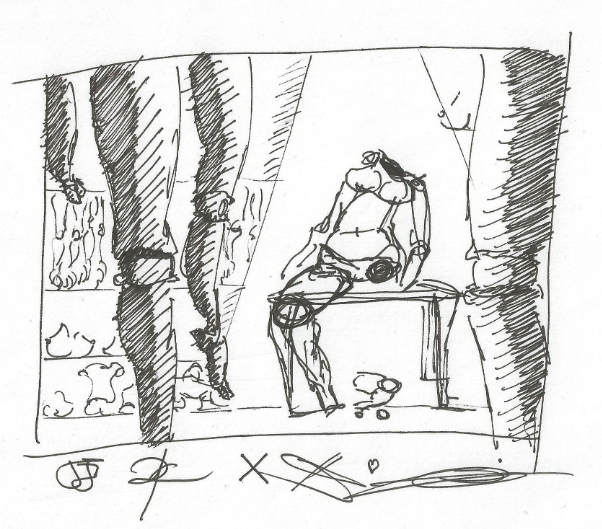
Plutôt que de parler de séparation de tâches, Caroline évoque, elle des compétences individuelles propres. « On n’avait pas vraiment de bouts de film à faire, Guillaume était à la direction artistique, mais on ne fonctionnait pas comme une pyramide. On était un groupe très soudé. Au début, on est parti sur des postes très segmentés, et petit à petit, plus le film a avancé, plus on a commencé à aller dans d’autres directions et à toucher à tout. On avait un film à terminer, on faisait ce qu’on pouvait et on s’entraidait. Il ne fallait pas faire des choses qui ne nous plaisaient pas. »

Quand on leur demande si « Mamembre » est un film pour la fête des mères, les cinq rigolent en assurant que même si dans leur histoire, le personnage féminin mange finalement sa mère, ils n’ont pas de soucis particuliers avec leurs propres mères. Caroline ajoute : « Il fallait que l’histoire soit cohérente, que les gens y croient. La seule solution que la jeune femme avait était celle de se libérer du joug maternel ».
Maintenant qu’ils sont sortis de l’école, comment voient-ils leur film ? Est-ce qu’il a pu leur servir, faire office de carte de visite ? Guillaume répond : « Lorsqu’on a montré le film au jury professionnel composé de personnes de grosses boîtes, on a été critiqué sur les aspects techniques, sur l’ambiance. Au final, ils ont détesté le film et son propos. Ca nous a fait peur. Depuis, j’ai été amené à travailler comme graphiste à la télévision. À TF1, on ne m’a plus adressé la parole pendant une semaine, après que je leur ai montré le film ! Par contre, on s’est rendu compte que le film touchait plus la gent féminine que la masculine. Maintenant, on n’a plus besoin de draguer : on passe le film ! »
Propos recueillis par Katia Bayer
Article associé : la critique du film