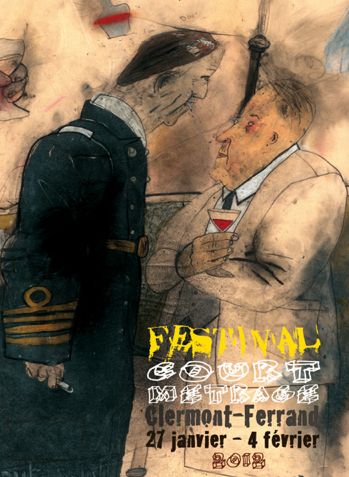Le monde de la Francophonie a de nouveau bénéficié d’une digne représentation cette année à l’occasion de la 26ème édition du FIFF à Namur, avec des films issus des pays aussi divers que le Vietnam, le Liban et le Québec. Le genre court a pu y obtenir une bonne visibilité ; pas moins de 90 courts métrages et clips se trouvaient au programme. Aperçu de quelques titres de la compétition internationale.
Globalement, du côté de l’Europe occidentale, on remarquait des titres d’une qualité souvent irréprochable, mais dans le fond légers, abordant des thèmes relationnels et interpersonnels au sein d’un contexte invariablement bourgeois. Le phénomène n’est pas nouveau et on remarque depuis un moment une sorte de marasme en ce qui concerne surtout les fictions françaises et belges francophones. Trop souvent, le simple fait d’évoquer des problèmes existentiels suffit pour que le film ait réussi son « pari ». On se demande s’il s’agit de la véritable réflexion d’un malaise sociétal ou plutôt d’une complaisance à tous les niveaux de la production cinématographique.

« Des nœuds dans la tête » de Stéphane Demoustier (France), par exemple, traite de la relation entre un garçon et sa petite amie pianiste, suite à l’arrivée du frère de cette dernière, qui entretient des rapports fusionnels et exclusifs avec sa sœur. Ce n’est pas la première fois que la thématique de l’inceste entre frère et sœur se retrouve dans le court métrage (on pense notamment à une récente tentative « estivale ») et on peut se demander si Stéphane Demoustier parvient à donner à ce sujet une forme plus adéquate que ses prédécesseurs. En tout cas, deux éléments du scénario semblent affaiblir le récit. Premièrement, la musique acousmatique est utilisée comme astuce narrative complètement accessoire ; le fait d’attribuer des rôles de musiciens à ses acteurs n’influant en rien les enjeux narratifs. Deuxièmement, le parti pris d’une fin ouverte se révèle une source de frustration lorsque le réalisateur n’approfondit pas la tension qu’il a réussi à établir entre les personnages. A sa décharge, cette tendance à aborder un sujet puis à le laisser suspendu est très répandue dans le genre court aujourd’hui, où on ne s’attend quasiment plus à ce qu’il y ait de fin narrative dans les films.

Avec « La vie facile », production suisse signée Julien Rouyet, on assiste à un récit sur les relations familiales fragiles. Le film accompagne les colères effrayantes d’une jeune fille très aisée en réponse à l’arrivée de la nouvelle maîtresse de son père, à peine plus âgée qu’elle-même. Prémisse potentiellement banale, d’autant plus que le film ne se positionne pas suffisamment pour la rendre plus originale. On pourrait regretter un manque de fin narrative dans ce film aussi, ainsi que quelques éléments scénaristiques faibles (allusion insignifiante à une mère mystique partie en Inde, invraisemblable indifférence du père face aux vandalismes exagérés de sa fille…). Cependant, ce film réussit à séduire grâce au jeu d’acteurs dosé et persuasif, mais aussi en raison du parti pris d’une esthétique stylisée et audacieuse de la part du réalisateur.

Deux films roumains offrent un souffle et confirment la richesse cinématographique du pays ex-soviétique francophone. « Fotografia » de Victor Dragomir est un modeste slice of life dépeignant le lien père-fils. En route vers une réunion de travail avec un collègue, un homme rend visite à son père vivant à la campagne afin de faire une photo de lui. Celui-ci, bien ancré dans un passé pré-révolution et inconscient des avancées de la technologie moderne, passe son temps à se mettre sur son trente-et-un pour l’occasion. A travers cet événement anecdotique, personnel, le réalisateur décrit la transmission, d’une génération à l’autre, de la vie, du savoir mais aussi de la dépendance. Sur le plan macrocosmique, le film traduit avec aplomb toute le fossé générationnel qui traverse la Roumanie, dernier arrivé dans l’Union Européen. Comme la plupart des pays du bloc ex-soviétique occidental, suite à un bouleversement subit de la structure sociale (l’emploi, l’économie, les nouvelles richesses et les racines). Sur le plan formel, la caméra à l’épaule qui suit les personnages renforce l’intimité du sujet tout en gardant une certaine distance pour éviter le voyeurisme. Grâce à cette économie de durée et de moyens, Dragomir arrive à un résultat admirable.

« Skin » d’Ivana Mladenovic suit les retrouvailles entre Alex, récemment sorti de prison, sa copine Mihaela et son meilleur ami Cristi. Au sein ce triangle peu typique, les deux personnages masculins sont marqués par un dualisme peut-être un peu facile : Alex est un dur à cuire rustre, alors que Cristi est aimable, attentionné et civil. Le personnage de Mihaela, le plus intelligemment construit, se positionne dès lors comme pivot entre ces deux extrêmes, se lassant progressivement de l’un et doucement attirée par les qualités de l’autre. Sur fond d’éléments du film de gangster (arnaque, vengeance, etc.) que nous ne retiendrons pas, la réalisatrice serbe assemble un beau tissu d’émotions et de frustrations liées au changement, à l’amour et à l’émancipation féminine.

De plus loin du nœud eurocentriste, sont venus des films fort marquants, avec une dimension sociale sensiblement plus responsable. Lauréat du Prix du Jury, « Mokhtar » d’Halima Ouardiri (Maroc-Canada) est une fiction basée sur une histoire vraie. Mokhtar, un jeune berger prend en charge un bébé hibou blessé mais il doit faire face à l’indignation de son père superstitieux qui le séquestre tant qu’il ne se débarrasse pas de la bête maléfique. Tourné dans les déserts du Maroc rural, le film nous plonge d’emblée dans un univers idyllique : on y retrouve d’ailleurs l’ambiance et le lyrisme de « Pera Berbangê », court métrage turc d’Aran İnan Arslan, traitant, lui aussi, des questions de la liberté par le biais d’une symbolique d’oiseaux. A travers l’isolement et la descente de Mokhtar vers la folie, le spectateur est amené à s’interroger sur le relativisme culturel qui fait que même un symbole quasi universel de la sagesse puisse représenter le diable dans une autre société. La question se pose également au sujet de la foi faisant loi contre les sentiments personnels et la raison. Percutant et bouleversant, « Mokhtar » pose un regard sur la rébellion et se présente comme une allégorie très pertinente à l’heure du Printemps arabe.


« Un mardi » de Sabine El Chamaa, candidat libanais, est un film d’une grande beauté et, avec « Mokhtar », le titre le plus remarquable de cette année. Sorte de « Mrs Dalloway » extériorisé, il suit les péripéties d’une veuve au bord de la sénilité dans un Beyrouth bondé et labyrinthique. Celle-ci se rend dans une boutique, déleste un tailleur, assiste aux obsèques d’un parent et fait la connaissance d’un jeune policier. La simplicité et la spontanéité de l’histoire renforcent la dimension touchante du personnage principal, interprété splendidement par Siham Haddad (« Caramel »). En montrant le rapport tendre entre un justicier et un être humain fragile, la réalisatrice fait preuve d’un grand humanisme. Sa maîtrise du langage cinématographique lui permet de montrer subtilement les aspects de la vie antérieure de ses personnages sans pour autant devoir s’attarder sur des descriptions lourdes. Notamment, la scène où le policier découvre l’oud du mari défunt donne lieu à un passage musical, et sert de point culminant du film, un interlude musical non pas superflu mais foncièrement efficace en ce qu’il traduit la charge émotionnelle du sujet qu’il illustre. Face à la prolifération actuelle de films allant du très mauvais au très bon, il est rassurant de voir qu’un court métrage comme « Un mardi » ait pu retenir l’attention du Jury au FIFF qui a choisi de lui décerner sa plus haute récompense, le Bayard d’Or.
Adi Chesson
Consultez les fiche techniques de « Des noeuds dans la tête », « La vie facile », « Fotografia », « Skin », « Mokhtar » et « Un mardi »