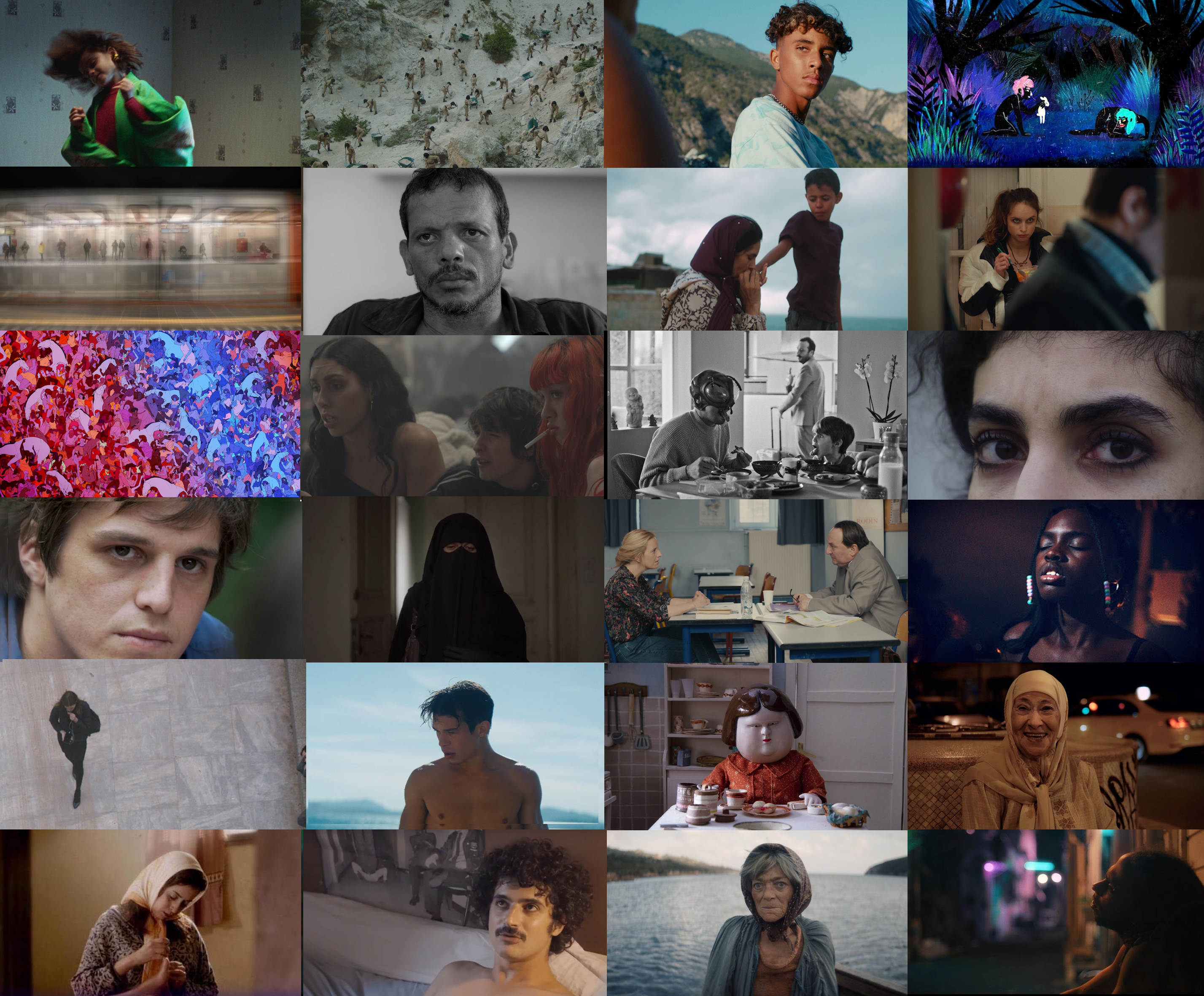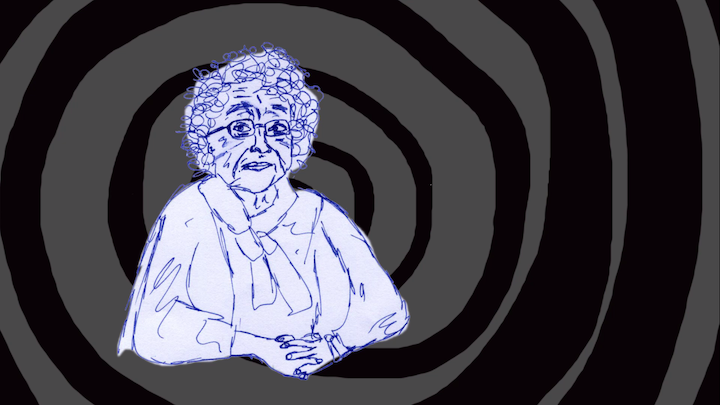Jeune chinoise vivant à New York, la réalisatrice Tang Yi a réalisé le film All the Crows in the World. Celui-ci a comme particularité d’avoir remporté la Palme d’or du court cette année à Cannes. Cet été, nous l’avons longuement interrogée via Zoom sur son parcours, son travail d’écriture, ses défis et ses doutes. Encore étudiante à la NYU Tisch School de New York, elle évoque aussi le low-budget, la comédie sombre, les erreurs à commettre, les revendications qui l’anime et l’influence du réel sur ses films.

Format Court : Vous êtes encore étudiante à NYU et All the Crows in the World est votre deuxième film…
Tang Yi : Oui, je suis encore en train de faire le montage de mon film de mémoire. Je travaille déjà sur le quatrième film. Je développe aussi mon long-métrage, mais j’ai besoin de plus d’expérience de plateau, en tant que réalisatrice. Plus j’en ai, mieux c’est.
Vous avez réalisé des clips. Le cinéma n’était pas votre premier choix. En quel sens travailler en plateau est-il important pour vous ?
T.Y : All the Crows in the World n’est que mon deuxième court-métrage et je ne pensais pas pouvoir aller aussi loin avec. Évidemment, je peux encore voir mes défauts quand je réalise ou quand j’écris. C’est pour ça que je continue à faire des demandes de subvention et que je continue à réaliser des courts-métrages. J’ai besoin de continuer à travailler avec des acteur·ices, avec une équipe, pour pouvoir explorer des choses différentes. Par exemple, mon mémoire ressemble à un drame romantique, et un autre court-métrage davantage à une comédie noire. Je veux essayer différents styles et différentes approches. Les courts-métrages me permettent d’explorer mon langage cinématographique avec peu de budget. J’apprends encore et les courts-métrages sont comme des exercices pour moi. Ils sont l’opportunité de rater. Si je ratais un long-métrage, ça serait plus dur à accepter. Il faut donc que je m’entraîne plus. Pour mon long-métrage, je travaille actuellement sur une version longue de All the Crows in the World. Je pense que c’est un univers qui mérite d’être davantage exploré.
C’est sans doute cette envie d’exploration qui vous a conduite au Népal pour votre premier plateau, Black Goat, où vous avez travaillé dans une langue étrangère, avec des animaux mais aussi des enfants !
T.Y : Oui (rires), beaucoup d’enfants !
Pourquoi s’imposer autant de difficultés pour un premier court-métrage dans une grande école renommée ?
T.Y : Parce que je ne savais rien, j’étais juste courageuse et naïve (rires) ! En fait, j’ai fait trois courts-métrages pendant ma première année à l’école, mais c’était plus des exercices de réalisation. On n’a pas de grosse équipe, de conception sonore ou de mixage… Ça ne se passe pas comme ça. Pendant la première année, on écrit et on tourne beaucoup de choses différentes, avec très peu d’argent, dans des appartements ou dans des parcs. J’ai donc fait les deux. Ce n’est pas comme si Black Goat était ma première expérience de tournage. J’ai dû m’entraîner avant d’en arriver là. Quoiqu’il en soit, la raison pour laquelle j’ai choisi le Népal est que j’y avais déjà été il y a onze ans, avec ma classe, et nous sommes restés dans un monastère pendant une semaine. Des moines plus jeunes s’occupaient de nous. Ils nous réveillaient chaque matin, nous amenaient manger mais ils ne communiquaient pas beaucoup avec nous. Ils étaient très timides. Mais un jour, j’ai vu un moine, de 13, 14, peut-être 15 ans, et il se cachait avec un téléphone. J’ai trouvé ça intéressant. Je l’ai vu prendre des selfies (elle imite le geste) et sélectionner les meilleures photos. Et puis sa sonnerie de téléphone, c’était Baby de Justin Bieber. C’est là où je me suis vraiment sentie connectée avec lui et avec son groupe d’adolescents, moines et nonnes. Je me suis dit que, même si on avait des expériences et des vies très différentes, on avait quelque chose en commun. À partir de là, j’ai commencé à devenir amie avec eux, je les ai ajoutés en amis sur Facebook et on est resté·e·s en contact au fil des années.. Pendant ma deuxième année à NYU, j’avais l’opportunité de tourner à l’étranger, en dehors des États-Unis. Le premier pays qui m’est venu en tête était le Népal, plutôt que la Chine ou Hong Kong. J’y suis donc allée pendant un mois, dans le même monastère, mais beaucoup de choses avaient changé. Parce que j’étais une femme réalisatrice, ils ne pensaient pas que je devrais raconter des histoires à propos de moines. D’un autre côté, il me semblait que tourner un film dans la nonnerie serait plus difficile à cause des normes sociales locales. Les vies des nonnes bouddhistes sont gardées secrètes, elles n’aiment pas être filmées. Ça ne me semblait pas possible. Votre question est intéressante, parce qu’à ce moment-là, je n’avais pas idée que ce serait si difficile. Sur le moment, je ne me posais pas la question, j’essayais juste de faire mon travail.
J’ai été très chanceuse. On m’a présenté Anila Troindroma, qui avait fondé la nonnerie. C’est une chanteuse connue à l’international, mais elle est aussi une nonne bouddhiste. En fait, dans cette nonnerie, les filles n’apprennaient pas que le bouddhisme, elles s’apprêtaient à entrer à l’université et à étudier l’ingénierie ou le droit, tout en étant des nonnes. J’ai trouvé ça incroyable. Anila m’a demandé quel genre de film je voulais tourner avec elles, et je me suis dit que je voulais repousser les limites. Je ne voulais pas faire un autre film sur le Népal, comme on en voit partout. Je lui ai dit que je voulais raconter une histoire sur l’expérience menstruelle des nonnes bouddhistes. La honte des règles a toujours été un problème dans la culture asiatique. Adolescente et bouddhiste, quand j’avais mes règles, j’entendais ma mère me demander de ne pas aller au monastère. Elle trouvait ça irrespectueux parce qu’elle considérait que je n’étais pas propre. Mais au Népal, la situation est parfois encore pire. Dans certains endroits à l’ouest du pays, on mettait les personnes qui ont leurs règles dans des huttes loin de chez elles. Les filles étaient mordues par des serpents, attaquées par des animaux sauvages, voire violées par des étrangers, tout simplement parce qu’elles étaient seules dans une hutte plutôt qu’avec leur famille. Cette honte des règles est toujours un problème au Népal. J’ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes qui voulaient repousser ces limites et les remettre en question avec moi. Quand j’ai proposé cette idée, la fondatrice de la nonnerie m’a dit oui tout de suite, à la seule condition que je devais gagner la confiance des autres filles. Alors je suis restée à la nonnerie et je suis devenue amie avec elles, jusqu’à ce qu’elles me fassent assez confiance pour tourner ensemble. La fondatrice a aussi accepté que je tourne sur place à la condition que toute l’équipe créatrice soit composée de femmes. Sauf qu’au Népal, l’industrie cinématographique est dominée par les hommes, ça ne leur semble pas possible que les femmes occupent certaines fonctions. J’ai dû faire venir des chefs opératrices depuis les États-Unis. C’était le plus souvent mes camarades de classe. J’ai aussi fait venir deux femmes ingénieurs du son de Mumbai, en Inde.
Est-ce que l’école vous a donné de l’argent pour le film ou est-ce que vous avez dû faire du crowd-funding ?
T.Y : Oh non, mon Dieu non ! Pour ce film, on m’a donné vraiment peu d’argent. Le film m’a coûté 23.000 dollars et l’école m’a donné quelque chose comme 2000 dollars. Beaucoup de mes camarades passaient par le crowd-funding, mais pas moi. Comme je travaillais sur un sujet religieux, ça me semblait déplacé. En fait, ma mère m’a donné de l’argent, par soutien. Mais pendant la post-production, il m’en a manqué de l’argent. C’était vraiment compliqué. Et puis je ne parlais pas la langue, j’ai dû travailler avec les locaux et être consciente de mon regard d’étrangère. En tant qu’étrangère, je ne voulais pas juger la culture des autres, en travaillant sur le scénario, je savais qu’il fallait que je raconte une histoire très personnelle. Mon public n’est pas seulement étranger à l’histoire. J’ai senti que tourner un film donnait aux nonnes une certaine estime d’elles-mêmes. J’aime ce pouvoir qu’a le cinéma de contribuer à se construire une estime de soi et une confiance en soi, particulièrement pour des gens qui pensent que leur vie doit rester secrète, loin des regards. C’était vraiment super d’avoir cette opportunité. Mais au-delà, Black Goat m’a permis d’obtenir les financements pour mes autres courts-métrages.

Vous aimez créer vos personnages et vos histoires. Pourquoi choisir de filmer des adolescents, avec lesquels il est plus difficile de travailler ?
T.Y : Je suppose que c’est juste ma curiosité envers le monde. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je fais des films : je suis curieuse à propos de certains sujets, certains groupes de personnes. Par exemple, la honte des règles a toujours fait partie de ma vie. En réalisant Black Goat, je voulais véhiculer l’idée d’une reprise de pouvoir au sujet des règles. Je ne veux plus qu’on en ait honte, et c’est pour ça qu’en faisant ce film, j’ai construit ma propre narration et j’ai repris le pouvoir dessus. Ça me plait. Et puis, pour All the Crows in the World, l’histoire du film m’est en réalité arrivée personnellement, même si ça n’est pas évident pour les autres. J’étais ado à l’époque, j’apprenais l’anglais à l’internat afin de pouvoir aller à l’université. Un soir, j’étais dans une autre ville et mon oncle m’a amenée à un dîner. Mes parents n’étaient pas là et quand je suis arrivée à cette soirée, mon oncle avait deux maîtresses, assises à ses côtés. J’étais perdue. Et puis il m’a demandé de boire avec lui. Je ne savais pas dire non aux adultes à l’époque alors j’ai bu avec lui. Puis, il m’a alors demandé de boire avec toute la table. C’était des hommes d’âge mûr, gros et fortunés. Ils étaient répugnants. Mais à l’époque, j’essayais de ne pas penser au fait qu’ils l’étaient, je crois que je les voyais juste comme les amis de mon père ou de mon oncle. Je faisais tout ce qu’ils me demandaient de faire parce que c’était les amis de mon père. Je leur faisais confiance et je ne me rendais pas compte que ce n’était pas normal. Personne ne me l’avait dit. Et puis après le dîner, mon oncle m’a demandé si je voulais aller au karaoké. J’étais à l’internat et je m’ennuyais grave, alors je lui ai dit oui. Tout était bon pour éviter l’école ! Mais en fait, ce n’était pas un karaoké, c’était un bordel. J’étais en train de choisir des chansons sur une machine de karaoké quand trois rangées de femmes sont entrées. Les amis de mon oncle ont commencé à choisir des femmes pendant que je choisissais des chansons. Certaines des filles avaient clairement mon âge. L’adolescente du film représente la réalité que je vivais à l’époque. Il m’a fallu deux semaines pour parler à mon père de ce qui s’était passé avec mon oncle. Comme beaucoup de pères chinois, il se souciait surtout de savoir si je n’avais pas été agressée sexuellement. Mais ça s’arrêtait là, il n’allait pas chercher à aller tabasser mon oncle. Je ne l’ai plus jamais revu, mais en devenant adulte, j’ai commencé à me sentir mal à cause de ça. Cette nuit-là aurait pu se passer encore plus mal. Je crois que je suis restée traumatisée par cette expérience pendant un bout de temps.
Est-ce que vous avez pensé à l’approche documentaire pour vos deux sujets de films ? L’idée de partir filmer toute seule avec votre caméra, à la rencontre de personnes qui auraient eu la même expérience vous a-t-elle tentée ?
T.Y : Oui, bien sûr ! J’ai fait un documentaire pour m’entraîner mais il est difficile pour moi de contrôler les limites quand je filme le réel. Je risque de devenir trop proche avec la personne, je ne me sens pas capable de garder le contrôle. J’admire les gens qui savent faire des documentaires. J’ai beaucoup tourné de choses proches du format documentaire, mais ce sont surtout des outils pour écrire mes scripts.
À quoi ressemblent vos scénarios ? Comment avez-vous écrit celui de All the Crows in the World ?
T.Y : Au début, le film ressemblait à un drame chinois traditionnel, parce que je suis une grande fan de Dead Uncle, et le scénario y ressemblait pas mal. Ce film était ma référence, et je voulais faire un drame sérieux parce que je n’y étais jamais parvenue jusque-là. Mais plus j’écrivais, plus j’avais l’impression de victimiser ma protagoniste. (…) Ces ébauches de script m’ont contrariée. Je n’étais pas à l’aise avec la tournure que prenait le personnage. Et puis comme j’écrivais à propos de moi-même, je me suis sentie vraiment impuissante. Pour moi, une part importante quand on fait un film, c’est d’acquérir un pouvoir et de revendiquer son récit. Quand j’ai vu les comédies noires du réalisateur japonais Takeshi Kitano, j’ai vraiment aimé son humour décalé et j’ai voulu partir dans cette direction. En me levant le lendemain, j’ai décidé de laisser mes personnages réellement libres. Dans All Crows, les hommes se prendraient par exemple à aboyer dans le bordel, et la protagoniste commencerait à parler de sa vie sexuelle à table. L’équipe du film était un peu contrariée que je change le script, mais après avoir lu la nouvelle ébauche, ils se sont dit : “Oui, celui-là, c’est vraiment toi”. Du coup, j’ai fait les changements. Trouver la tonalité du script a vraiment été le plus gros challenge pendant la réalisation de ce film, mais ce sont ces éléments que j’ai ajoutés au film qui le rendent plus intéressant.

Dans vos films, les thématiques sont abordées avec beaucoup de transparence : les règles dans Black Goat, la sexualité dans All the Crows in the World… Pensez-vous que la sexualité est un sujet qui doit être abordé de manière plus positive ou amusante comme vous le faites ?
T.Y : Je ne m’interroge pas trop sur les films des autres, mais surtout sur les histoires que j’ai envie de raconter. Je crois que je suis une personne très inhibée sexuellement (rires) et j’ai grandi dans un environnement où les gens voyaient le sexe comme quelque chose de honteux. En parlant de sexe et de sexualité dans mes films, j’ai l’impression de revendiquer mon pouvoir. Pour moi, faire des films revient à faire la paix avec moi-même. Les gens qui ont des problèmes deviennent réalisateurs, n’est-ce pas ? C’est ma façon de faire de l’art tout en me réparant moi. Je pose des questions dans mes films et alors je me sens plus en confiance. Je ne pense pas trop à ce que font les autres dans leurs films, et d’ailleurs je ne regarde pas beaucoup de films. Je fais partie de celles et ceux qui regardent le moins de films dans mon école, même si j’ai commencé à en regarder de plus en plus.
Pour quelle raison en regardez-vous moins que les autres ?
T.Y : Je pense que c’est parce que j’étais autrice-compositrice-interprète avant de venir à Tisch. J’avais signé avec le label Universal Hong Kong. Je n’ai pas réussi et je n’ai fait qu’un album. J’avais choisi de faire de la musique parce que j’étais inspirée par les vidéos du Saturday Night Live. À l’époque, j’étais vraiment fascinée par le trio Lonely Island et j’aimais beaucoup la chanson de Justin Timberlake qui s’appelait Dick in a box. C’était vraiment déplacé et le clip vidéo était vraiment stupide. Ça parle d’un mec qui met son « paquet » dans une boîte et l’offre à la femme qu’il aime à chaque célébration. C’est un scénario très idiot, mais c’est drôle. J’ai appris que Dick in a box avait remporté un Emmy Award et j’ai trouvé ça très inspirant. Je me suis dit : “Waouh, être choquant peut t’apporter un prix de l’autre côté du globe, c’est incroyable !”. Du coup, j’ai commencé à écrire des chansons très similaires qui parlaient de ma vie, et j’ai été signée. J’ai réalisé des clips vidéos et j’ai candidaté à Tisch avec mon propre clip vidéo. La chanson s’appelle Why Am I Bad et parle de la fois où j’ai surprise ma collocataire en train de faire l’amour avec son copain dans mon lit. J’ai fait un clip musical très dramatique et j’ai été prise à Tisch.
Vous n’avez pas eu un Emmy mais vous avez eu une école (rires) !
T.Y : Oui, j’ai même eu une école avec une bourse… (rires) ! Et puis, pendant l’entretien, j’ai compris que j’étais très différente des autres jeunes. Les autres venaient faire des films parce qu’ils en avaient envie. À l’époque, mon idée était plutôt de faire des clips musicaux avec de la narration, comme Lonely Island. C’est ce que j’ai dit à mon entretien, et quand on m’a demandé qui était mon réalisateur préféré, j’ai répondu Ben Stiller, parce qu’il n’y a que lui qui peut réussir à faire jouer David Bowie comme juré lors d’un défilé de lingerie masculine dans Zoolander. Il n’y a que lui aussi qui peut faire danser un Tom Cruise chauve dans Tropic Thunder. C’était incroyable, j’ai adoré. Je voulais faire la même chose, et les professeurs ont vu quelque chose de différent chez moi. Bien sûr, en allant à Tisch, j’ai compris ce qu’était vraiment la réalisation et j’ai commencé à regarder des films sérieux. J’ai appris que c’était un monde très profond. Je n’y connaissais rien. Alors j’ai rattrapé certaines lacunes, mais mes amis sont des nerd, ils ont vu presque tous les films du monde. Je ne sais pas comment ils font.

Dans une interview, il est mentionné que vos professeurs ne comprennent pas toujours vos choix parce que vous allez contre leurs recommandations…
T.Y : En réalité, mon école vous apprend vraiment à faire des courts-métrages réussis. Ça vous aide à intégrer les festivals plus rapidement et à lancer votre carrière. Si vous regardez les films réalisés dans mon école, vous trouverez beaucoup d’histoires sur le passage à l’âge adulte qui se concentrent sur un personnage. L’objectif est rapproché et on trouve beaucoup de plans subjectifs. C’est super. Quand j’ai eu l’opportunité de réaliser All the Crows in the World, puisque j’avais échoué à rédiger la version Dead Uncle de mon scénario, j’ai essayé de suivre ce que j’appelle l’ “approche NYU” (rires). Mais ça ne me convenait pas alors j’ai décidé d’essayer toutes les choses qui déplaisaient à mes professeurs : beaucoup de personnages, de scènes de groupe… Je voulais seulement voir si ça fonctionnait. En réalité, pour s’opposer aux règles, il fallait déjà les connaître. La chose la plus encourageante que mon professeur, Todd Solonz, nous ait dit, c’est qu’on allait tous faire des erreurs, et que nous devions tourner et échouer magnifiquement. Je pense que c’est très important d’essayer des choses et de ne pas rester dans sa bulle de confort.
Particulièrement, à NYU, vous recevez des évaluations très dures sur vos courts-métrages. En gros, 15 professeurs sont assis dans une pièce et ils critiquent votre film. Vous recevez des commentaires très sévères. La première fois, j’ai pleuré, parce que je ne réussissais pas à les intégrer, c’était trop pour moi. Au fil de l’année, je crois que j’ai appris à me blinder. Parfois, les professeurs ont raison, mais pas toujours. J’ai appris à identifier ce qui m’aide le plus. C’est ça qui est important, parce qu’on se fait rejeter régulièrement dans l’industrie et il faut s’y préparer. L’école m’a apporté un très bon entraînement à ce sujet.
Quels conseils sont les plus précieux pour vous ?
T.Y : Parfois, on vous conseille d’être plus sérieuse. Ce n’est pas le genre de conseils que je veux parce que je souhaite faire de la comédie noire. Je continuerai toujours à en faire. J’ai envie de conseils qui vont m’aider à être plus sombre, plus drôle et plus extrême. Les conseils utiles sont ceux qui vont dans ce sens, pas ceux qui essaient de vous amener dans une autre direction. Il faut apprendre à se détacher de ceux-là. Ça m’a permis de mieux comprendre ce que je voulais.

Quel regard portez-vous sur votre situation d’étudiante ayant reçu une Palme d’or du court-métrage à Cannes ?
T.Y : Mon film n’est pas un film réalisé dans le cadre de l’école. Une des conditions pour obtenir de l’argent de la part de la fondation Hong Kong Arts Development Council pour laquelle j’ai postulé était de réaliser un film au sein d’un programme académique. Déposer une demande ne coûte rien, alors je l’ai fait. Quand ça a été accepté, je tournais mon film de validation, et c’était un scénario beaucoup plus difficile. J’aimais All the Crows in the World, et je l’ai envoyé à certains de mes professeurs, qui ne l’ont pas apprécié. Ils se disaient : “Mais qu’est-ce que c’est ? Je ne comprends pas ce film”. Je l’ai quand même proposé à Cannes et ailleurs.. Je ne m’attendais pas à ce que Cannes veuille vraiment de mon film. Je me suis sentie très chanceuse d’être prise à Cannes, mais je ne m’attendais vraiment pas à gagner.
Comment ce film va-t-il vous aider à l’avenir ? Au-delà de la confiance en soi et de l’encouragement que le prix représente, comment voyez-vous cette récompense ?
T.Y : Je n’avais pas assez d’argent ou de moyens pour engager une équipe suffisante quand je faisais mes courts. Quand j’entrais en contact avec des personnes plus puissantes pour demander leur aide, ils ne me prenaientt pas toujours au sérieux. Avec All the Crows in the World, qui se base sur ma propre expérience, j’ai pris toutes les décisions moi-même, et je n’avais pas beaucoup de budget. J’ai été entièrement vraie avec moi-même. Gagner une récompense à Cannes est comme une confirmation : si la réalisation de film sera toujours difficile, je m’en sortirai si je reste fidèle à moi-même.
Propos recueillis par Katia Bayer et Anne-Sophie Bertrand. Mise en forme : Eliott Witterkerth
Article associé : la critique du film
Consulter la fiche technique du film