Dans Radiadio, on découvre les joies des retrouvailles d’une famille autour de la traditionnelle fête juive de Pessah. Depuis des générations, les gestes se transmettent, se perdent mais gardent leur sincérité. Ondine Novarese, la réalisatrice de Radiadio, a peur de voir ces gestes traditionnels disparaître mais elle aime sa famille, même si le Pessah sur Zoom est un sacré bazar !
Dans son court-métrage sélectionné dans la catégorie Jeune création au FIPADOC 2023, elle mélange les images d’archive filmées par son arrière-grand-père, des images d’un enregistrement Zoom et un tournage en famille. La jeune réalisatrice, tout juste diplômée du département son de la Fémis, raconte son envie de créer un sentiment de nostalgie dans son film.

Format Court : Quand ce projet est-il né et comment ?
Ondine Novarese : Dans le film, on voit les repas de Pessah faits sur Zoom et Skype. Le premier a eu lieu en 2020 : on était en plein confinement et j’avais pris le son. A ce moment-là, je ne savais pas que j’allais faire un film mais j’avais envie de prendre le son, de filmer ça. Puis, j’ai retrouvé l’archive de 1959, un Pessah en famille aussi. Pour moi, c’était deux matières qu’il fallait faire communiquer. Il y avait quelque chose de tellement évident de l’ordre de la perte, en tout cas du changement. Ça m’a fait peur, c’est une fête qu’on fait pour mon grand-père et il venait d’avoir 90 ans. C’est là que je me suis mise à me poser la question : qu’est-ce que va devenir cette fête traditionnelle et familiale plus tard ? L’idée est vraiment née là.
Tu avais déjà des enregistrements son et image avant d’avoir une idée du film ?
O. N : J’avais déjà l’archive du Pessah de 1959. Pour le reste, je suis allée chez mes grands-parents un mois avant le montage. C’est un peu cliché mais c’est vrai : j’ai trouvé un sac plein de bobines dans la cave. Il y a eu un travail de montage : il a fallu regarder les archives, se demander ce qui communique bien, ce qui peut exprimer ce qu’on veut dire.
C’est donc l’image d’archive qui t’a donné envie de faire ce film ? Plus que la crise du Covid ?
O. N : C’est le son de l’image qui m’en a donné envie. Ce qui résonne le plus en moi, émotionnellement, c’est le discours de mon arrière-grand-père à la fin du film, où il s’adresse à ses enfants parce qu’il espère qu’il y aura d’autres Séder (repas de Pessah), que ses enfants auront des enfants aussi dévoués. Il y a quelque chose qui m’a touchée, c’est un discours que j’entends encore aujourd’hui alors que c’est quelqu’un que je n’ai pas connu. C’est ce qui m’a donné envie d’exprimer ce que ça me faisait ressentir : une sorte de nostalgie mais particulière, une nostalgie à la fois d’un passé que je n’ai pas connu et d’un futur très incertain.

Ton travail de fin d’étude à la fémis traitait déjà de la nostalgie.
O. N : J’ai fait un mémoire sur la nostalgie. À la Fémis, en quatrième année, pour le TFE (travail de fin d’études) , on a le droit de faire un film – ce n’est pas obligatoire – et quelle que soit sa section, il doit s’accompagner d’un travail d’écriture de mémoire, en rapport avec le département dans lequel on est. J’ai eu l’idée du film avant l’idée du mémoire. Cette émotion de la nostalgie est ce qui m’a donné envie de faire ce film. J’avais envie d’en parler sous l’axe du futur comme de quelque chose qu’on n’a pas encore perdu mais qu’on a peur de perdre. Une sorte de nostalgie du futur en somme.
Je suis repartie des théories du temps de Bergson selon lesquelles il y a toujours dans le présent à la fois un passé qui se conserve et un présent qui passe. Je me suis dit que pour donner naissance à un sentiment de nostalgie, il faudrait qu’il n’y ait pas juste ces deux temps-là mais un troisième temps, simultanément. Le passé qui se conserve, le présent qui passe mais aussi le futur présent à l’esprit. On a des images d’archives du passé, et le tournage du temps présent, aujourd’hui comment on célèbre Pessah ; de réussir dans un instant d’avoir simultanément trois temps différents. Ce qui permet de créer une connexion, un pont, et qui crée un sentiment de nostalgie. Après, est-ce que ça marche ? C’est une autre question.
Comment as-tu travaillé la mise en scène et l’approche des images d’archives, notamment concernant les gestes traditionnels qui se répètent ?
O. N : Je voulais réussir à relier les époques où il y a beaucoup de choses qu’on fait très différemment. Il y a des gestes qui restent les mêmes, qui permettent de faire des ponts temporels et de passer aux images d’archives. La façon dont ils disparaissent et se transforment m’intéressent. Ils ne sont plus très bien réalisés, quant à la langue, elle a vraiment disparu. Dans le Pessah de 59, tout se passe en yiddish qui est un vrai vestige aujourd’hui. Ce sont des éléments qui permettent de faire des liens, soit par rupture, soit pas similitude et qui permettent de faire répondre des époques qui n’ont rien à voir.
Pour le tournage, je n’ai pas du tout donné d’instructions à ma famille. L’idée c’était qu’on se fasse oublier. Même si on était une petite équipe de trois, ils n’avaient pas l’habitude. Je perchais donc je n’étais ni complètement avec eux, ni avec l’équipe. Dès qu’il y avait une prière, il fallait que je mange le plat correspondant au bon moment, c’était difficile à gérer !
C’est un peu acrobatique d’être à la fois un personnage de ton film en même temps que quelqu’un qui le fabrique.
O. N : Dans Radiadio, la construction du film fait partie du film. Au début, je me suis interrogée si je devais faire moi-même l’image. Très vite, j’ai voulu filmer mais j’ai abandonné parce que je ne sais pas filmer. Par contre, je sais faire du son, je sais percher. L’envie de faire l’image, elle vient surtout d’une envie de contrôler le cadre, d’être au bon endroit au bon moment. Mais ce n’est pas parce que je fais de la perche que je ne peux pas être au bon endroit au bon moment. J’ai donné mes instructions au chef op en lui disant : « si tu vois des choses qui t’intéressent, n’hésite pas. Par contre, si tu vois que je me déplace à la perche quelque part, tu me suis.” C’est le micro qui fait le cadre.
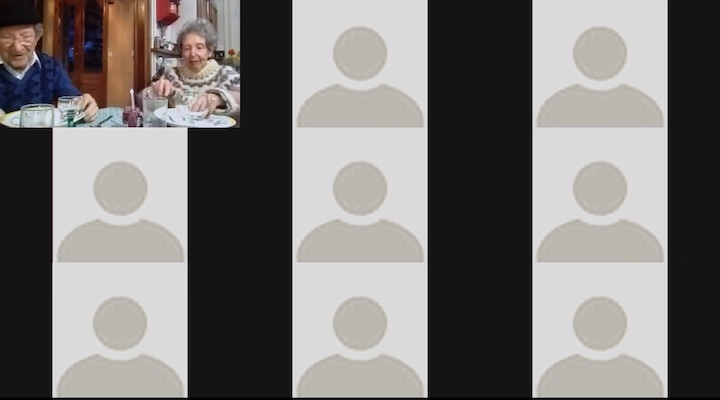
Quand la période de montage s’est-elle située par rapport au tournage ?
O. N : Comme c’est un film très intime, j’avais besoin de temps, de recul. On a eu deux semaines en janvier et deux semaines en mai. En plus, j’ai eu deux monteurs différents ce qui n’était pas prévu. Avec Gabrielle Stemmer, une monteuse très brillante qui a fait son TFE avec seulement des images de Youtube (Clean with me (After dark), 2019), on a vraiment construit le film en termes de structure. On a beaucoup bossé ensemble sur les parties de Zoom. Ça a permis de voir ce qu’on avait déjà et donc de savoir ce qu’on voulait aller chercher au tournage. Toujours dans le but de créer des ponts entre les époques et de voir ce qui reste, ce qui disparaît, ce qui change. On a reconstruit tout ça avec Charly Cancel, un autre monteur. C’est un exercice d’avoir deux monteurs mais c’était super. Avec Gabrielle, on a travaillé sur la structure et avec Charly, on s’est concentré sur la création du personnage de mon grand-père, on a relié les archives à lui. En rentrant dans le détail, on a pu construire quelque chose de plus intime, de plus émotionnel. La structure était là, elle était assez évidente et on ne voulait pas la changer mais l’enrichir.
Comment as-tu travaillé les images sur Zoom et Skype ? Comment construis-tu un récit, comment choisis-tu tes images ? Les personnages de ta famille ne sont introduits que par Zoom et pourtant on a quand même l’impression de les rencontrer.
O. N : Avant d’arriver en montage, j’avais écrit un traitement et j’avais présélectionné les moments que j’aimais, ceux qui me faisaient rire, ceux que je trouvais intense. J’avais une idée de construction du film, je voulais qu’on commence avec quelque chose de léger, de drôle. Parce que c’est comme çà que je vis Pessah. C’est un peu le bazar et j’avais envie de remettre ça dans le film. Je savais à peu près qui je voulais mettre en avant mais ça s’est fait assez naturellement, c’était évidemment mes grands-parents. Mais eux, on a dû aller les chercher un peu plus au tournage. On s’est rendu compte que cela tournait autour de mon grand-père et il fallait, dès le Zoom, attirer l’œil sur lui. Ce n’est pas toujours évident.
Quand quelqu’un parle sur Zoom, on regarde celui qui parle. On savait que quand quelqu’un interviendrait on allait avoir l’attention du spectateur sur cette personne. Il peut y avoir un détail aussi, quelque chose qui nous intéresse, une moue, etc. C’est du documentaire mais forcément il y a de la mise en scène. Ce qui est pratique avec le Zoom, c’est que c’est fait de plein de vignettes, forcément il y a des moments où on a un peu triché. On remplace une vignette, on met un autre moment. C’est un mélange d’écriture préalable, de réflexion avec la monteuse et le monteur et puis, avec le tournage, de possibilité de se refocaliser sur certaines personnes.

Vois-tu ton film comme une nouvelle archive qui se construit, porté par un désir de transmission?
O. N : La transmission, c’est une question tout le temps présente chez moi, encore plus dans les familles juives. Dans ces familles, on a une partie de l’histoire qu’on se lègue, il y a beaucoup de névroses. Mon grand-père a beaucoup filmé, j’avais envie de reprendre son geste à lui et de partager mon point de vue sur ça, sur la peur de la perte de la tradition mais aussi leur transmettre que peut-être, finalement, on est une famille, ensemble, qui s’aime et que ce n’est pas grave si ça change. En faisant le film, j’ai pensé que je réutilisais des films qui ont été filmés il y a 50 ans. Peut-être que dans 50 ans, mon film pourra être vu et utilisé. C’est l’espoir qu’on a quand on filme quelque chose, de se dire que ça deviendra un souvenir aussi et qu’avec un peu de chance, il fera partie du passé.
Comment se déroule la fabrication d’un film de fin d’année à la Fémis ?
O. N : C’est un peu différent selon les départements. Tout le matériel est prêté par la Fémis, toutes les salles de post-prod aussi et les gens ne sont pas payés. C’est encore une année d’école. Sur les TFE, tout le monde est bénévole et cela ne concerne pas seulement des étudiants de la Fémis. Sur mon équipe, j’ai eu de la chance parce que j’ai osé contacter des gens qui ont déjà le statut d’intermittent mais qui ont accepté de travailler bénévolement. Je pense qu’il faut avoir du culot. C’est beaucoup de contacts et puis, il faut réussir à motiver des gens sur un projet qui est bénévole. L’avantage du TFE, c’est que les gens se disent que c’est un film qui va aller en festival – si c’est réussi. C’est beaucoup plus difficile de faire travailler bénévolement après l’école. Le problème aussi, surtout en documentaire, est que lorsqu’on on attend de l’argent, il y a des films qu’on ne fait pas. On ne s’en rend pas trop compte, quand on sort de la Fémis, du temps que ça prend. On nous prévient mais ce n’est pas pareil de le vivre, d’envoyer un dossier et de savoir qu’il faut attendre trois mois avant d’avoir une réponse alors que certains films pourraient se faire en une semaine de tournage et deux mois de post-production. Le problème, c’est qu’il faut trouver les financements et dans la réalité, c’est extrêmement long. Il y a des films qui n’attendent pas. Il faut se dire : “tant pis je n’ai pas de financement”. Avec un peu de chance, ce sera financé après sinon ce sera à perte. Avec Radiadio, c’était facile, il a suffi d’une petite caméra qui a fait le travail puis d’un enregistrement d’écran. J’ai un autre projet de documentaire en Corse, on filme une dame de 95 ans qui est cardiaque comme pas possible et moi, si j’attend le financement du CNC, elle ne sera peut-être plus là. On a décidé de partir tourner et puis, on verra bien…
Propos recueillis par Garance Alegria et Agathe Arnaud
Article associé : la critique du film


