Réalisateur brésilien installé entre Genève et Bruxelles, Felipe Casanova explore les zones floues entre fiction et documentaire. Formé à l’IAD (Institut des Arts de Diffusion), il revendique une pratique libre, intuitive et hybride. Dans cet entretien où il est autant question de création que de responsabilité politique et de spiritualité, il revient sur son parcours cosmopolite et la genèse de son deuxième court, O Rio de Janeiro Continua Lindo, un film poignant inspiré par la lettre d’une mère brésilienne à son enfant disparu, sur fond de carnaval de Rio. Entre émotion et paillettes, souffrance et fête, pudeur et peau nue, le film vient de remporter à Locarno le prix du meilleur court-métrage suisse et sera le candidat du festival aux European Film Awards, les prix du cinéma européen.

Format Court : Tu as étudié le cinéma en Europe, mais tu viens du Brésil. Peux-tu me raconter ton parcours ?
Felipe Casanova : J’ai grandi au Brésil jusqu’à mes 9 ans. Après, je suis parti en Suisse, à Genève, où j’ai vécu jusqu’à mes 20 ans. Puis je suis allé en Belgique pour étudier le cinéma, à l’IAD.
Pourquoi avoir choisi cette école ?
F.C. : Bonne question… (rires) ! Disons que je n’ai pas eu une super expérience à l’IAD. J’ai terminé mes études, oui, mais ça a été difficile. L’école nous formait à un cinéma très conventionnel, très cadré, très « Hollywood » : grosse équipe, planning fixe, pas de place à la discussion ou à l’improvisation. Ce n’était pas du tout ce qui me correspondait. Heureusement, j’ai eu aussi des professeurs inspirants, comme Claudio Pazienza en première année, qui m’a vraiment ouvert des portes.
Quand tu évoques un cinéma « conventionnel », tu te réfères surtout à la fiction ?
F.C. : Oui, et même dans la fiction, je pense qu’on peut expérimenter. Mais là, on nous imposait une vision très fermée. Comme si tu devais déjà avoir l’image finale en tête et ne faire qu’exécuter. Moi, je préfère travailler autrement : je vois le film comme une toile vierge. Je lance un geste, je teste, je me laisse guider par l’intuition. Le film prend forme petit à petit, presque comme une sculpture qui se révèle. Et je trouve que ça donne des objets plus organiques, plus vivants.
Ce que tu décris, ça correspond beaucoup à ta pratique documentaire.
F.C. : Oui, en partie. Mais je pense que la frontière entre fiction et documentaire est plus poreuse qu’on ne le croit. Dans mon dernier film O Rio de Janeiro Continua Lindo, par exemple, je me suis inspiré des lettres écrites par des mères brésiliennes à leurs enfants disparus, victimes de violences policières. J’ai préféré créer un personnage de fiction pour porter leur voix, parce que le sujet est très délicat. Quand on voit le film, on a l’impression que c’est du documentaire pur, mais en réalité, c’est hybride. Et c’est ça qui m’intéresse.
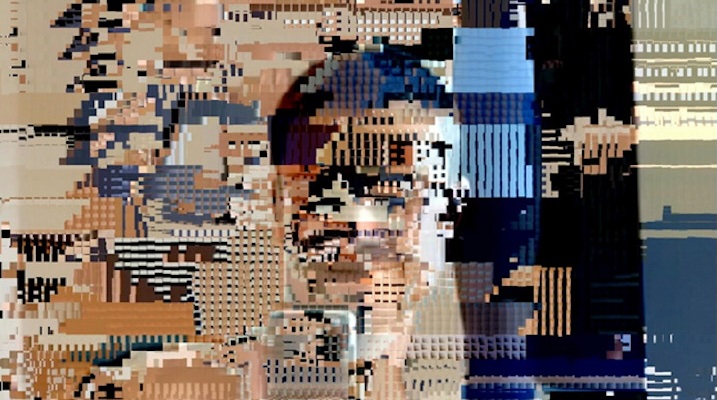
« Loveboard »
En sortant de tes études, comment as-tu trouvé la confiance pour faire des films malgré ce sentiment d’être un peu à la marge ?
F.C. : Ça a été dur. J’étais assez dégoûté de mon expérience de fiction classique. Mon film de fin d’études, c’était de la fiction, mais l’expérience a été lourde, très cadrée, trop stricte. J’aime travailler dans le temps du film, adapter, changer, expérimenter. Là, ce n’était pas possible. Après ça, j’ai fait un premier court, Loveboard, tout seul, sans producteur. Et ça a été libérateur. Si ça marchait, tant mieux, si ça ne marchait pas, je ne devais rien à personne. Et finalement, le film a bien voyagé en festival. Ça m’a donné confiance.
En étant seul, quel est ton rapport au temps pour tes projets ?
F.C. : Ça fait trois ans que je travaille sur un projet de moyen-métrage de 30 à 40 minutes. Même si ce format est plus difficile à produire et à diffuser, je sens que j’ai besoin de passer par là avant d’affronter le long. Je veux éviter d’être à nouveau dégoûté par une expérience trop lourde. Le long demandera forcément une structure narrative plus conventionnelle. Là, j’expérimente encore, mais avec une écriture un peu plus poussée.
Tu as collaboré avec Maxime Jean-Baptiste (réalisateur de Kouté vwa) au montage pour ton dernier court. Qu’est-ce qui vous a incité à travailler ensemble ?
F.C. : Je faisais partie du comité de sélection du Festival En Ville !, un festival de documentaires en Belgique. J’avais vu certains de ses courts qui y ont été sélectionnés. J’avais saisi qu’au niveau des thématiques, on allait bien s’entendre. En plus, il travaillait aussi sur des archives, comme moi. On s’est mis à travailler ensemble. C’était exceptionnel, c’était vraiment la meilleure collaboration que j’ai eue. On travaillait parfois chacun de notre côté, parfois à quatre mains. C’était hyper organique, hyper stimulant.
Dans ta bio, tu parles d’un intérêt pour l’expérimentation. Ça veut dire quoi pour toi ?
F.C. : Pour moi, expérimenter, c’est travailler sans savoir exactement où on va. Comme une sculpture qu’on taille petit à petit. C’est aussi au montage que ça se joue : mettre les images les unes après les autres, voir ce que ça crée comme mouvement, comme sensation. C’est là que le film s’écrit vraiment.

« O Rio de Janeiro Continua Lindo »
Ton dernier film utilise des images du carnaval de Rio, symbole de fête, de joie… et tu y mêles une histoire beaucoup plus sombre. Pourquoi ce choix ?
F.C. : Justement pour jouer avec cette carte postale qu’on connaît tous. Derrière l’image brillante du carnaval, il y a un héritage colonial, une histoire de souffrance. La samba vient des esclaves, d’une tristesse immense. Et aujourd’hui encore, il y a les fantômes de la dictature militaire, la violence policière, l’impunité. J’ai voulu confronter cette image de fête à cette réalité plus dure, en passant par la voix d’une mère qui écrit à son fils disparu.
Est-ce que les lettres que tu as utilisées étaient publiques ?
F.C. : Non, elles m’ont été données directement. Certaines avaient été exposées une fois, mais la plupart venaient d’un cercle intime. Une d’entre elles a même été écrite pour le film, par une femme, Bruna, qui a fortement inspiré le projet. Avec Delphine Gérard (réalisatrice de Quitter la nuit et Une sœur), on a travaillé l’écriture de la lettre, pour trouver le bon équilibre : éviter le larmoyant, mais garder la force politique. Et on a demandé à une Ilma, une femme qui vend des boissons au carnaval, de lire le texte de la carte postale. Elle n’est pas comédienne, mais elle s’est approprié le texte avec une sincérité incroyable. C’était bouleversant.
En période de décès, on écrit souvent des mots aux disparus. Qu’est-ce que ce geste représente selon toi quand une mère écrit une lettre à son enfant parti trop tôt ?
F.C. : C’est cathartique. C’est une manière de continuer à faire exister l’enfant. Bruma a reçu une une « réponse » de son fils via un medium. Ça fait partie d’une spiritualité très présente au Brésil, héritée des traditions africaines. Le film touche aussi à ça.
Comment as-tu vécu, toi, le fait de porter cette parole en tant qu’homme blanc ?
F.C. : C’était une grande question. Mais ces femmes m’ont invité à en parler. Elles m’ont donné cette légitimité. J’ai senti que ça avait du sens de mettre mes outils à leur service. J’espère que le film le montre : je n’étais pas là où je n’étais pas invité.

« »O Rio de Janeiro Continua Lindo »
Le film vient d’être montré à Locarno. Quelle en a été la réception dans un cadre composé à la fois de professionnels et de cinéphiles ?
F.C. : À Locarno, c’était très fort. La projection a été une expérience incroyable : voir ces visages sur grand écran, sentir la salle émue, pleurer moi-même comme je n’avais jamais pleuré. C’est là que j’ai compris le sens de tout ça : partager une émotion collective, presque une communion.
Es-tu croyant ?
F.C. : Pas de manière classique. Je crois en plusieurs choses, disons.
Comment vois-tu la suite de ton parcours de réalisateur ?
F.C. : J’essaie de rester vigilant. De ne pas faire des films pour mon ego, ni d’aller trop vite parce qu’on m’attend. J’ai commencé à travailler sans qu’on m’attende, et j’ai aimé ça. J’essaie de garder ce focus-là : être dans le geste du film.
Propos recueillis par Katia Bayer. Mise en forme : David Khalfa


