Réalisateur de Dieu est timide, son premier film professionnel produit par le studio Remembers (fondé par Ugo Bienvenu et Félix de Givry), Jocelyn Charles explore le son, le gore et le réel. Présélectionné au César du meilleur court-métrage d’animation 2026, son film a été présenté à Cannes, à la Semaine de la Critique. Il est actuellement montré au Festival Premiers Plans d’Angers, dans la section Plans Animés.
Dieu est timide est également le film qui a récolté le plus de voix dans votre Top 5 des meilleurs films de l’année — un détail loin d’être anodin. À l’occasion de cette belle reconnaissance, nous avons pris le temps d’échanger avec son auteur autour de ce film intrigant et coloré, qui aborde la question des cauchemars et des troubles.

Format Court : Qu’est-ce qui t’a incité très jeune à t’orienter dans l’art ?
Jocelyn Charles : Je voulais déjà faire de l’animation dès le collège. Mon prof d’art plastique m’avait conseillé de faire un lycée d’arts appliqués et je suis rentré à l’école Boulle. J’ai pu y entrer grâce à des lettres de recommandation. Cela m’a permis de rentrer à l’école Estienne après.
Je pense que mon intérêt pour l’animation est dû à un concours de circonstances, mais il y a surtout eu l’avènement des mangas en France, à la fin des années 90, avec le Club Dorothée et l’animation japonaise. Ça a vraiment influencé toute une génération. J’ai deux frères, l’un a neuf ans de plus que moi, l’autre sept. Ils regardaient énormément Les Chevaliers du Zodiaque, Dragon Ball Z, Nicky Larson… Ils dessinaient tout le temps et, comme tout petit frère, j’ai essayé de les imiter. J’ai commencé à dessiner très tôt, à recopier les couvertures de mangas, à me mettre en compétition avec eux. J’ai retrouvé récemment un classeur de dessins : dès l’âge de six ans, je dessinais constamment. J’ai dû faire une centaine de dessins.
Un jour, mon frère a ramené un gros bloc de post-it acheté au supermarché. Il m’a montré que si on faisait défiler les pages avec le pouce, ça créait une illusion de mouvement. On pouvait faire un flipbook. Je suis tombé amoureux de ce procédé d’animation très instinctif, où on dessine au fur et à mesure chaque image sans savoir exactement où on va. Entre Dragon Ball Z et ces blocs de post-it, c’est vraiment là que s’est forgée mon envie de dessiner et de faire de l’animation dès un très jeune âge.
Les dessins animés de l’époque ne véhiculaient pas les mêmes choses pour les filles et les garçons. Est-ce que l’univers masculin des mangas a nourri quelque chose de particulier chez toi ?
J.C. : Oui, clairement. Il y avait une violence visuelle, assez inédite pour l’époque, quelque chose de plus cru que dans les dessins animés occidentaux. Face au sang et aux bagarres, on avait l’impression de regarder quelque chose d’un peu interdit, pas totalement de notre âge. Je crois que ça explique notre fascination.
Il y a aussi cette idée très forte de dépassement de soi, de rivalité, de compétition permanente. Le héros a un potentiel infini et se surpasse à chaque épreuve de plus en plus dure, de plus en plus grande. Il doit prouver qu’il est le meilleur. Quand on est enfant, c’est extrêmement fascinant de voir ses héros agir de la sorte. Je pense que je me suis inconsciemment mis en compétition avec mes grands frères, et les mangas me renvoyaient peut-être ce type d’imaginaire.
À quel moment as-tu forgé ton propre style ?
J.C. : Mon parcours est très académique. Au début, j’avais plutôt une culture de la technique. Je ne me considérais pas du tout comme un auteur ou un réalisateur. Je voulais faire les choses les plus « parfaites ». J’admirais surtout des auteurs très techniques, très réalistes, avec une animation fluide et parfaite. À partir de l’École Estienne, puis surtout aux Gobelins, j’ai fait la connaissance de camarades de classe, des gens de mon âge qui avaient vraiment une longueur d’avance sur tout le monde, qui étaient beaucoup plus créatifs, audacieux et personnels dans leur approche. Ils faisaient des choses non clichées, très sensibles, très personnelles, loin de la technique. Ça m’a beaucoup marqué. Aux Gobelins, où tout le monde était dans la technique ultime, j’ai commencé à aller à contre-courant et à vouloir faire quelque chose d’original, d’arrêter de faire de l’action et d’aller vers plus de psychologie et de dialogue.
Aux Gobelins, tu as fait un film de fin d’études, Déjeuner sur l’herbe, avec d’autres personnes. Ça a été une étape importante ?
J.C. : Oui, énormément. On l’a réalisé à quatre et on a touché à toutes les étapes de fabrication. Chaque étape était instructive. J’ai surtout appris à structurer un récit. À un moment, on était bloqués sur le scénario. J’ai décidé de faire une animatique (un storyboard animé) avec une musique qui rythmait le film, un peu comme pour un clip. Cette approche a débloqué beaucoup de choses. Je me suis inspiré pour cela de The Shivering Truth, un film d’animation en stop motion produit par Adult Swim, une chaîne américaine un peu indé, mais qui produit de l’animation assez proche de ce que j’aime : des récits beaucoup plus auteur, très écrits, pas du tout portés sur l’action. Le film comporte une voix off, un humour noir, une narration très moderne. Ça reste une référence majeure pour moi.
Comment es-tu arrivé au studio Remembers ?
J.C. : Pendant les Gobelins, j’ai fait un stage chez Passion Pictures, un studio d’animation, sur un projet Marvel. J’y ai rencontré Ugo Bienvenu et Kevin Manach. On s’est très bien entendus avec Ugo, il appréciait mon dessin. Ugo est resté en contact avec moi et, à ma sortie d’école, il m’a proposé de travailler au studio Remembers. Au début, celui-ci proposait aux jeunes artistes de travailler sur leurs projets personnels. Des jeunes sortis d’écoles réalisaient des GIFs (des petites animations d’une dizaine de secondes) pour leur site internet et leur compte Instagram. C’était un échange : on profitait de la visibilité du studio et eux, ils enrichissaient leur vitrine artistique avec de nouveaux artistes. C’est comme ça que j’ai commencé à développer ma patte chez eux, avant de réaliser mes premiers clips.
Qu’est-ce que le clip t’apporte justement ?
J.C. : J’adore ce médium. La musique est déjà là, elle est entière, et on vient y greffer un univers visuel. La musique inspire les images, et les images enrichissent l’univers du groupe. C’est une belle collaboration qui influence les uns et les autres. Ça faisait longtemps que je voulais faire des clips et j’aimerais continuer à en faire toute ma vie.
De quelle façon cette expérience a-t-elle nourri Dieu est timide ?
J.C. : Le rythme du film est né de la musique. Je voulais, à la base, faire un film qui évoluerait en tension. J’avais envie que cette tension monte progressivement, comme dans un morceau. J’ai beaucoup écouté Ommadawn (Part II) d’un grand compositeur, Mike Oldfield, pendant l’écriture. Cette musique a une narration, une vraie intensité. Je voyais vraiment un film en l’écoutant. Je me disais que ce serait incroyable que mon film se fasse sur cette musique-là. Finalement, j’ai abandonné l’idée, mais elle m’a vraiment inspiré le rythme et l’évolution du scénario. J’aime bien réfléchir en musique, mettre tout de suite de la musique dès que je peux dans le montage pour me plonger immédiatement dans des ambiances.
Remembers a aussi produit Arco, qui a été le premier long-métrage de toute la boîte. Tu as fait un quart de l’animation. Comment as-tu vécu cette phase ?
J.C. : C’était très instructif de vivre, au cœur même du studio, la création d’un long depuis le début, depuis les premières discussions d’Ugo et Félix. On a tout vu de A à Z pendant presque six ans. Ça a pris du temps, ça a nécessité énormément d’allers-retours, de discussions avec les producteurs. Le succès potentiel d’Arco va probablement permettre aux futurs projets d’aller plus vite. C’est stimulant, mais je ne sais pas si ça m’a vraiment donné envie de faire la même chose, car on a vu toutes les galères. Ça peut être épuisant. C’est tellement chronophage de faire un long qu’il faut vraiment être sûr que ça va valoir le coup. On ne fait pas un long à la légère.
C’est quelque chose qu’on sait pourtant quand on fait de l’animation, le fait que ça va être long et solitaire. Du coup, qu’est-ce qu’on fait ?
J.C. : On s’en doute, on nous rabâche depuis longtemps que c’est long. Pendant Dieu est timide, mon envie, c’était d’aller le plus vite possible, d’être le plus efficace possible. En général, il y a ce qu’on appelle le rough (le brouillon, l’animation esquissée), le tie-down (on vient mettre des volumes sur l’esquisse, on précise un peu) et le clean (la dernière étape). Ce sont trois étapes de la même animation, mais qui se peaufinent de plus en plus. Moi, je suis tout de suite parti de l’étape finale parce que j’utilisais beaucoup de 3D, beaucoup de vidéos de référence. J’ai toujours eu envie d’aller le plus vite possible, justement parce que je sais que c’est chronophage et que ça m’ennuie. Pour le long, je ne suis pas sûr que je pourrais utiliser le même processus. Mais c’est quand même quelque chose qui me donne envie et qui me fait rêver. On verra, peut-être que les progrès technologiques feront que ça ira plus vite.
Grâce à l’intelligence artificielle, par exemple ?
J.C. : Peut-être pour des intervalles, sans que ça nuise au processus créatif. Ça, ça reste toujours humain, mais peut-être pour des choses très longues et rébarbatives. Qui sait ? Ça pourrait accélérer les choses.
Dieu est timide est ton premier film professionnel en solo. Qu’avais-tu envie d’y tenter ?
J.C. : Ça faisait longtemps que je faisais des animations courtes d’une vingtaine de secondes qui m’ont vraiment entraîné à la réalisation. J’avais fait des clips et beaucoup de GIFs sur mon Instagram, mais tout ça était très court et il me tardait de créer une narration qui dure plus longtemps, au moins une dizaine de minutes, pour instaurer vraiment une ambiance. Je voulais m’exercer à la mise en scène, plonger le spectateur dans une ambiance, dans mon univers. Ce qui me tenait vraiment à cœur aussi, c’était l’utilisation de dialogues. Je voulais faire un film très bavard, parce que j’aime les films où on parle et qu’en animation, pour une raison ou une autre, il y a un immense pourcentage de films totalement muets, probablement parce que c’est très complexe de faire parler les personnages. Et puis, j’avais envie d’explorer l’horreur en animation, un genre encore très peu exploité en Occident. Ça faisait des années qu’on en parlait avec mes amis d’école. On sentait que c’était un genre qui commençait à être un peu plus anobli par les films récents. Avant, c’était souvent rangé au rang de nanars. Mais depuis Hereditary, Grave, Titane, les films de Jordan Peele, The Lighthouse ou The Witch, ou même dans le cinéma coréen qui l’exploite très bien en mélangeant beaucoup de genres, l’horreur a commencé à grimper à des rangs plus nobles, presque de films d’auteur. On sent un avènement du genre et je me suis dit qu’en animation, il y avait encore une brèche où ça n’avait pas vraiment été exploité en Occident. J’avais envie de tenter ce genre-là en l’associant à quelque chose d’un peu poétique, un peu absurde et très écrit.
Ensuite, au niveau de l’histoire, je me suis un peu laissé guider par l’ambiance que j’avais envie d’instaurer. Je n’avais pas de propos spécifique, pas d’idée en tête. Effectivement, je doutais de mes capacités à écrire un scénario, des dialogues, donc j’ai commencé par lire beaucoup de nouvelles. Comme je voulais être dans le genre de l’horreur, j’ai lu beaucoup d’Edgar Allan Poe. Je cherchais des nouvelles un peu horrifiques sur Internet ou des romans qui traitaient un peu de ce sujet. Mais à chaque fois, je ne me sentais pas vraiment inspiré. J’avais envie de quelque chose de beaucoup plus moderne, en fait. Mes producteurs, Ugo et Félix, m’ont vraiment poussé à ne pas trop réfléchir et m’ont donné ce conseil : « Fais ce que tu as envie de voir en tant que spectateur, surtout. » Je me suis lancé dans des scènes très basiques : un couple qui dessine dans un train. C’est quelque chose que je faisais avec mon ex-copine, ça nous arrivait souvent de passer le temps en dessinant. Ensuite, l’écriture s’est faite de manière très intuitive, presque automatique. J’ai appris à vraiment me faire confiance et à croire dans l’idée que je pouvais construire quelque chose, même si ce n’était pas très sensé. Le court métrage permet quand même d’expérimenter beaucoup et je savais que j’avais beaucoup de liberté.
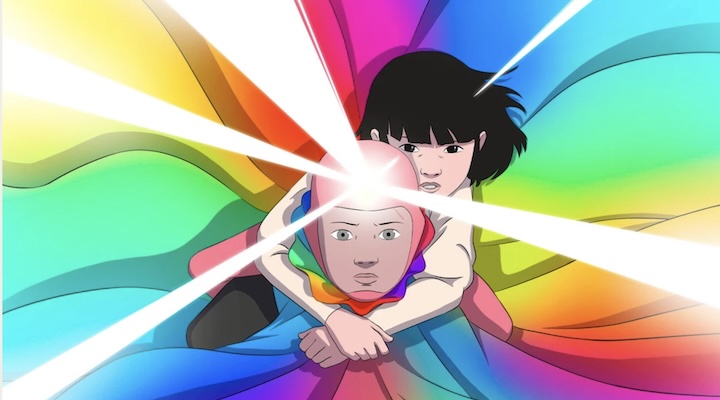
« Arco »
Comment as-tu travaillé le son et la musique pour ton film ?
J.C. : J’ai commencé à collaborer avec Arnaud Toulon, qui s’est occupé de toute la musique d‘Arco. Finalement, il s’est rendu compte qu’il n’aurait pas le temps de travailler sur les deux projets. Il m’a recommandé une artiste, la musicienne PR2B, avec qui j’ai ensuite collaboré. Je lui ai envoyé beaucoup de références, notamment la bande originale de White Lotus de Cristobal Tapia de Veer, un compositeur incroyable qui a aussi fait la bande-son de Utopia. Il instille beaucoup plus d’humour dans la musique, des instruments très étranges et des modifications de voix, ce qui me semblait incroyable comme bande-son. Je l’ai tout de suite mise en musique témoin dans mon animatique. Ça a été une grosse référence que j’ai envoyée à Pauline, qui a pu me concocter de longues bandes originales de presque vingt minutes chacune, dans lesquelles j’ai ensuite puisé pour construire la bande-son finale.
Le son est fondamental en animation, parce que tout est inventé. C’est le son qui ramène du réel à partir de rien, à partir d’une feuille blanche. On décide de tout : les costumes de toutes les personnes qu’on dessine, la couleur des chaussettes, des cheveux d’une personne à l’arrière-plan, le nombre de feuilles qu’il y a dans un arbre… Ce contrôle maximal perd forcément en authenticité, puisqu’on ne peut pas inventer le réel ainsi que son chaos, son hasard. Pour moi, c’est le son qui permet de récupérer quelque chose de très authentique, avec des voix qui hésitent un peu, de l’impro, des respirations, des bégaiements, des vêtements qu’on entend. Ça ramène beaucoup de réel à une animation qui est très contrôlée, maîtrisée. Ça vient un peu combler l’artifice de l’animation.
À quel moment, malgré tout, on se dit que c’est bon ? On peut toujours être tenté d’approfondir, d’aller chercher des détails supplémentaires…
J.C. : Oui, complètement. Je me suis autorisé le luxe de revenir beaucoup sur mes plans, même quand j’avais validé plus ou moins l’animatique. Je m’autorisais à pouvoir les reprendre, étant donné que j’étais quand même plutôt seul aux manettes. Malgré tout, les contraintes de temps faisaient que j’ai quand même fini par valider à peu près tout pour me concentrer vraiment sur la production. Mais je gardais au fond de moi l’idée que même pendant que je faisais l’animation et la couleur, je pouvais recommencer un plan si vraiment je ne le sentais plus au fur et à mesure de la production.
Combien de temps t’es-tu concentré sur ce projet, entre la genèse et le rendu final ?
J.C. : Environ deux ans, mais pas à temps plein. J’ai travaillé en parallèle sur Arco pendant plus ou moins huit mois. J’étais quasiment seul sur l’animation, à part une trentaine de secondes réalisées par un animateur qui s’appelle Tamerlan Bekmurzayev et qui a aussi participé à Arco. Le luxe, c’est qu’on n’attendait même pas la validation du CNC pour avancer. Je continuais de produire, même entre les demandes. Je n’ai jamais été contraint d’attendre une aide pour continuer de travailler. J’ai cherché à aller vite, à être efficace, parce que je sais à quel point l’animation est chronophage.

Pour camper les voix de Dieu est timide, tu as fait appel à trois comédiens (Danièle Evenou, Alba Gaia Bellugi et Anthony Bajon) qui ont de l’expérience, mais qu’on ne retrouve pas forcément dans le doublage d’animation. J’ai l’impression que les acteurs se prêtent de plus en plus au jeu. Comment ça s’est passé pour toi de les diriger, avec leur sensibilité et leur personnalité ?
J.C. : C’était une première pour les trois. On voulait qu’ils soient tous les trois autour de la table, alors qu’en général, ça se fait plutôt individuellement. Chacun dit ses répliques au micro, on enregistre, on stoppe, on passe à l’autre. Moi, je tenais à ce qu’ils communiquent entre eux, souvent tous les deux, Anthony et Alba, mais il est arrivé qu’ils soient tous les trois et qu’ainsi, ils puissent un peu se couper la parole, enchaîner et improviser. Félix et Arnaud ont assisté à l’enregistrement, heureusement, parce qu’ils m’ont donné beaucoup de confiance. Tout le monde était heureux, je pense, de faire quelque chose d’assez rapide. Dans le live, on attend qu’on change les caméras et les lumières, on fait beaucoup de pauses. Là, pour l’animation, ça va très vite. En une demi-journée, on peut faire vingt minutes.
Pourquoi était-ce important pour toi de les avoir ensemble ? Pour gagner en authenticité ?
J.C. : Oui. Étant donné que, dans mon film, ils sont autour d’une table de TGV, physiquement proches, ça me paraissait naturel d’enregistrer dans les mêmes conditions pour avoir, malgré tout, la sensation qu’ils se regardent, qu’ils s’écoutent, qu’ils se coupent la parole. Par exemple, en animation, c’est très rare d’avoir des personnages qui se coupent la parole ou qui parlent les uns sur les autres. J’avais vraiment envie que ce soit un peu confus, un peu vivant, et que finalement les personnes parlent, qu’il y ait même un contrôleur qui vienne parler encore plus par-dessus. L’idée, c’était vraiment de se rejoindre dans quelque chose de réaliste et d’authentique.
Quand on fait un court-métrage comme ça, est-ce qu’on en sort fatigué, avec un besoin de faire une pause ?
J.C. : Oui, complètement. Le fait de l’avoir porté seul, quand même, ça m’a amené proche du burn-out à la fin. Pendant longtemps après, je n’avais plus aucune créativité, plus aucune envie de dessiner. Ça n’est d’ailleurs pas totalement revenu, malgré tout. Même si je continue d’accompagner le film et de le promouvoir dans les festivals, ça ne me libère pas énormément de temps pour créer pour moi. Je suis encore dans le vide. J’ai toujours mon carnet de dessin d’observation. J’en fais tout le temps, même quand je n’ai pas beaucoup d’inspiration, parce que ça ne demande pas vraiment de créer : j’observe juste ce qu’il y a devant moi. Mais je n’ai pas entamé de projet créatif depuis.

Après, l’accompagnement en festival, ça prend aussi de l’énergie. Mais c’est une bonne transition, après tout ce travail en solitaire, de te retrouver dans des salles et d’être confronté à un public…
J.C. : Là, à Angers, la salle était immense. C’était une des plus grandes salles que j’ai pu voir et dans laquelle mon film a été projeté. C’était effectivement très touchant de le projeter devant autant de monde. Il y avait presque 1 200 places, je crois.
Comment vois-tu la suite ?
J.C. : Je n’ai pas de pression. Ça, c’est un luxe aussi. Je sais que je peux avoir des commandes un peu plus techniques qui arrivent, mais c’est sûr que j’ai envie de continuer à faire de la fiction. Je ne sais pas si je vais faire un autre court. J’aimerais bien essayer de faire de petites scènes, simplement pour moi, de quelques dizaines de secondes, que je posterais peut-être sur Instagram aussi, sans que ce soit dans un format spécifique. Pour l’instant, c’est ça.
C’est quoi, l’intérêt pour toi de poster ce genre de petites choses sur Instagram ? Pour avoir une vitrine ?
J.C. : En effet, c’est vraiment une vitrine. Je n’ai pas de site personnel que j’ai créé ou développé. Tous mes travaux, je les poste sur Instagram en premier. Ça stimule de voir les réactions, ça te donne un peu confiance. Quand tu as beaucoup de réactions, tu vois que ça plaît et ça te donne envie de continuer. C’est vraiment grâce à Instagram que ma carrière de réalisateur a débuté. Je pense qu’Ugo a eu confiance en moi parce qu’il voyait mes GIFs personnels sur Insta, qu’il voyait ce que je pouvais créer comme univers graphique. Évidemment, c’est un entraînement, mais c’est aussi une vitrine pour le grand public et pour les autres studios qui veulent voir ce dont tu es capable.
Il y a de plus en plus de croisements entre BD, animation, illustration de presse… Est-ce que c’est quelque chose qui pourrait te brancher, la BD, l’illustration ?
J.C. : Oui, ça me branche. J’ai déjà fait des couvertures de magazines et de l’illustration. Je discute avec les éditions Réalistes, fondées par Ugo, qui sont plus proches du manga. Ça peut être une belle opportunité de commencer avec un format un peu plus petit, un peu plus simple. Comme l’animation est très chronophage, en bande dessinée, le fait d’écrire une bulle en quelques secondes, c’est l’équivalent de passer parfois plusieurs semaines à animer un dialogue. Ça peut aller beaucoup plus vite, donc oui, ça me tente. Mais je reste avant tout attaché à la mise en scène et au son.
Propos recueillis par Katia Bayer
Article associé : la critique du film


