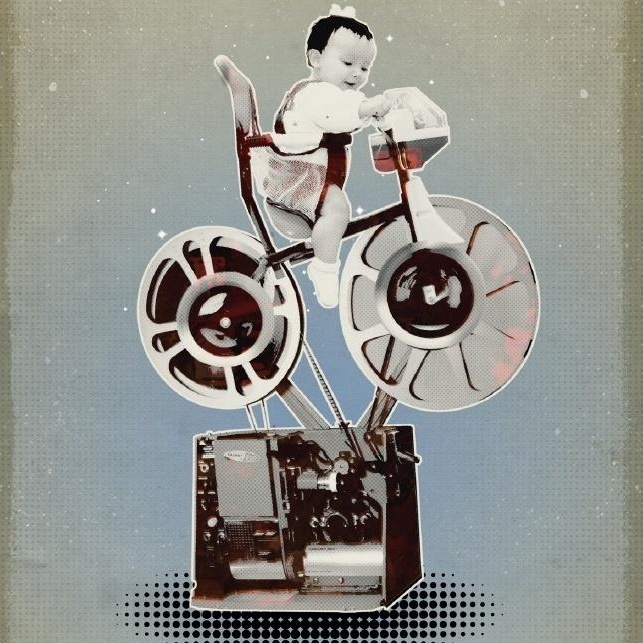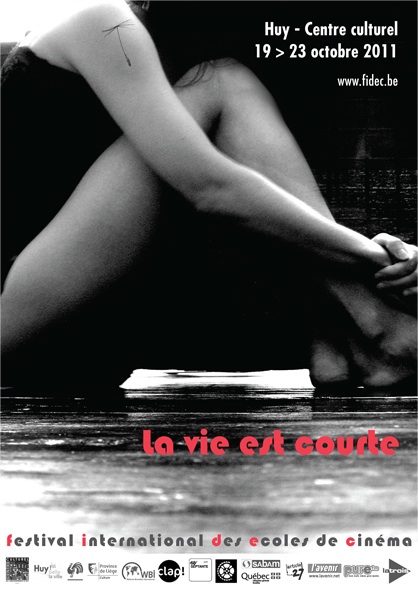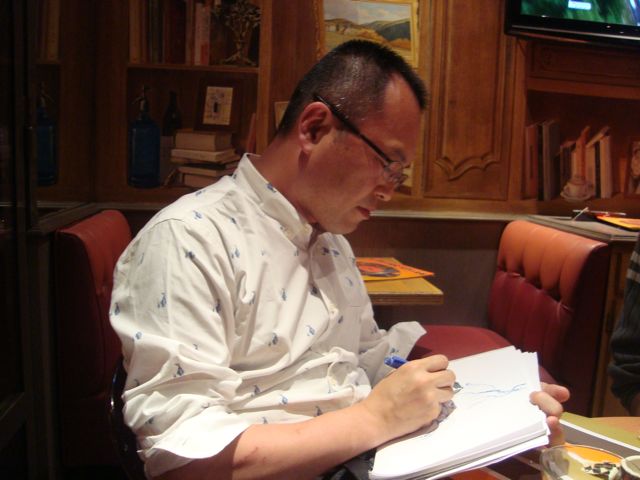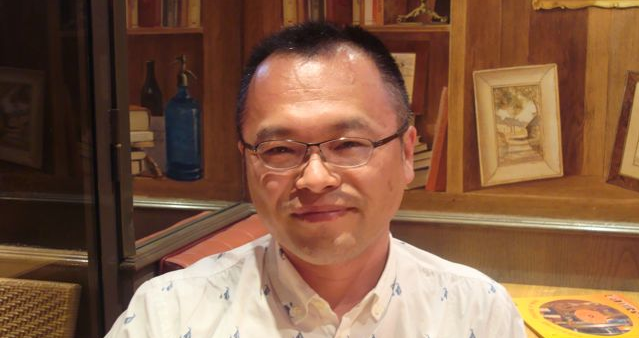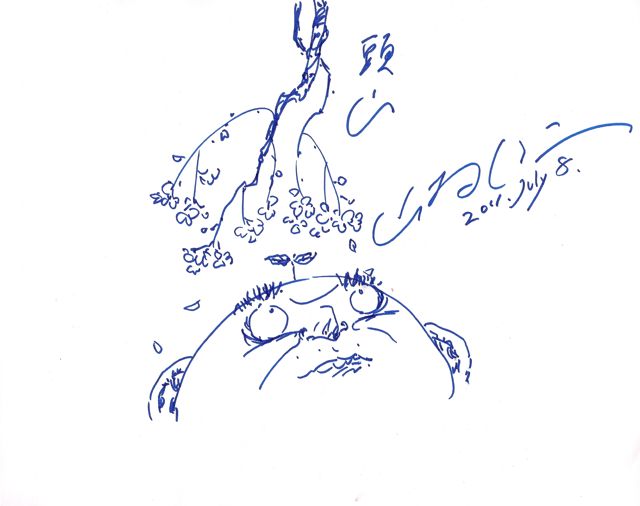Depuis Paris, le sifflement de deux heures de train suffit. À la gare de Trouville-Deauville, prendre à droite pour la 12ème édition du festival Off-Courts ( du 2 au 10 septembre 2011). À gauche, à peu près aux mêmes dates, on entre dans la 37ème édition du festival du cinéma américain de Deauville.
À droite, dix minutes à pied suffisent. Dans l’atelier provisoire des mareyeurs, à l’intérieur d’un ancien restaurant, au Salon des Gouverneurs du casino, au Marché international du film court de Trouville s’ouvre un éventail de créations et d’animations. 1100 films reçus, plus de 140 exposés durant le festival, des concerts, une programmation réservée à un public scolaire, des courts québécois et français en compétition, des projections extérieures, des courts réalisés et montés en 48h, donnent un aperçu de la vitalité du festival Off-courts de Trouville établi près des commissures de la mer.
Face à pareille condensation cinématographique, sortir l’appareil à dilution et inviter quelques spécimens.
Land of the heroes (Belgique/Irak) de Sahim Omar Kalifa. Dans la catégorie International PCC (Prends ça court !)
Cela se passe comme ça dans une région désertique de l’Irak : la mort est un jeu à emporter. Aucune obligation à la consommer sur place. Pendant que des images du « Raïs » Saddam Hussein piratent l’antenne du téléviseur et le temps de diffusion des dessins animés, chacun s’affaire. Deux mères astiquent grenades, AK-47 et d’autres armes comme elles feraient la lessive : normal, en l’absence d’eau et d’hommes, il faut bien se rendre utile en exécutant à sec une ou deux tâches ménagères. Un frère et une soeur, eux, faute de dessins animés à la télé, « s’amusent ». On les croit innocents alors qu’ils ont arrêté de l’être. C’est donc qu’ils restent des indicateurs d’un certain optimisme. Par on ne sait quelle stratégie de la redoute ou de Fed Ex, un costume de Spiderman est arrivé là. Mais ses vertus sont paradoxales : celui qui le porte s’empêtre dans la toile d’un de ses cousins. La cohabitation est brutale et humiliante. Presque plus violente que la guerre irako-iranienne (1980-1988) qui favorise redistribution des boites crâniennes et fuite des cerveaux.
Les hommes ont une vie bien remplie. Lorsqu’ils sont à la télé, ils assistent ou prennent part à une parodie de victoire en présence du Raïs; ils participent alors à une victoire du passé : les images que l’on nous en montre appartiennent à cette époque où Saddam Hussein – exécuté en 2006 à Bagdad pour crimes contre l’Humanité- dirigeait l’Irak; autrement, lorsqu’ils sont sur le terrain, les hommes gardent des forts et des lieux aussi stratégiques que leur propre absence.
Plus que l’attitude des enfants, l’ambiguïté des deux femmes attribue une composante menaçante à Land of the heroes. Car leurs gestes sont calmes et appliqués. Elles font des ustensiles de la mort des objets banals, sortes d’aiguilles à tricoter dont on dispose en discutant de choses et d’autres. Il semblerait que, plus que celle des enfants, la violence des femmes effraie davantage Sahim Omar Kalifa car il nous la donne assez peu à voir. Et, lorsqu’il le fait….
O Inferno (Portugal) de Carlos Conceiçao. Dans la catégorie International PCC.
Dans Land of the heroes, même vulnérable, il existe une assez belle complicité entre un frère et sa sœur. L’alliance avec quelqu’un de son âge reste possible. Dans O Inferno, un enfant se retrouve seul, auprès d’adultes qui, un moment, l’excluent. Ce qui aura quelques conséquences.
« Le ciel et l’enfer coexistent dans la même maison où un gars a la fonction de garder la piscine propre, mais finit par s’impliquer dans des activités qui le compromettent ».
Un homme, deux femmes, une piscine dans une villa et un enfant d’à peine douze ans. Le paradis affiché. Une piscine immaculée. Rafa – dont le prépuce exclut formellement toute parenté avec celui d’un fervent adepte de la terre battue bien connu des souffles coupés et de certains services liftés – fait l’amour avec les deux femmes. L’enfant, lui, imagine ce que ces trois adultes font ensemble à huis clos. Tout le monde est beau dans cette constellation.
Rafa, le jeune homme viril latin, sûr de lui, qui donnerait envie de se jeter au fond de la piscine pour des langueurs câlines est donc beau. Les deux femmes, aussi, sont désirables, lèvres, corps et regards modulables. La femme de Rafa d’abord, laquelle est une branche qui se plie à ce raccordement à trois. Ah ! La voir se mettre sur la pointe des pieds quand elle l’embrasse… Et puis, il y a l’autre compagne visiblement mieux disposée. Il y a aussi le Portugais, langue bien plus érotique qu’une mangue au tartre…
Rafa procède à une levée des corps qui réduit ou intensifie notre capacité de connivence avec lui. Mais il y a l’enfant. Celui-ci veut plonger tête la première, du moins voir, ce que ces trois là se mettent. Alors, il appelle Rafa. Peut-être qu’habituellement, Rafa s’amuse avec lui. Comme un garçon plus âgé sert parfois de modèle à un plus jeune. Enfin, il y a le père, le mari, fourbu, cocu, dont on découvrira véritablement ce qu’il est peu à peu.
Dans O Inferno, tout est surface et notre œil nous trompe. C’est lui qui nous tient et nous interdit d’être. Quant à l’enfant, que fait-il payer à Rafa ? De l’avoir seul ? Ou d’avoir été exclu de sa propre initiation à une certaine virilité ? Ou de l’avoir laissé seul ?
Il Capo (Italie) de Yuri Ancarani. Dans la catégorie International PCC.
Paysage d’hommes stricto sensu, ce documentaire se trace dans une carrière à Monte Bettogli Carrara, où le chef « Il Capo » orchestre la découpe du marbre.
Pour quiconque aime voir les films sans rien en savoir au préalable, il faut un peu de temps avant de comprendre Il Capo. Surtout que tout se passe en silence. Si l’on évacue les bruits de la manœuvre. On assiste là à une libération de l’horizon, peut-être de l’inconscient. L’horizon est de marbre. Il ne bouge pas, ne parle pas, immense, permanence du sacré. L’homme, lui, est plus petit et tout aussi muet. Et il est actif : il a besoin de défaire le marbre.
À mains nues, l’homme ne peut rien contre la roche. Mais avec des machines, réincarnation fabriquée, dopée, de certains animaux préhistoriques, il peut s’y attaquer, le capturer. D’autant que le marbre se laisse faire. C’est dans sa nature. Mais le fendre est un métier dangereux. Cela s’oublie dans Il Capo où le marbre se rend fréquentable, hypnotique. Peut-être parce qu’il compte sur ce documentaire pour faire carrière. Ou parce qu’il se souvient que, malgré tout, c’est nous qui finirons en chantier contre lui.
Sudd (Suède) de Erik Rosenlund. Dans la catégorie International PCC.
La fiction se réinjecte dans les fissures du réel grâce à Sudd. Ce film d’animation bénéficie d’une photographie qui a l’aura ou la violence du cocktail Molotov. La solitude et l’intolérance sont une menace pour notre héroïne. Dans une ville déserte et sans enfants, aux alentours des années 60, celle-ci contracte une maladie par le toucher dans un monde où l’on ne se touche pas ou ne se touche plus. Bien sûr, il est ici question de contact social et non d’un nouveau recensement à titre gracieux des infanteries de l’onanisme, car l’on ne se parle pas non plus dans le film d’Erik Rosenlund. Le salut, s’il en est un, est aléatoire et Sudd nous demande ce qui, dans notre monde, justifie encore qu’on le sauve.
L’accordeur (France) d’Olivier Treiner. 13 mn. Dans la catégorie Projection extérieure.
Plutôt que de sauver le monde, le protagoniste principal de L’accordeur, lui, a envisagé de se sauver. Un jeune pianiste voit sa carrière prometteuse disparaître après un concours. Il réapparaît en accordeur réputé mais aveugle.
Ce court métrage remarqué parle d’ambition et de destin. De cette façon que nous avons de masquer les preuves de nos propres faiblesses. Jusqu’à nous berner et aveugler les autres aussi peut-être. L’accordeur aurait pu être une comédie ou une aventure sensuelle. Le réalisateur a choisi d’en faire un film noir.
L’identité factice que s’est créée l’accordeur (l’acteur Grégoire Leprince-Ringuet) est très séduisante. Elle fournit la paix, le succès et l’espoir qu’une autre vie, meilleure, est possible avec un peu de mise en scène.
L’agent (l’acteur Grégory Gadebois qui peut rappeler Chris Penn dans Nos Funérailles de Ferrara) de l’accordeur, lui, s’apparente à une conscience quelque peu bourrine- jalouse aussi- qui pourrait le ramener à plus de modestie.
Après nous avoir endormis et manipulés (rendus complices et voyeurs de la malice de l’accordeur), Olivier Treiner nous réveille. De la même manière que nous n’avions pas vu la chute initiale de l’accordeur – lorsque pianiste prodige celui ci échoue à son concours- il nous empêche de vérifier sa chute finale. Quand le film s’achève, notre imaginaire, enfermé dans l’impuissance du héros, est dressé à l’espoir et l’angoisse. La gloire et le succès sont pour celles et ceux qui continuent de jouer même lorsque la mort est leur unique spectateur.
Lilith d’Isabelle Noguera. Film en compétition.
Rachel, elle, n’a pas demandé à se trouver au chevet de sa destinée. Contrairement à l’accordeur, à l’origine, elle n’avait pas l’ambition d’avoir du pouvoir sur les autres malgré un certain héritage familial.
Rachel et Lucile sont deux copines d’enfance. En désobéissant, elles provoquent la mort de la mère de Rachel dans un accident de la route. Les deux jeunes filles se perdent de vue. Quinze ans plus tard, Rachel reçoit Lucile dans la maison familiale.
Taillé à la pointe du silex, Lilith est un prénom biblique fait pour l’équarrissage. C’est aussi le titre du court-métrage d’Isabelle Noguera. Si le jeu des comédiens et la bande sonore sont empruntés et trop appuyés à certains endroits, Lilith retient pourtant le regard et peut atteindre l’au-delà de l’écran. Grâce à l’histoire d’une innocence et d’une amitié encornées dans le toril de la douleur. Grâce à une poésie obstinée. Ou peut-être aussi parce que Lilith raconte la terrible punition qui suit certaines désobéissances. Lilith est un court métrage surmoïque. Mais aussi un film de femmes plus que d’hommes.
Lilith expose d’abord l’insouciance de Rachel, la présence sécurisante de sa mère, l’attachement aux chats comme à une certaine liberté- certains parleraient d’indépendance- un don intergénérationnel pour la cartomancie, le sens de l’hospitalité. Puis, la meilleure partie de Lilith entre en lice, lorsque 15 ans après l’accident mortel, Rachel – interprétée adulte par Ophélia Kolb- réinvite sa copine d’enfance Lucile- l’actrice Claire Philippe- à la maison.
Ophélia Kolb/Rachel donne du grain à ce court-métrage ainsi qu’à ces duos ou ces trios qu’elle transforme avec ses partenaires. Elle torréfie en elle toutes les forces menaçantes et insolites de l’histoire. Lucile est « jolie de bonheur », plutôt lumineuse et légère. Rachel est le pendule dont les ressorts agissent sur nous tout en nous maintenant dans l’ignorance de l’échéance qui nous échoit. Ses gestes sont préréglés par une civilité aussi mortuaire qu’irréprochable. Depuis la mort de sa mère, Rachel n’a cessé d’obéir. A quoi ? On croit entrevoir plusieurs fois le montant exact du loyer de ses pensées : elle pourrait être une vampire ou une meurtrière mais ses actes évitent le chaos avec la peau et le sang. Elle pourrait choisir le poison mais on sort de table vivant.
Les deux hommes de l’histoire (le copain de Lucile et l « ami » de Rachel) sont des figurants. Le premier, artiste de rue, semble un idéal masculin voué principalement à susciter l’envie ou le désir de Rachel. Le second est à la fois le témoin d’un passé dans un service psychiatrique mais aussi le spectateur d’un présent où Rachel aspire à certaines apparences de bonheur et de normalité. Même si une certaine démence la dénonce, Rachel s’accroche à la vie. Telle une enfant qui a perdu sa mère.
Articles associés : l’interview de Sahim Omar Kalifa, l‘interview d’Isabelle Noguera